Gabrielle ou la révolution relative
par
popularité : 4%

illustration Sebastien Delorme
Gabrielle ou la révolution relative
Un récit de David Vial
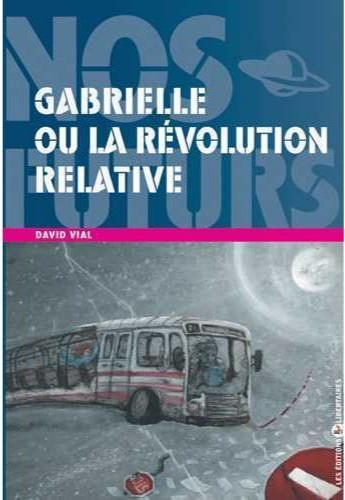
Il me reste quelques exemplaires à envoyer si vous préférez lire sur papier
prendreletemps@riseup.net
lumomana@riseup.net
écrit en 2005
paru une première fois en 2006 aux éditions libertaires
isbn 2-014980-38-8
Gabrielle
Gabrielle travaille dans un bureau vieillot, meublé en toc car son boulot n’est pas
très sérieux. La pièce est petite, haute de plafond et sans équipement récent : il n’y a ni
caméra ni capteurs, même la climatisation manque. Par contre une fenêtre donne côté rue.
Une fenêtre à espagnolette qui peut s’ouvrir ce dont Gabrielle jouit comme d’un privilège.
Elle y passe de longs moments, accoudée, occupée seulement à contempler le ciel ou à
observer le ballet qui se joue à ses pieds, vingt mètres plus bas. Là sur la place les passants
passent : ils marchent au pas sans pourtant qu’une musique militaire ne résonne.
La plupart d’entre eux semblent affairés, pressés et soucieux d’atteindre au plus tôt
un but impérieux ; très peu sont ceux qui se distinguent du haut de cet observatoire par
une démarche nonchalante, indécise ou vagabonde, allure qui n’est d’ailleurs tolérée que
de la part des non-intégrés : celles et ceux qui sont déjà hors compétition.
Si chaque intégré court et s’applique tant à jouer son rôle c’est parce que celui-ci lui
assure un statut social et surtout de quoi subsister ; conscients de la précarité de leur sort,
les intégrés savent qu’ils peuvent à tout moment être touchés de plein fouet par les foudres
d’un dieu implacable, qui réclame tout de tous et qui soudain, peut excommunier par
simple courrier électronique.
Gabrielle travaille. Elle consomme la somme imposée, son statut d’intégrée lui
garantit le logement, l’accès à l’énergie et aux soins, elle dispose d’un peu de temps libre et
du crédit : cette situation devrait la satisfaire. Il arrive malgré tout qu’elle éprouve un
malaise, une gêne persistante qui l’empêche d’être futile, malaise peut-être dû à cette
impression sourde qu’elle a que la réalité glisse et disparaît sous les manigances, les
fantasmes d’une minorité de privilégiés sophistiqués.
Ce qui autrefois était naturel ne l’est plus : plus aucun aliment ne l’est, l’eau est
traitée, lair est filtré dans les nouveaux bâtiments et les rapports humains eux-mêmes sont
maintenant conditionnés. Pourtant Gabrielle connaît cela depuis toujours : elle n’a vécu ni
l’époque d’avant les événements ni même les événements eux mêmes ; elle n’était pas née.
Et ce n’est pas en classe qu’elle aurait pu en apprendre plus sur cette période trouble car
aucun programme scolaire n’y fait allusion ; finalement elle ne sait, comme tout le monde,
que ce qu’on en dit parfois à voix basse … pour se faire peur.
Ce qu’on raconte c’est qu’une partie de la population avait été sacrifiée sur l’autel
politique d’une logique aberrante, qui avait fini par classer le monde et les vivants en deux
groupes distincts : celui du rentable, l’autre de l’inutile. Refusant d’admettre que la notion
de croissance infinie mène au désastre, le monde occidental capitaliste et libéral avait, dit-
on, choisit à ce moment là de pousser encore un peu plus au lieu de mettre un terme à cette
course aussi folle que meurtrière. Lors d’un banal sommet destiné à régler le débit des flux
énergétiques mondiaux, une commission fut chargée, dans le plus grand secret, de
réfléchir aux moyens d’exclure les plus faibles et les plus improductifs, qui par leur
manque d’enthousiasme gênaient la prodigieuse propagation du progrès : ce progrès grâce
à qui bientôt, les rares qui restent encore seront heureux.
Lorsque ce monde occidental, rabougri par le manque d’exercice et abruti par la télé
menaçait d’être rattrapé voire dépassé par les performances globales de ses concurrents
directs et à venir, experts et communicants mirent tout en œuvre pour faire comprendre
que la société ne pouvait plus supporter le poids des incompétents. Alors que des procédés
techniques existaient pour améliorer l’humain et l’élever enfin de manière définitive au
dessus des lois de la Nature, un trop grand nombre de sceptiques n’avaient plus leur place
dans ce nouveau monde. De grandes campagnes marketing annoncèrent d’abord des
changements majeurs dans le confort et la qualité de vie des élus qui continueraient à
voyager dans le train douillet du progrès consommable ; pendant ce temps, à l’assemblée
on votait les lois, on imposait les décrets discrets qui préparaient la transition. Et bientôt
celles et ceux qui n’étaient pas qualifiés ou qui dépendaient de la solidarité sociale, les trop
vieux, les trop malades, les trop infirmes, tous ceux qui osaient dénoncer la manoeuvre, les
pacifistes, les déserteurs, les artistes, les chercheurs, les rêveurs et les poètes, les fainéants
et les drogués, tout ceux-là furent exclus de la nouvelle aventure humaine au prétexte qu’ils
freinaient le cours de l’Histoire.
Et l’opinion préparée se plia sans peine à ce discours asséné de toutes parts, sans
honte ni remords tant le bien-être d’une majorité d’intégrés justifie tout, quitte à sacrifier
pour cela quelques minorités embarrassantes. Bien sûr il y eut des réactions. Un peu
partout individus et collectifs s’émurent puis s’indignèrent du sort fait à un voisin, un ami
ou un proche, des émeutes spontanées éclatèrent, une résistance plus organisée tenta de se
mettre en place mais ces soulèvements étaient prévus et les meneurs potentiels identifiés
par avance, si bien qu’en quelques semaines tout élan de contestation fut étouffé sans
ménagement loin de micros et caméras trop occupés à répandre la propagande officielle.
Trente ans après les faits, à force de dissimulation, de manipulations de la part des
oligarques qui s’emparèrent du pouvoir, le souvenir de cette mise à l’index ne perdure que
par ouïe dire, la plupart des intégrés ne connaissant ni les causes ni les faits précis qui
constituent ce que l’on nomme depuis avec pudeur les événements. D’ailleurs aujourd’hui
le sujet est clos car tout est bien en ordre, maîtrisé : sous contrôle. Dans le système établi
depuis lors, les citoyens actifs et solvables forment une majorité d’individus que l’on dit
intégrés.
Pour conserver son statut, pour prétendre à un logement, avoir accès à l’énergie, aux
soins et aux formations un intégré doit échanger neuf heures de son temps par semaine.
C’est un minimum. On peut bien sûr vendre plus de temps pour recevoir plus de ¥€$, ce
qui permet de consommer plus. Car il est devenu obligatoire de consommer. La somme à
dépenser chaque jour est variable et définie en fonction du revenu, à titre dexemple, une
intégrée qui travaille vingt heures par semaine reçoit en échange une somme allant de 150
à 310 YE$ suivant sa qualification et chaque jour qui passe elle devra en dépenser un
dizième soit 15 à 31 ¥€$. C’est ainsi que fonctionne la mécanique impeccable qui permet à
chacun de profiter seul de ce que l’ensemble produit. Tout est d’ailleurs organisé au mieux
pour que la vie des intégrés soit agréable : il leur suffit de travailler pour pouvoir
consommer, pour être heureux et avoir confiance, ce qui les stimule pour travailler encore
afin de consommer plus. Ils passent ainsi leur temps à dormir pour travailler, travailler
pour consommer, consommer pour dormir puis ils se lèvent à nouveau pour travailler et
ainsi de suite.
Cela laisse peu de temps pour penser et très peu d’intégrés s’interrogent sur ce qui
se passe en dehors du réseau global. Quelques vieux, qui conservent encore intacte la
mémoire des faits datant d’avant les événements racontent, ou plutôt murmurent en
famille ou en confidences, qu’une mutation se serait opérée dans la population à cette
même époque quand la culture de marque avait définitivement pris le pas sur la culture
populaire. Les mythes anciens, usés et vidés de leur sens étant remplacés par des
fantasmes modernes et rutilants, l’inconscient collectif en fut affecté ; à mesure que les
idoles de plastique s’animaient toujours plus vraies sur les écrans, les rêves se changèrent
en compilations désordonnées de pubs mêlées d’infos, de télé-réalité et de réelle illusion et
cela avait peu à peu fini par modifier les comportements. La transformation entamée alors
est maintenant presque achevée : le marché est parvenu à remodeler, à coup de stimuli
artificiels, les différents groupes humains en régiments de consommateurs pressés de vivre
comme leur commande leur uniforme.
Pour s’en convaincre on peut observer la nouvelle génération, qui n’a appris qu’une
chose essentielle : respecter les marques prestigieuses, mépriser la concurrence et les sans-
marque, être soi-même affublé du bon look pour être admis dans le bon groupe. Le ton à
employer, le vocabulaire, les gestes autorisés ou non : tout cela dépend de l’insigne que l’on
porte sur la poitrine, dans le dos ou bien encore au revers de cravate. Chaque mois qui
passe voit de nouvelles tribus anticonformistes se former par affinité économique, elles se
développent grâce à la publicité puis fonctionnent en autarcie, soucieuses de ne pas être
confondues avec une tribu-marque équivalente. Leurs membres se reconnaissent à l’allure
qu’ils se donnent et finalement, le week-end, tout le monde se retrouve dans les principaux
centres commerciaux du pays pour une grande messe de la consommation.
Gabrielle ne connaît que ce grand marché. Elle a grandi dans cet âge d’or qui voit le
monde civilisé enfin en paix, vivant dans l’harmonie des richesses partagées, des flux
circulant d’un bout à l’autre de la planète approvisionnant chacun pourvu qu’il soit intégré.
Il n’empêche que cette vie rêvée, qu’on lui offre depuis toujours comme la vie tout court, lui semble par moments aussi factice que vide de sens. Le cirque social et ses figures imposées l’inquiètent d’ailleurs depuis longtemps. A l’école déjà il arrivait que ses amies jouent à être des stars, adulées par une foule en délire. Elles se trémoussaient en jupe courte, chantant à tue tête les tubes du top quand Gabrielle mimait les gestes maternels, étudiait les plantes aromatiques et recherchait dans les romans les mécanismes d’un amour cosmique.
Cela faisait rire les autres, filles ou garçons ; ils se moquaient d’elle, la considéraient comme une demeurée, une simplette qui n’avait d’autre ambition que de fonder une famille et vivre heureuse avec un homme. Eux se vantaient de devenir footballeur, mannequin ou président. Tous seraient aimés, riches et célèbres sans aucun doute, ils s’entraînaient dés leur plus jeune âge à mépriser les gens ordinaires : ceux qui demain devraient les rendre millionnaires. Gabrielle pouvait bien arguer que s’ils devenaient tous des têtes d’affiches il ne resterait plus personne pour aller voir les films, mais ce genre d’argument est d’une portée bien dérisoire face à l’ambition monstre qui anime une jeunesse manipulée.
Plus tard, elle refusa encore de céder à la facilité alors que ses impayés de loyer
s’accumulaient. Elle avait eu la naïveté de se confier à son formateur, chargé de
l’accompagner dans son stage en entreprise et ce dernier n’avait eu de cesse d’essayer de la convaincre de se déshabiller pour lui et pour tout ceux qui pourraient profiter et se réjouir de son corps si elle acceptait de se faire photographier. Elle lui avait tenu tête pendant toute la durée du Séjour Formateur in Situ ; cette résistance avait sans doute diminué sa note globale, mais au sortir de l’école lorsqu’au vue de ses résultats on lui avait donné le choix entre un poste de journaliste stagiaire à la télévision et un autre de biographe public attaché à une mairie de quartier, cette expérience avait aussi entamée un peu plus la confiance déjà relative qu’elle avait en ses semblables.
Si bien que Gabrielle avait laissé le soit disant bon plan à d’autres pour s’installer
seule dans ce modeste bureau. Depuis, son travail consiste à recueillir la mémoire
collective, les histoires individuelles ou familiales que l’on peut venir, sur rendez-vous, lui
confier, cela se fait dans cette petite pièce reléguée du côté nord de la cité administrative.
Personne ne lui donne d’ordre, ni ne vient troubler ses initiatives et si la fonction n’a rien
de prestigieux aux yeux de la plupart des intégrés elle lui convient à merveille car elle lui
laisse de longues plages de tranquillité pendant lesquelles elle prend plaisir à ouvrir cette
fenêtre pour regarder dehors. C’est là, du haut de cette tour d’ivoire que Gabrielle tente de
comprendre ce monde dans lequel elle vit bien malgré elle ; elle observe, médite et jette
finalement sur ses contemporains un regard critique qui pourrait rendre ses propos
subversifs sils étaient propagés ; pourtant ce discours se déverse et se perd dans les
méandres d’un éternel monologue interne.
Car à vingt-sept ans Gabrielle reste une jeune femme solitaire et rêveuse. Une des
rares choses dont elle soit sûre c’est qu’elle ne conçoit pas de choisir un compagnon en
fonction de sa garde-robe, de son cursus scolaire ou de son porte-monnaie. En même
temps, elle se demande si elle peut espérer vivre autre chose, autrement, avec un homme
qui ne ressemble pas à un clone de magazine : bronzé, musclé et tatoué, affublé de tous les
signes censés garantir son pedigree. Pour rien au monde elle n’acceptera d’associer ses
chromosomes avec l’un d’eux car elle pense qu’il est encore possible de rencontrer un
personnage simple et aimable qui saura la faire rire sans moquerie ni grossièreté. Un
homme capable de construire sa maison, de cultiver son jardin, qui aime la nature mais à
pied, qui sait être lui-même et n’a rien à prouver à quiconque. Gabrielle se sait faite pour
une vie simple, archaïque, sans fard ni fadaises et elle souffre, en fin de compte, d’être née
au beau milieu d’un théâtre absurde qui n’accepte en son sein que ceux qui jouent un rôle.
Dans un geste d’agacement elle referme la fenêtre puis file s’asseoir à son bureau.
Souvent Gabrielle doute de cet amour magique, de cet être singulier lié à elle par nature.
Elle se sent vieillir et il lui arrive d’avoir peur, peur de finir seule, peur de s’être trompée,
d’avoir cru en un bonheur qui n’arriverait jamais, de ne pas avoir d’enfant ou pire, de
devoir vivre cette vie idiote qu’elle dénonce et qu’elle fuit, refusant de s’engager. Comme
pour chasser cette sinistre perspective, Gabrielle se remet au travail. Elle ouvre un classeur
volumineux duquel des notes fusent : ce sont des comptes-rendus d’entretiens, des papiers
jaunis, des photos sans couleur qui jaillissent du carton.
Son rôle de biographe consiste à combiner ces éléments qu’on lui confie à ceux
qu’elle recherche, pour rédiger à partir de ces matériaux le récit d’une vie. Ensuite le
résultat est soumis à l’appréciation du commanditaire ou de sa famille, et puis toutes les
données sont compilées et conservées : elles alimentent un espace commun créé sur le net
pour pallier à l’abandon de la transmission orale. Gabrielle passe ainsi une partie de son
temps de travail à écouter et enregistrer des histoires, des faits glorieux ou vils, vrais ou
fantasmés rapportés par des individus qui souhaitent donner un sens de plus à leur
existence en alimentant la réalité, en permettant à d’autres de tirer enseignement de leurs
expériences. Ils peuvent se présenter en fin de vie pour faire un bilan, parfois fantaisiste,
de leur parcours aussi bien qu’à vingt ans pour exprimer leurs rêves et faire des prophéties.
Dans cet exercice d’auto-définition certains découvrent parfois que leur propre vie trace
une histoire inédite digne d’intérêt, histoire jusque là masquée par le ballet d’ombre des
Bio-Neuro Mass Media.
Le lendemain matin elle arrive tôt car son agenda prévoit deux entretiens avant
midi. D’abord elle prépare un thé qu’elle boit debout devant la fenêtre ouverte, nous
sommes en mars et déjà, il fait une chaleur lourde qui abrutira cet après-midi sur le bitume
l’inconscient promeneur. Les arbres peinent pourtant à verdir, même la saponaire qu’elle a
installé a sa fenêtre est jaunie Gabrielle l’arrose un peu, flatte ses rameaux puis se penche
doucement vers le spectacle de la rue lorsque la sonnerie de l’inter annonce son rendez-
vous. Chaussant ses lunettes elle regagne alors son siège et crie « Entrez ! »
Après deux heures d’écoute, après avoir raccompagné jusqu’à l’escalier de bois le
petit homme chauve, venu lui narrer sa carrière de boulanger Gabrielle profite de quelques
minutes de battement. Après une réussite exemplaire à la fin du siècle dernier, le brave
homme avait vaillamment refusé d’emprunter les ponts d’or offerts par la direction d’une
usine d’enfarinés pour continuer seul dans sa petite boutique à faire du bon pain.
Aujourd’hui il est content et même fier de celui qu’il a formé pour prendre la suite mais il
s’ennuie de tout ce temps, nouveau pour lui, alors en entendant parler de ce service de
biographe il a eu l’idée de prendre rendez-vous car il était persuadé en divulgant ses
recettes sur le net de jouer un tour fatal et définitif aux techniciens-en-pâtes-alimentaires-
à-cuire...
Sur le palier l’attend sa deuxième patiente de la matinée : une adolescente brune et
pâle qui semble intimidée. Pour l’aider à se détendre Gabrielle l’invite à entrer puis lui
propose un thé que la jeune fille refuse du bout des lèvres. Sans lever la tête elle lâche :
« - Vous devez vous demander ce que j’ai à dire. En principe il n’y a que des vieux non ?
![]() Et bien … Vous n’êtes pas la plus jeune qui soit venue me voir, répond Gabrielle. Une fois
Et bien … Vous n’êtes pas la plus jeune qui soit venue me voir, répond Gabrielle. Une fois
c’était pour envoyer des messages à la planète entière : un fan de cette chanteuse indienne
qui se fait appeler Bhairavi. Une autre est venue quelques fois avant que je lui conseille de
tenir un journal intime. Peut-être puis-je vous aider mademoiselle ?
![]() C’est que... je voudrais enregistrer mon testament. » Gabrielle noie un sourire dans sa
C’est que... je voudrais enregistrer mon testament. » Gabrielle noie un sourire dans sa
tasse et reprend.
« - Ton testament.
![]() Oui, je suis sûre de disparaître bientôt et il faut que je facilite la tâche à mes parents. Ils
Oui, je suis sûre de disparaître bientôt et il faut que je facilite la tâche à mes parents. Ils
ne comprennent rien, je ne veux pas qu’ils fassent nimporte quoi. J’ai besoin de tout noter
avant ma mort, pour qu’ils n’aient rien à faire, pour ne pas les ennuyer. Et pour ne pas
qu’ils fassent de bêtises … Oui, c’est ça. Si je ne veux pas être découpée pour la science mais
brûlée et dispersée aux quatre vents, il faut bien que je l’écrive non ? Et j’ai des affaires à
partager, des livres, des cassettes …
![]() Mais je ne suis pas notaire.
Mais je ne suis pas notaire.
![]() Ah ! … Je dois aller voir un notaire … ?
Ah ! … Je dois aller voir un notaire … ?
![]() Non, il se moquerait de toi, tu nes même pas majeure.
Non, il se moquerait de toi, tu nes même pas majeure.
![]() Mais, mais comment faire alors ? Comment se préparer à tout ça, je ne veux pas que ce
Mais, mais comment faire alors ? Comment se préparer à tout ça, je ne veux pas que ce
soit le bordel moi !
![]() Du calme. Qu’est-ce qui te fait dire que tu vas disparaître bientôt ? ... Parle voyons,
Du calme. Qu’est-ce qui te fait dire que tu vas disparaître bientôt ? ... Parle voyons,
comment sais-tu cela ?
![]() Je ne sais pas … C’est que je n’ai nulle part où aller. Je ne sais jamais dire quel métier je
Je ne sais pas … C’est que je n’ai nulle part où aller. Je ne sais jamais dire quel métier je
ferai plus tard, et puis j’ai pas d’amis. Je pense que si je wai rien à faire c’est que je vais
disparaître. Peut-être que mon destin est bloqué, je n’irai pas plus loin. De toute façon je
m’en fous parce que tout est nul.
![]() Je vois. Et tu penses que le simple fait de rédiger ton testament suffira à provoquer ta
Je vois. Et tu penses que le simple fait de rédiger ton testament suffira à provoquer ta
mort … ou tu as d’autres plans.
![]() Je veux juste me préparer au pire, au Cas Où.
Je veux juste me préparer au pire, au Cas Où.
![]() Bien. Si tu veux, on peut écrire ensemble ta biographie. » La jeune fille rougit, puis sourit,
Bien. Si tu veux, on peut écrire ensemble ta biographie. » La jeune fille rougit, puis sourit,
moqueuse.
« Vous vous fichez de moi ? J’ai seize ans, que voulez-vous que je vous raconte ? Ma
première cuite ? Mes vacances à Grand-Plage ?
![]() Vas-y, je t’écoute. »
Vas-y, je t’écoute. »
Et l’ado alors se lance, s’élance dans cet espace qu’elle a ouvert et qui couvre ces
seize dernières années. Plus tard, bien plus tard, quand elle aura franchi cette étape qui
fera d’elle une adulte, quand elle aura fait sa vie et qu’elle aura vieilli, si les données sont
toujours accessibles elle relira avec joie ce que Gabrielle note à toute vitesse, peinant à
suivre le rythme de la jeune fille. Lorsqu’elle s’arrête enfin, celle-ci paraît épuisée et
lointaine, mal à laise comme si elle s’éveillait dans un lit inconnu ; bredouillant quelques
excuses ou remerciements elle se lève pour partir lorsque Gabrielle la retient.
« Attends un instant. C’est vrai ... commence-t-elle. C’est vrai que les jeunes ont du mal à
s’attribuer un rôle dans cette société. Ils naissent et déjà doivent se comporter comme il
faut pour ne pas déranger les adultes ni gêner le bon fonctionnement de l’ensemble ! »
La jeune fille rougit encore un plus et lui sourit.
« Reste un instant si tu veux, dit Gabrielle. Cela me donne l’occasion pour un fois de ne pas
raisonner seule. » Un hochement de tête en guise de réponse suffit alors à la lancer dans
une attaque en règle contre le système éducatif. « Il me semble … il me semble bien, que
tout commence tôt. On vous prend d’ailleurs en charge très tôt, on vous forme sans jamais
vous demander votre avis. Personne ne cherche à savoir qui vous êtes, quels sont vos rêves,
par contre, poursuit-elle en grondant, si à douze ans certains ne savent ni lire ni écrire
assez bien pour comprendre un texte, vous savez tous remplir un bon de commande. Car
c’est bien à consommer que vous êtes tout d’abord initiés ! »
Le ton réprobateur qu’emploie Gabrielle effraie la jeune fille qui tente de disparaître
un peu plus derrière ses mèches.
« Pour faire naître en vous le désir d’être utiles et de participer à la société on vous
offre des jeux et des activités : activités domestiques ou de service pour les filles et pour les
garçons jeux de pilotage virtuel et de combats sanglants. Plus tard quand ils seront grands,
ces mêmes gamins pourront piloter de vrais bolides mais il leur faudra alors travailler pour
payer les traites et augmenter les crédits. Et pour se payer plus d’activités, plus d’émotions
et plus de sensations ils seront encouragés à en faire plus, à donner le meilleur d’eux-
mêmes, à être combatifs et volontaires ; ils devront céder toujours plus de leur temps pour
recevoir en échange toujours plus de ¥€$ afin de multiplier les achats, augmenter les doses
et parvenir chaque fois à des extases … toujours plus fortes.
« L’adolescence est un cap fatidique, poursuit Gabrielle sans même consulter son
interlocutrice. Soit enfant comprend qu’on l’a bluffé, qu’on lui a menti jusque-là et il se
rebelle, soit il découvre que lunivers de plaisirs auquel il avait accès jusqu’à présent était
bien restreint et alors il se lance à corps perdu dans la consommation, dans la jouissance
immédiate. Mais cette vie rêvée, facile et confortable n’est pas sans contrepartie : pour
assouvir son vice il doit se procurer des YES et pour cela il doit vendre au système son
temps, son corps vivant et tout ce qui va avec ! »
Gabrielle est maintenant debout. Tout en martelant ses phrases des quelques pas
qu’elle peut faire dans la pièce, elle harangue avec fougue une foule invisible toute acquise
à sa cause. Seule une jeune fille dans le fond la regarde éberluée et réfléchit au meilleur
moyen de quitter le meeting discrètement.
« De toute façon, reprend-elle, une fois sorti de l’environnement protégé de la famille, de
l’école et des formations le jeune adulte découvre vite qu’il ne sait rien faire d’autre que le
travail hyper spécialisé auquel on l’a destiné. Il ne sait ni construire un meuble, ni cultiver
ses légumes, il ne sait pas coudre ni réparer sa voiture, il doit faire appel pour toutes ces
choses simples à d’autres spécialistes et se contenter d’exercer l’activité qui lui permet de
payer ces spécialistes. Et je vous le demande, insiste-t-elle :
Comment ne pas comprendre cette jeune fille ! — qui se fige sous l’apostrophe —
lorsqu’elle doute et renâcle à se plier à ce fonctionnement idiot qui condamne être
humain à restreindre ses capacités, à nier ses dons et ses qualités pour passer dans les bons
formats. Comment peut-on parler dans ce cas de liberté ? Comment peut-on être à ce point
asservi et dans le même temps se targuer de représenter l’idéal de l’humanité éclairée, se
poser comme unique représentant et défenseur du monde libre ? Mais je m’égare ! »
finit-elle par admettre. A nouveau assise à son bureau Gabrielle termine, un ton plus bas :
« Je n’aime pas mon époque, c’est pour cela que je préfère rester discrète, vivre en retrait le
temps qui m’est imparti. Je regrette l’hypocrisie et le cynisme d’un peuple, mon peuple, qui
s’est lancé à l’assaut de la matière pour la dominer, qui n’a de cesse depuis des siècles de
fantasmer sur la technique et ses bienfaits, qui combat la nature au nom de la raison et qui,
voyant les dégâts que cause cette folie minimise et masque la vérité ; c’est sûr que si nous
devions admettre aujourd’hui que cette voie ne conduit nulle part il faudrait aussi revenir
sur tous les crimes et les sacrifices exigés depuis pour avancer.
Ceux qui pilotent ce progrès préfèrent continuer encore plutôt que de reconnaître
enfin le massacre des amérindiens, des indiens et des aborigènes, la destruction massive
des biodiversités végétales et animales, la pollution de la planète, l’esclavage, la
colonisation et l’hégémonisme culturel occidental, l’impérialisme économique et le pillage
des ressources naturelles sur lesquels ce progrès s’est construit. Niant la portée de leurs
actes ils promettent encore à qui veut les croire que l’avenir radieux est pour bientôt et
pour tous, à condition bien sûr que l’on suive encore la route droite et propre qu’ils nous
font construire à travers une nature qu’ils qualifient d’hostile et sauvage nous
convainquant d’élever de tous côtés des grillages pour nous protéger de ses mystères, pour
nous empêcher de nous y aventurer car nous pourrions nous y égarer, nous y perdre …
Mais comment peut-on encore leur faire confiance ? Comment peut-on encore
accepter de participer à un projet si grotesque, si inconscient, porté par des gens qui
méprisent la nature, qui méprisent l’autre et sont égocentriques comme on pouvait être
autrefois géocentrique ou anthropocentrique ? »
L’adolescente a fini par s’éclipser. Gabrielle paraît maintenant triste et démunie, à
nouveau elle reste seule à formuler sa révolte. « C’est sans doute l’ignorance qui est la
cause de tout ; ou tout du moins la curiosité, l’attention et la compréhension qui peut-être,
peuvent mener à la paix. Hélas, si le gouvernement des hommes et de la cité demande de
l’abnégation, de la compassion, des connaissances en différentes matières, du
détachement, du désintérêt pour les affaires et surtout le goût de la vérité, ces qualités sont
écartées aujourd’hui au profit d’une bonne présentation, d’une diction claire et martelée,
d’un attachement aux valeurs quantifiables et d’un intérêt pour l’économie de marché. Les
gouvernants ne sont plus visionnaires ni poètes, ils gèrent le bien public.
Le projet commun n’est ni révolutionnaire ni utopique, il s’efforce de satisfaire la
majorité sans trop froisser les minorités. En définitive, la grande entreprise occidentale
consiste à transformer les matières premières naturelles en produits de consommation,
pour que chaque intermédiaire puisse vivre de ce trafic. A un bout de la chaîne il y a des
ressources épuisables qu’il faut gérer et distribuer à chaque contingent de travailleurs, à
l’autre il y a des consommateurs qu’il faut séduire ou manipuler pour qu’ils absorbent en
rythme les articles fabriqués. Ceux qui travaillent sont ceux qui consomment et vice-versa,
d’autres supervisent le tout et en organisent les flux. Et ces aiguilleurs omnipotents
disposent à leur convenance non seulement de la matière, de l’énergie et de l’espace
disponibles sur cette Terre, mais aussi du temps de celles et ceux qui la peuplent. Ils
peuvent bien négocier et lâcher du lest s’ils y sont contraints, mais pour rien au monde ils
ne renonceront au privilège divin de contrôler une planète quand leurs prédécesseurs se
contentaient d’un fief ou d’un royaume. »
Un instant elle reste suspendue, comme perdue dans l’écho de sa phrase puis son
regard glisse doucement jusqu’à accrocher un titre dans le journal du matin :
Des surfaces sacrifiées
Une enquête révèle le taux de rentabilité du mètre carré dans la capitale : deux secteurs
sont épinglés.
En comparant la surface occupée par une activité et les profits qu’elle dégage, on arrive à
de biens curieux résultats. Ainsi, c’est la banque de courtage télétop qui emporte la palme
avec près de 170 millions de ¥€$ de bénéfices annuels, pour un espace de travail limité aux
227 m2 entièrement dédiés aux cerveaux électroniques les plus puissants de leur
générations. Sur cette toute petite surface en plein quartier moderne, on traite chaque
année 2,3 milliards d’opérations diverses, qui concernent les quelques 84572324 clients de
cette banque. C’est le record absolu en matière de rendement à la surface.
En fin de tableau on trouve deux secteurs publics : les bâtiments municipaux et les ateliers
populaires. Tous deux génèrent des profits ridiculement bas comparés aux surfaces qu’ils
utilisent. Il faut en effet savoir que près de 34% de la surface totale de la capitale est encore
propriété d’Etat. Malgré le très net besoin d’extension des domaines résidentiels et
commerciaux, des milliers de mètres carrés sont encore voués à des activités qui perdurent
par habitude plus que par réelle nécessité. La question sera d’ailleurs abordée en conseil
municipal, où l’on devrait discuter d’un remaniement spatial dans les mois à venir.
les minima
« Quelle connerie ! Mais quelle connerie ! »
Falières relit la lettre et ne peut s’empêcher de jurer. « ’tain mais c’est pas vrai,
qu’est-ce qu’il leur prend, ils ont pété les plombs ou quoi, c’est nimporte nawak ! » Un
silence tendu règne dans le bureau. La lettre passe de main en main, chacun la lit ou la
survole mais tous savent ce qu’elle contient. « Qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on fait,
qu’est-ce qu’on fait ? Quelqu’un a une idée ? La presse, on a qu’à prévenir la presse ; ils
oseront pas nous virer devant les caméras ... Mais elle s’en fout la presse … Elle fera un
sujet bidon qui passera inaperçu et puis basta ! On peut quand même passer quelques
coups de fils. Vas-y si tu veux mais ne t’attends pas à un miracle : va falloir qu’on se
démerde. »
La petite troupe sort pour laisser Hélène et Ludo téléphoner. Dans le couloir
attendent déjà des peintres et des comédiens qui ont cessé leur travail dès que la rumeur
d’une mauvaise nouvelle arrivée ce matin par la poste eut fait le tour des ateliers, alors,
devant l’inquiétude et la curiosité de chacun, pour calmer les commentaires et les injures
montantes Yvan décide de livrer le courrier en assemblée. « Allons dans la salle blanche : je
vous lis ça vite fait, annonce-t-il avant de plonger vers les escaliers de marbre de l’ancien
grand hôtel. Deux étages plus bas, il déboule dans le hall avec une horde débraillée et
hurlante aux trousses : le vacarme étant destiné à avertir le collectif que quelque chose se
passe qui concerne tout le monde. En bas leur arrivée effraie un peu les visiteurs venus
chiner les expos, puis finalement ils applaudissent. D’un geste engageant appuyé par une
mimique de comploteur Yvan les invite à les suivre, il attend quelques instants que tout le
monde s’installe puis commence :
de : la mairie à : l’association ‘ L’étendard populaire ‘
Le 08 juin
Objet : Réaménagement du quartier des Tiers.
« Je viens par la présente vous faire état de la décision prise par le dernier conseil
municipal. Dans un souci d’amélioration de plan d’occupation des sols du quartier, nous
envisageons la création d’un axe entièrement dédié aux transports en commun reliant
l’avenue du Commerce à l’esplanade des Regards. Il ne vous échappera pas que le tracé
prévu scinde en deux le bâtiment que vous occupez et qui accueille aujourd’hui les Ateliers
Populaires. Nous sommes donc contraint de récupérer ce local municipal qui sera
réhabilité. Toutefois, pour que ne disparaisse pas un lieu de création artistique si prisé de
nos concitoyens, nous vous proposons un relogement dans un espace qui reste à définir.
La première tranche des aménagements du quartier étant prévue pour novembre de
l’année prochaine, nous espérons que ce délai de cinq mois sera suffisant pour organiser
votre déménagement. Je reste à votre disposition pour envisager avec vous un relogement
dans les meilleurs conditions possibles, et vous prie de recevoir dans l’attente, mes plus
sincères salutations.
signé : Monsieur Le Blaze, conseiller du maire aux affaires culturelles. »
Un tollé ponctue la fin de la lettre. « Ils nous prennent pour des cons ! On va pas se
casser comme ça ! Et puis c’est quoi ce plan de relogement dans un espace à définir ?
Comme si le métro et les bus ne suffisaient pas à desservir les Tiers, c’est un prétexte ! »
Les Ateliers Populaires dont il est question, sont des espaces publics dans lesquels
les intégrés peuvent venir consacrer un partie de leur temps libre à une activité artsistique.
Il en existe plusieurs en ville dans différents quartiers et chacun est dédié à un domaine
particulier : arts plastiques ou numériques, musique et danse, théâtre, …
Celui des Tiers ne se distingue pas tant par sa spécialisation que par ses utilisateurs
et son fonctionnement. Car son existence remonte à la création même des ateliers
populaires, elle est liée à la lutte qu’il avait fallu mener alors pour que l’état consente à
céder des espaces dans lesquels pouvaient s’organiser librement des activités extra-
salariales. De cette époque il reste quelques traces, comme une auto-gestion relative du
lieu, et surtout, une population d’usagers solidaires et complices composée
presqu’exclusivement de minimas. On appelle ainsi celles et ceux qui ne travaillent que les
neuf heures hebdomadaires requises pour conserver le statut d’intégré.
Faire partie des minima peut-être vécu comme un handicap car cela revient à se
tenir en équilibre précaire sur le dernier barreau de l’échelle sociale et celles et ceux qui
subissent cette situation sont souvent prêts à tout pour décrocher un job quelconque de
quelques heures qui repoussera d’autant l’instant fatidique de leur relégation hors réseau.
Cependant, une minorité parmi la minorité des minima voit les choses autrement. Soit
parce que ces individus préfèrent ne pas servir un système perçu comme injuste et
destructeur, soit parce qu’ils ont la vocation, le goût de créer, qu’ils se sentent animés d’un
feu intime et autrefois sacré qui les jette sur les chemins d’une quête impérieuse et
singulière, ceux là délaissent sans regret le confort matériel et la reconnaissance sociale
pour passer leur temps à peindre, jouer, rêver, étudier ou sculpter : ils suivent alors leur
propre voie, leur propre évolution. Ils sont ainsi quelques dizaines à venir chaque jour dans
cet immeuble que la mairie souhaite maintenant récupérer, tous travaillant à des sous-
tâches ingrates qui les maintient dans le système et jouissant par ailleurs d’une liberté de
temps qu’ils occupent volontiers à de menues recherches et distractions qui donne à leur
vie un semblant de sens, et les tient éveillés. Il ne faut pas croire que la société accepte
facilement un tel lieu, autogéré par des usagers qui refusent de participer à l’effort constant
qu’elle réclame pour perdurer ; il a fallu que ces espaces non productifs soient gagnés,
préservés de justesse à la voracité des plus-values, cela s’obtint par la lutte et cela prit du
temps.
L’histoire des Tiers’At : les ateliers du quartier des Tiers, a débuté dans une usine
désaffectée proche du centre dont les hangars abandonnés étaient à ce moment là occupés
par des clandestins, non-intégrés et clochards pour qui le lieu était un refuge, une planque,
un abri. Une bande de plasticiens, en rade d’atelier pour travailler à l’aise, s’installèrent
d’abord dans un coin, amenant avec eux toiles et chevalets, de la matière et des idées. Ils
étaient jeunes, animés d’une furieuse envie de refaire le monde et comptaient mener dans
ce lieu propice les expérimentations préalables. D’abord ils aménagèrent l’espace
disponible en un vaste atelier collectif puis l’idée d’ouvrir le lieu au public pour des expos,
concerts et performances s’imposa.
D’autres artistes venus du théâtre de rue, de la danse et de l’électro vinrent les
rejoindre jusqu’à ce que doucement, l’endroit évolue de squatt dur en une fabrique
expérimentale dans laquelle se tissaient à l’envie histoires personnelles et aventures
créatrices, sans cadre formel ni hiérarchie. Dans cet état d’invention, de réaction
permanente qu’ils entretenaient, chaque instant était dense et plein. Le temps pouvait bien
filer, chacune de ses minutes résonnait juste et en écho lavenir se fabriquait tout seul sans
angoisse, nourri de toutes parts par les vivants qui vivaient là ou passaient pour participer.
Ce qui s’y faisait n’avait lieu qu’une seule fois car c’est bien ainsi que se déverse la vie : en
torrent, sans retours ni redites. Et tant d’intensité conjuguée finit par rayonner, attirer du
monde. Cette spontanéité devenant rare, partout le professionnalisme froid et rationnel
gagnant du terrain, le côté amateur, système D et bidouilles que ces sauvageons adoptaient
suscita la sympathie. Sans publicité ni tapage l’endroit devint peu à peu un lieu de rendez-
vous pour rêveurs et noctambules, grandes gueules et vrais pirates. On y croisait aussi bien
la crème acide de la gauche que les extrêmes restes de la punk attitude qui s’encanaillaient
ensemble dans des vernissages-expos-concerts-performances dé-cousus, mais toujours
réussis.
Puis cette période sauvage et débridée où la folie et l’inspiration chamanique menait
la danse s’estompa, pour laisser place à plus de maturité, plus de gravité aussi. Car pour
durer les autonomes devaient s’organiser. Plutôt qu’attendre et devoir se défendre, ils
décidèrent de porter sur la place public les espoirs insoupçonnés ou ignorés que leur
initiative avait suscité et pour cela ils fondèrent un collectif et rédigèrent un projet. C’était
le seul moyen pour eux de continuer l’aventure même si cela les obligeait dorénavant à
s’approcher des côtes civilisées, à naviguer en eaux troubles et mettait leur frêle
embarcation à portée de tir des canons impeccables de la norme. Ce projet est comparable
à une immense installation, un collage collectif composé de l’univers singulier de chacun
des participants dans lequel la mise en commun des énergies individuelles pour créer
ensemble un courant novateur, devient la démarche et l’oeuvre elle même.
Ainsi la quête de l’espace public et politique dans laquelle ils s’engageaient n’était
que la revendication émergée d’une réflexion plus diffuse qui visait à démontrer que la
société elle aussi est multiple, et qu’en réaction à la lente uniformisation rassurante à
laquelle on assistait il restait encore quelques îlots de résistance où les particularismes
pouvaient s’exprimer et produire du sens ensemble. Et le fait que ce soit des minima qui se
chargent de porter cette idée n’est pas anodin. Car si le système tolère que certains
individus ne participent au théâtre social qu’en service minimum, l’étape suivante consiste
à accepter que celles et ceux qui font ce choix sont autre chose que des fainéants ou des
incapables. On peut décider de réserver l’usage de son temps et l’emploi de son énergie à
d’autres fins que la production de richesses. L’étude, la réflexion, la recherche personnelle,
la création, l’invention, la composition sont autant d’activités gourmandes en temps et peu
productives qui pourtant nourrissent la société d’une substance bien plus primordiale que
la publicité, la révélation médiatique, les serments politiques ou l’exhibitionnisme
télévisuel.
Mais il faut peut-être du temps pour comprendre cela : ce temps dont seuls les
minima disposent. En revendiquant l’existence d’ateliers de création ouverts à toutes et
tous, en centre ville, des lieux dans lesquels évoluer à son rythme et se concentrer sur des
activités non soumises à résultat, des lieux d’échange de savoirs et de compétences, de
rencontre entre artistes, entre artistes et publics, entre publics, des espaces préservés de la
compétition, les artistes enthousiastes et déterminés s’’embarquaient dans un ambitieux
projet, difficilement défendable devant les décideurs-en-cravate quand il est porté par des
non professionnels de la profession, des individus réservés et hirsutes qui n’ont pas suivi le
stage qualifiant approprié ni même obtenu au préalable la licence d’organisateur de
spectacle.
Lorsqu’ils envoyèrent leur prose aux institutions concernées la réponse fut
immédiate : les hangars qu’ils occupaient furent rachetés et détruits jusqu’à ce qu’il ne
reste plus de leur utopie pirate qu’un seul bâtiment, trop étroit pour contenir l’énergie
générée. Par la fenêtre, les bidons à grillades, le mobilier de récup et les murs peints
avaient été effacés pour être remplacés par le nouveau décor d’une résidence surveillée,
sécurisée par son mur d’enceinte coloré d’un joli parement de briquettes roses. Ils durent
se résoudre à partir mais cela n’entama pas pour autant leur fougue ; et pendant les
quelques années qui suivirent un véritable ballet se jouait sur la place public, relayé par des
médias gourmands de rebondissements : il suffisait que le collectif s’installe dans un lieu
vide pour que le propriétaire débarque et réclame son bien. L’occupation durait le temps
d’un procès, dont l’issue était jouée d’avance puisqu’aux yeux de la Loi il est un principe
qui prévaut sur la liberté de création ou le droit au logement, un principe sacré par-dessus
tout : celui de la propriété privée. Le jour même de l’expulsion les artistes partaient en
convoi bruyant et festif vers un nouveau lieu, tout aussi vide de toute vie. Ils y déballaient à
nouveau leurs cartons, reprenaient le travail en cours, vivaient là leurs histoires quelques
temps, avant qu’un nouveau verdict ne les chasse. C’est pour faire monter la pression qu’ils
agissaient ainsi. Pour prouver publiquement qu’il existait bien en centre ville des
bâtiments prêts à accueillir de telles initiatives mais délibérément laissés en jachère par
profit.
Au fur et à mesure de ces : Expulsion ? Ouverture ! le collectif gagnait en expérience,
prenait de l’assurance, rayonnait et attirait à lui de plus en plus de sympathie ; finalement,
au bout de trois ans et autant d’occupations retentissantes, les décideurs locaux furent
contraints de lire le fameux projet et d’admettre que celles et ceux qui le portaient étaient
assez stables et organisés pour durer. La stratégie simpliste des commis d’office de l’état
table souvent sur un effritement des implications. Selon eux il semble acquis qu’une telle
cohésion, une telle énergie de groupe ne peut qu’être éphémère, vouée à sombrer
doucement avant même d’avoir pu enchaîner quelques pas malhabiles. Dans ce cas comme
dans d’autres, les personnalités locales de la culture et des petites affaires attendaient
patiemment que cette histoire anarchique s’étiole doucement, s’éteigne comme un feu de
paille pour ensuite venir sur ces cendres encore chaudes monter de toutes pièces un
complexe culturel qu’ils auraient pu baptisé Palais de Kyoto ou Centre d’art du quai des
Cèdres.
Bien entendu le génial projet aurait alors bénéficié de tous les soutiens nécessaires,
on l’aurait inauguré en grande pompe en déblatérant avec véhémence de l’intérêt sinon de
la nécessité d’offrir au bon peuple un lieu d’expérimentation et d’action artistique. Des
animateurs dûment formés auraient été chargé de distribuer des feuilles de couleurs et des
crayons à chacun pour que se libèrent enfin les énergies créatrices en un feu d’artifice de
formes et de matières, pour que le cadre et sa petite famille puissent venir là se prendre
pour des créateurs, tous les jours de 10 heures à 21 heures, sauf le lundi. On aurait confié la
gestion du lieu à une société d’économie mixte dans laquelle auraient pu siéger les
entreprises privées susceptibles d’être intéressées par le marché ainsi créé et chacun aurait
pu y écouler : qui ses stocks de peinture bon marché, qui son papier sans chlore, qui ses
outils multimédia. Dans un tel contexte les expositions n’auraient pu présenter que des
travaux réalisés sur place, de préférence de qualité médiocre afin que les autres utilisateurs
du lieu puissent se convaincre qu’il n’est pas bien difficile d’en faire autant. On aurait à
l’occasion invité des professionnels pour donner des leçons et le personnel encadrant
aurait pu être recruté au lance pierre parmi les déçus de Distrait-Land ou les étudiants des
Beaux-Arts.
Certains élus et leurs complices sont capables de tels détournements de bonnes
idées ; lorsqu’une une initiative menée par des non-initiés fonctionne il est tentant de la
torpiller pour ensuite la reprendre à son compte. Et un tel temple tout entier dédié à la
culture populaire peut faire fantasmer car c’est le genre de jouet qui peut être doté d’un
budget de fonctionnement pharaonique, d’une part car le bien être de la population le vaut
bien, d’autre part car les partenaires privés sont gourmands en subventions publiques
malgré leur discours libéral. Le gouvernement local associé à cette farce aurait même pu se
vanter de développer une politique culturelle ancrée dans la réalité et proche du quidam,
ce quidam qui vote et qui réclame. Mais le collectif entré en résistance était assez soudé et
inventif pour ne pas tomber dans les pièges d’une récupération si grossière.
Et de fil en aiguille arriva une époque charnière, l’époque de tous les possibles pour
un lieu de tous les possibles puisqu’il fallait élire un nouveau maire pour la cité. Les
électeurs, un peu distraits, découvraient parmi les prétendants au trône municipal un
parachuté venu de la droite, et un fils d’immigré venu de la gauche. Le premier, introduit
par le précédant maire pensait atterrir en douceur dans un siège douillet qui devait lui
servir de tremplin pour une carrière nationale. Le second, issu du milieu associatif faisait
figure d’extraterrestre annonçant à la population incrédule l’arrivée aux affaires d’êtres
venus d’un autre monde. Il fallait l’être motivé-e-s, pour tenter de porter la voix des
anonymes jusque dans la Salle des Illustres. Au centre de ce tableau dépassait la
moustache d’un homme de gauche, qui doit aussi être un homme de goût puisqu’il il
réussit au second tour à recomposer un espoir black, blanc, beur, rose et vert d’éviter le
parachuté.
Hélas ce fut finalement peine perdue. La logique conservatrice fut plus forte que le
rêve novateur et le paysage politique garda sa couleur, et sa fadeur. Néanmoins, deux mois
avant le premier tour des élections l’audace des artistes fut de taille et remarquée. Comme
des F.T.P. libérant leur capitale régionale, ils avaient cette fois-ci investi le siège — vide —
du gouverneur pour marquer le début d’une époque nouvelle. On aurait pu titrer cela
« Coup d’état artistique ! » ou « Les artistes prennent le pouvoir !? » mais la presse se
contenta de relater en gras la visite des politiques qui, en hommes de terrain, allaient à
tour de rôle au devant de ces nouveaux acteurs culturels pour écouter et promettre comme
ils l’avaient déjà fait et tel qu’il est d’usage en pareille circonstance électorale ; chacun
d’eux prit bien soin toutefois de ne pas s’égarer dans les couloirs de qui restait quand
même un squatt. Quelques heures à peine après l’ouverture des grilles du garage qui donne
sur la rue de Temz, l’ancienne préfecture s’était animée et les derniers mohicans de St-Cyp
avaient barré ferme le gouvernail pour accueillir à leur bord de nouveaux apaches, de
nouveaux artistes et d’autres chercheurs.
Depuis, le navire suit son cap bercé par le rythme régulier des soirées théâtre et des
scènes ouvertes, des apéro-vidéo et des projections de films, des après-midi spectacle pour
enfants, des expos et des vernissages, des week-end de concerts et de performances mixtes,
des préparations de manif et des soirées de soutien. Et même si ce n’est que depuis cette
dernière occupation très médiatique qu’ils ont acquis une certaine notoriété : gage de la
respectabilité nécessaire pour enfin négocier, c’est leur persévérance et leur ouverture sur
le monde qui a su au fil des années entretenir le rapport de force avec les autorités. Ne
cessant d’affirmer que leurs occupations n’étaient pas une fin mais un moyen de montrer
que la ville manque simplement d’espaces de liberté, le collectif avait toujours invité les
habitants à passer leur rendre visite ; et lorsque de très nombreux individus, très
différents, non seulement viennent mais affluent à chaque occasion, ces mêmes autorités
sont forcées d’admettre qu’il se passe quelque chose qui leur échappe, quelque chose
qu’aucun programme politique ne crée plus : l’engouement populaire, la faculté de faire
naître du rêve, de l’espoir. Et cela les trouble d’autant plus lorsque cela émane d’individus
non habilités, non formés, non destinés à cela. Alors qu’eux-mêmes passent de longues
années à étudier les mécanismes de ces sursauts populaires, alors qu’ils ont largent et le
pouvoir, la culture et le savoir, ils ont du mal à admettre que ce soit du peuple lui-même
que jaillissent ces joies spontanées, ces éveils de conscience.
D’ailleurs intrigué par la multiplication de ces cas d’autogestion réussie, le
gouvernement de l’époque avait dû se résoudre à demander une étude nationale sur le
sujet. Parce que l’histoire des Ateliers n’était pas isolée et peu à peu un réseau de soutien
mutuel s’organisait : il était temps que l’état assimile cette nouveauté s’il ne voulait pas se
voir dépassé par des initiatives anarchiques certes, mais bel et bien probantes. Un
émissaire éclairé s’est donc vu chargé par un ministre curieux de faire le tour de ces
nouveaux territoires de l’art. De ses enquêtes et observations in situ un rapport fut rédigé
dont voici un passage : « Les expériences étudiées sont d’une extrême diversité, par les
origines, par les modes d’organisation, par la présence des différentes disciplines
artistiques, par le rapport entretenu aux productions, aux populations, aux collectivités
publiques, aux marchés et, bien sûr, par la taille de chaque projet. Cette diversité est une
caractéristique et un attribut essentiel, qu’il convient non seulement de conserver mais
également de cultiver. Toutes ces expériences sont le produit d’un contexte local qui les
qualifie. Elles proposent des expérimentations qui ne sont pas des modèles alternatifs
globaux. » *
Il paraît que ce discours a ravi le secrétaire d’état au patrimoine et à la
décentralisation culturelle à qui le rapport était destiné. Son titre même annonçait le sort
réservé à ces friches, squats, laboratoires, fabriques et autres usines à vocation artistique :
si Cest dans un contexte local qu’elles s’inscrivaient, c’étaient bien aux collectivités locales
de s’en occuper. Le gouvernement s’ôtait ainsi une indélicate épine du pied en laissant le
soin à des commissions locales ad hoc de mener des négociations avec ces sécessionnistes
atypiques. Il évitait de la sorte tout débat de fond qui aurait pu défriser les brushing à
l’assemblée car il ne fut pas question de légiférer pour déclarer recevable, par exemple,
l’occupation temporaire ou définitive de bâtiments inoccupés, murés, délibérément rendus
inhabitables par leur propriétaire pour se les garder sous le coude en attendant que les prix
du mètre carré s’envolent.
Aucun débat sur le sujet ne fut même évoqué. On n’envisagea nullement non plus de
s’interroger, sur ce désir grandissant dans la population jeune de conserver l’usage de son
temps plutôt que de travailler et consommer. On préféra ignorer la révolution sociale qui
émergeait de ces gesticulations malhabiles et on refila le bébé aux acteurs locaux qui se
plaignent bien souvent, il est vrai, de la fonte de leurs compétences. Dans la foulée, et sous
la pression de la préfecture, les institutions culturelles de la région et du département
furent priées de voter des budgets de fonctionnement et la mairie elle même consentit à
céder trois bâtiments de son parc immobilier dans trois quartiers de la ville pour créer les
Ateliers Populaires, dont les Tiers’At. Ailleurs dans le pays, une procédure similaire
intégrait d’autres lieux, fabriques et squat artistiques : le tout fut présenté comme un
nouveau continent à explorer, un archipel de liberté et de création composé par ces
nouveaux territoires de l’art. La lettre de Le Blaze arrivée ce matin là remet en cause
l’existence des Ateliers du quartier des Tiers et quelqu’en soit l’origine et le but, il est à
craindre qu’après plusieurs années de trêve elle ait pour conséquence de déclencher une
nouvelle vague d’actions spectaculaires.
Alex
Loin de cette agitation Alex roule en camion. L’habitacle s’enfle des rafales du vent,
il pleut des cordes et il s’efforce de suivre la route abîmée, à peine marquée qui s’efface
encore sous le déluge ; il roule doucement et garde un œil sur la pente qui plonge à pic vers
la vallée sur sa gauche : c’est là qu’il va. Bientôt si tout se passe bien il sera au sec, il pourra
faire du feu et se réchauffer, pour l’instant seule sa clope peut quelque chose pour lui alors
il la rallume. Tout autour, le paysage est brouillé, barbouillé d’eau ; depuis midi la pluie
tombe sans discontinuer, elle l’enveloppe comme un manteau protecteur, une couverture
qui le rend invisible. Alex aime autant naviguer de la sorte à l’abri des regards car même
s’il n’y a pas grand monde dans ces montagnes une mauvaise rencontre est tout de même
possible. Depuis les événements Alex est un non-intégré : il vit en dehors du système.
A l’époque il avait vingt-deux ans et plus de dettes que de patrimoine. Pourtant pas
grand chose : un peu d’énergie électrique, un ou deux loyers de retard : quelques babioles
qui ne mettaient personne en péril mais il n’avait pas non plus de métier, pas de plan de
carrière et peu d’ambition alors il paraissait difficile qu’il s’en sorte. Alex préférait passer
son temps à militer, il s’était engagé pour la paix et le désarmement, pour lauto-
détermination des peuples autochtones, pour une autogestion locale et une mondialisation
humaniste, il participait pour cela à des actions symboliques non violentes, des
occupations, des boycotts, bref, la commission qui examina son cas préféra lui couper les
vivres et toute chance d’intégrer la nouvelle société.
Comme des milliers d’autres à l’époque il commença par perdre sa carte
universelle : avalée dans une borne, puis ses données personnelles furent bloquées à tout
accés non autorisé ; alors incapable de mettre à jour ses différents pointages il fut peu à
peu exclu de tous les services. Jusqu’à ce que son appartement soit reloué et que plus
aucun guichet administratif ne le répertorie sur ses listes. Une fois non-référencé il
n’existait plus aux yeux du système et de ce fait il pouvait difficilement prétendre à quoi
que ce soit. Il ne lui restait plus que son camion et l’envie de fuir au plus vite ce piège
kafkaïen. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé à vivre hors réseau, en compagnie des militants
qu’il avait cotoyés et qui comme lui, avaient dû s’exiler après une mésaventure semblable à
la sienne.
Ensemble, les anciens compagnons de manif avaient formé un temps une petite
tribu nomade, un convoi de cinq véhicules qui se déplaçait au gré des besoins, des envies.
Tous étaient jeunes, habitués à une vie urbaine et confortable, lorsqu’ils se sont retrouvés
livrés à eux-mêmes, ils durent d’abord retrouver des instincts archaïques que la
sédentarisation avait enfouis au fil des siècles. Sans machine ni robot, sans prothèse
technique moderne, les jeunes gens habitués à ne faire aucun effort physique purent
constater que le confort tant encensé avait fait d’eux des êtres assistés, essoufflés, raides et
affaiblis. Il repensèrent à nos ancêtres, qui étaient peut-être sauvages mais épanouis, bien
campés sur leurs jambes, le plexus ouvert et le souffle ample et songèrent qu’en
comparaison les hommes modernes ont les épaules voûtées, les membres anémiés ; ils
masquent leur difformité sous des vêtements plastiques mais semblent contrefaits avec
leurs gros estomacs posés sur des jambes molles, incapables de les porter plus loin que le
parking.
C’est à croire qu’à mesure que la technique progresse, nos facultés humaines
déclinent faute d’être sollicitées. Pourtant ce retour forcé vers un état de nature n’était pas
vécu par Alex et ses compagnons comme une punition mais plutôt comme une libération ;
les nouveaux nomades firent de leur sort un jeu, dans lequel ils représentaient les
héroïques résistants, les vrais humains qui vivaient à nouveau dans une nature amie en se
gardant d’une société artificialisée qui évoluait sous les cloches asseptisées qu’étaient
devenues les villes, toutes peuplée d’intégrés automatisés. Eux ne s’aventuraient qu’à la
lisière des banlieues, par groupe de deux ou trois pour voler du carburant ou récupérer
quelques déchets issus de la société consumériste. Ces opérations étaient risquées mais
vitales pour préserver leur autonomie de mouvement car l’essentiel de leur temps s’écoule
dans la campagne, dans les montagnes.
Là il n’y a presque personne et ceux qui y vivent ne se sentent pas très concernés par
les impératifs de croissance ni par le spectacle imposé. Les troubles et les exodes successifs
causés par les événements avaient laissé de nombreux villages fantômes, des champs non
récoltés, des vergers à l’abandon. En récupérant des céréales stockées dans des silos, en
cueillant les fruits et les légumes qui avaient poussés malgré tout, ils purent survivre
pendant une année au cours de laquelle leurs étapes ne duraient jamais très longtemps
tant ils vivaient dans la crainte d’être repérés et persécutés par une répression armée prête
à tout pour les éliminer. Or peu à peu ils durent se résoudre à reconsidérer leur situation ;
car nul ne les pourchassait, la société intégrée les ignorait et cette résistance invisible
menée par des fantômes n’intéressait personne. Ils étaient bel et bien seuls, incapables de
bousculer l’ordre établi par cette majorité bien pensante qui les avait chassés de sa
mémoire, ils étaient devenus transparents : fuir devenait superflu. Alors un soir après le
repas, ils se demandèrent s’ils n’était pas temps de se poser pour construire quelque chose.
C’est Pierre et Valérie qui les premiers évoquèrent cette possibilité. Tout les deux
ont été élevés ensemble par toute une troupe de théâtre de rue. Leurs parents avaient senti
le battement d’aile du papillon et en prévision de la tempête à venir ils avaient opté pour
une occupation sensée de leur temps : ils crachaient du feu, jonglaient et déambulaient à
dix mètres du sol au lieu de nourrir le système. Bien sûr à l’époque, ceux qui croyaient dur
comme fer à la réalité des marchés et de la télé se foutaient de leur gueule, ils passaient, au
mieux pour des saltimbanques modernes, les amuseurs bariolés d’un public ignorant, mais
ce choix de vivre délibérément en marge s’avéra salvateur car quand ça a commencé à
déconner les liens solides qu’ils avaient tissés en sillonnant l’Europe des squats et de la rue
servirent de base au premier réseau d’organisation parallèle.
L’un et l’autre n’ont toujours connu que la liberté, ils sont conscients de ce que cela
signifie et savent d’ailleurs à merveille disperser alentour la force et l’amour qui les
animent. Alex les admire un peu, il n’a qu’à les regarder vivre et rire pour se persuader que
l’humanité persiste et résiste à l’assaut des ego. Des êtres préservés sont capables en toute
innocence de reproduire et transmettre les comportements de bon sens qui font désormais
défaut à un intégré de naissance. Leur couple représentait dans le groupe la possible
continuité d’un mode de vie préservé. Mais à l’opposé de cette promesse idyllique en un
avenir originel conçu par des amants joyeux au fond d’un jardin, lucide quand à l’état dans
lequel se trouve le décor de cette jolie allégorie se tenait Jean, qu’un parcours plus
chaotique rendait plus pessimiste. Plus âgé qu’eux il vivait son sort comme la grande
aventure de sa vie, lui se foutait éperdument des intégrés et de leur vie merdique, un beau
jour il avait tout perdu : femme, enfants, boulot et ça l’avait comme soulagé. Il avait
d’abord survécu en ville, dans la rue, puis au bout de six ans de galère il était tombé sur les
bonnes personnes : un petit groupe d’autonomes qui vivaient de manière clandestine et ne
se se retrouvaient que pour de ponctuelles opérations de propagande. Lui, refusait
d’emblée de reproduire les schémas d’une organisation sociale qu’il faudrait
immanquablement établir une fois que tout ce petit monde vivrait en communauté. Le
débat s’engagea donc.
« On ne peut pas continuer à errer comme ça, c’est usant et ça sert à rien. Je pense
qu’on devrait se poser, commença Valérie. Mais c’est pas ce qu’on voulait. On a toujours
dénoncé la sédentarisation comme le début de la fin. Si on se pose, faudra s’organiser pour
cultiver la terre, faudra qu’on travaille. En moins d’un an je parie qu’on retombe dans les
mêmes travers que ceux qu’on a quitté !
![]() Ecoute Jean, tu préfères continuer à bouger au hasard, sans but ?
Ecoute Jean, tu préfères continuer à bouger au hasard, sans but ?
![]() On peut s’en donner un. On a qu’à décider d’aller vers la mer, ou bien vers le sud : le
On peut s’en donner un. On a qu’à décider d’aller vers la mer, ou bien vers le sud : le
système n’est pas encore tout à fait implanté là-bas.
![]() Et une fois au sud ou à l’est, on se retrouvera en terrain inconnu et pas plus avancé que
Et une fois au sud ou à l’est, on se retrouvera en terrain inconnu et pas plus avancé que
maintenant.
![]() Tu préfères te retrouver bloquée ici, dans une baraque en ruine obligée d’attendre que ton
Tu préfères te retrouver bloquée ici, dans une baraque en ruine obligée d’attendre que ton
blé pousse pour becter ? Tu n’y as pas pris goût à cette liberté ? On va, on vient, on a rien
donc on a pas peur de perdre quoi que ce soit ; une fois que tu auras un toit au-dessus de la
tête tu voudras qu’il soit plus grand ou plus solide, tu … »
Valérie l’interrompt : « On est peut-être assez malin pour inventer un mode de
fonctionnement qui ne reproduise pas les erreurs passées. On est pas nombreux et on se
connaît quand même bien, je pense qu’on est capable de s’organiser et de se dire qu’on
déconne quand on déconne. Non ?
![]() Aujourd’hui oui, … peut-être. On est sûrement prêts à tous faire des concessions pour
Aujourd’hui oui, … peut-être. On est sûrement prêts à tous faire des concessions pour
s’entendre mais dans quelques mois, ou quelques années les problèmes surgiront. Et si
c’est pas nous, Cest nos enfants qui en hériteront. » Jean poursuit : « On ne voulait pas
participer au théâtre du monde et maintenant on ouvre une nouvelle salle ? Alors on s’est
menti jusque là : on voulait pas jouer à leur jeu parce qu’en réalité on voulait nous-mêmes
être les metteurs en scène. On ne refusait pas les règles, on rêvait d’imposer les nôtres
plutôt que de subir celles des autres !? Dans ce cas, daccord organisez votre nouveau
monde avec vos lois et votre autorité, établissez vos règles et vos sanctions je préfère
continuer seul à errer comme tu dis, sans toit ni loi parce que c’est comme ça que je suis
vraiment moi-même. »
Pierre prend alors la parole : « On n’oblige personne à quoi que ce soit. Tu présentes les
choses de façon un peu trop tranchée à mon goût. Regarde : on peut très bien trouver un
hameau, quelques maisons abandonnées. Avec un puits ou un cours d’eau à proximité, des
terres arables et pourquoi pas quelques arbres fruitiers et une forêt pour le bois de
chauffage. Bon, imaginons qu’on trouve un endroit comme ça, un peu idéal en apparence
mais nos ancêtres n’étaient pas cons et ils ont dû installer leurs villages sur de bons sites.
Donc il doit en rester. Après, on va pas vivre ensemble vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Chacun sa maison, chacun son lieu de vie, son espace intime. On peut s’entraider
pour retaper les bâtiments, les rendre à nouveau viables et puis basta après à chacun de
s’organiser dedans. Pour ce qui est de bouffer, on devra cultiver la terre c’est vrai, mais rien
ne nous empêche de continuer à aller et venir à l’occasion. Ce qu’il nous faut c’est une base,
un endroit paisible dans lequel on se sente bien pour nous épanouir et élever nos enfants.
Si tu veux continuer à bouger, Jean, rien ne ten empêche. Tu seras toujours le bienvenu et
si dans tes déambulations tu tombes sur des trucs intéressants comme du métal ou des
outils tu peux penser à nous. Le propos n’est pas de s’enterrer, le but est juste de se poser
pour avoir un repère, une base, une racine commune, un arbre sous lequel parler, un feu à
entretenir.
![]() Oui je comprends bien. Ce sont peut-être les mêmes mots produits par le même
Oui je comprends bien. Ce sont peut-être les mêmes mots produits par le même
raisonnement provoqué par la même situation du nomade qui doute. C’est millénaire. Et je
suis bien forcé de voir que l’humain ne saura jamais plus vivre simplement là où il est, au
rythme de la nature, suivant le vent ou les troupeaux. Je dois être en retard de quelques
générations. Je marche avec vous bien sûr, je vous suis jusqu’à ce que vous soyez posés
ensuite je verrai bien ce que je fais. »
Après cette discussion, la petite troupe s’était mise en quête d’un lieu adéquat et
c’est en montagne, au bout d’un chemin escarpé qu’ils avaient découvert une bastide en
assez bon état. Des quelques maisons accrochées au rocher, seules les toitures semblaient
avoir souffert du temps, du vent et de la neige. Ils récupérèrent sur les bâtiments les plus
abîmés ce qu’ils pouvaient pour aider à sauver ceux qui tenaient encore debout et
parvinrent à remettre en état quatre maisons ainsi que l’école, qui servirait d’espace
commun. Ensuite ils s’occupèrent du canal de briques qui dirigeait vers la fontaine l’eau
d’une source voisine et enfin il se mirent à défricher les terrasses du versant sud. Déjà les
cheminées avaient été remontées et s’animaient de fumées : signe manifeste que l’humain
est installé là. Jean était resté le temps de participer aux travaux puis il avait préféré
repartir ou plutôt continuer.
Seul, il avait mis le cap au sud, au delà des montagnes qui les abritent et promit de
revenir les voir. Pourtant, chacun eu le sentiment au moment de son départ que son voyage
serait sans retour comme si, en balayant d’un geste l’occasion de s’établir Jean renonçaïit à
toute pause dans une ultime course de fond qui le mènerait jusqu’à son terme. Lorsque
Jean les quitta, Alex perdit un ami, un semblable plus âgé qui lui prodiguait des leçons de
vie. Sans se couper du groupe il décida tout de même de s’établir un peu à l’écart, dans une
sorte d’étable, située au bout du village sur le flanc de la montagne. De là il pouvait voir au
loin ce qui entretiendrait ses instincts de nomade contrarié, né dans un monde sécurisé et
cadenassé lui qui rêve toujours d’être ailleurs juste pour retrouver quelques temps ce
sentiment perdu de la liberté d’être soi-même dans une nature bienveillante.
Au printemps suivant, Alex ne put s’empêcher de repartir. Il explora d’abord les
alentours immédiats, les vallées voisines et puis s’aventura jusque de l’autre côté de la
barrière naturel formée par le relief. A chaque escapade il découvre encore aujourd’hui de
nouveaux arbres fruitiers, des coins à champignons, des sources ou des abris. Pendant que
les autres travaillent la terre et réinventent l’artisanat, lui parcourt chaque chemin, pose
des pièges et s’enfonce dans les bois d’où il ramène des noisettes et des lièvres. Son rôle est
d’ailleurs vital pour la petite communauté qui respecte son silence et son détachement. Il
va et vient, reste peu à la bastide semblant ne pas s’inquiéter de ce qui s’y passe, en réalité,
il se protège des liens trop intimes, persuadé que s’il participe de trop près à la vie de ses
compagnons le moment viendra où il devra prendre parti pour l’un contre un autre.
Pourtant cette liberté qu’il s’accorde, si cruciale pour lui n’est possible que s’il a du
carburant. Et même si le moteur de son bahut est assez vieux pour rouler au rouge* il est
bien obligé de redescendre dans la vallée de temps en temps pour rendre visite à Oscar, le
ferrailleur. Un peu garagiste, un peu récupérateur et très dégourdi, Oscar sait où se
procurer légalement le précieux carburant qu’il refourgue au compte goutte, mais pour
Alex, il a toujours quelques bidons de côté. Ce n’est pas qu’il soit particulièrement
philanthrope, Oscar, plutôt gastronome. Il aime les plaisirs de la chair, le gibier et les
poêlées de morilles alors quand le camion jaune et rouge se gare dans la coure il a les yeux
qui pétillent et la salive qui fuit, car c’est pour lui l’annonce d’un ravitaillement salvateur
qui saura le remettre d’aplomb et soigner son embonpoint.
Il pleut toujours lorsqu’Alex déboule en ville, la nuit est presque tombée, personne
n’est dehors, seuls quelques rideaux s’agitent à son passage car les pénuries de carburant
fossile sont telles que les vieux véhicules deviennent aussi rares dans les endroits retirés
qu’au temps des premières tractions. Sans traîner, Alex file jusque chez Oscar.
« - Salut Alex, ça gazouille ?
![]() Pas mal et toi ? T’as les papilles en deuil en ce moment ?
Pas mal et toi ? T’as les papilles en deuil en ce moment ?
![]() Comme toujours avant ta visite. J’ai juste tiré un faisan imprudent qui passait par là.
Comme toujours avant ta visite. J’ai juste tiré un faisan imprudent qui passait par là.
Mais il est digéré depuis longtemps. Qu’est-ce que tu m’amènes ?
![]() Tu as du jus ?
Tu as du jus ?
![]() Bien sûr, je taime trop pour t’oublier ; y en a dans la cave : trois bidons de quarante
Bien sûr, je taime trop pour t’oublier ; y en a dans la cave : trois bidons de quarante
litres. » Les deux hommes font quelques pas vers la maison mais Alex se ravise. Il tire la
porte latérale du camion, sort une caisse en bois qu’il tend à Oscar. « Tiens, ouvre. » Oscar
a une tête d’enfant gâté qui reçoit son premier cadeau depuis des années. Il soupèse
d’abord la caisse, semble apprécier et lance un petit sifflement. Il a si hâte d’en découvrir le
contenu qu’il sautille jusqu’à la maison où Alex le suit de loin, lui laissant quelques minutes
pour découvrir seul son butin : Oscar est un pudique.
Lorsqu’il entre à son tour, la table est recouverte, Oscar commente et hume chaque
ingrédient avec passion. « Deux lièvres, oui, hum ; et des truites ? des truites, dis moi mais
des écrevisses ! Incroyable, ah t’es précieux toi ! Des champignons, oui, cèpes,
nonnettes, bolets, et ... des morilles aussi ? C’est bien ça les morilles … Oh … ! Terrible. Et
quoi d’autre ? Des fruits, oui c’est pour Madeleine ça, elle fera une tarte, ou de la gelée … ça
là ! … des groseilles, des petites fraises toutes rouges … des pommes, des … et Cest tout ? »
Il replonge dans la caisse. « Non encore de la volaille, des haricots. Mais dis donc où tas
trouvé ces bocaux ? Ça pousse pas dans les bois ça !
![]() Ça vient d’une vallée voisine, je les ai troqués. Comme le fromage.
Ça vient d’une vallée voisine, je les ai troqués. Comme le fromage.
![]() Du fromage ? Non ! » En effet, il sort une petite boîte scellée qu’il ouvre laissant
Du fromage ? Non ! » En effet, il sort une petite boîte scellée qu’il ouvre laissant
s’échapper une forte odeur d’amoniaque : du chèvre, à point pour sûr. Oscar s’empresse de
refermer le couvercle et continue son exploration, il sort encore du pain, de la saucisse et
des petits pâtés puis il lève vers Alex un regard embué, plein de reconnaissance. Sans
attendre les remerciements Alex sourit et d’un signe montre la cave. « Oui, oui, oui, va les
chercher ; non, je t’’accompagne, je t’aide à les monter. T’es vraiment un as toi. Des
écrevisses, quand même … et ces truites : en papillotes avec des patates. Ou plutôt non,
juste grillées sur de la braise de sarments, je crois qu’il en reste... » Les deux hommes
remontent avec les bidons.
« Et les vides ?
![]() Oui, dans le camion.
Oui, dans le camion.
![]() Tu restes un peu ? Tu veux boire un coup ? Une poire, ça te tente ? Ou un café chaud
Tu restes un peu ? Tu veux boire un coup ? Une poire, ça te tente ? Ou un café chaud
avant de reprendre la route ?
![]() Non, je te remercie. Tu salueras Madeleine. Porte-toi bien, Oscar, toi aussi tes précieux …
Non, je te remercie. Tu salueras Madeleine. Porte-toi bien, Oscar, toi aussi tes précieux …
bon, je repasse dans quelques temps. T’as envie de quelque chose ?
![]() Non, non, fais comme tu le sens, ça va toujours … tes sûr que tu veux pas un café ?
Non, non, fais comme tu le sens, ça va toujours … tes sûr que tu veux pas un café ?
![]() Merci, je file. Je ne suis pas trop dans mon élément ici, tu sais bien.
Merci, je file. Je ne suis pas trop dans mon élément ici, tu sais bien.
![]() Oui, oui ... je comprends. Bonne route, fais attention. Salut ! »
Oui, oui ... je comprends. Bonne route, fais attention. Salut ! »
Alex redécolle et quitte la petite ville. Toujours aussi humide il reprend le chemin
des hauteurs mais bientôt il bifurque dans un sentier boueux. Là, à quelques dizaines de
mètres de la route une masure délabrée l’attend : c’est un de ces nombreux refuges qu’il
visite régulièrement pour s’assurer qu’il y a bien dans un coin du bois sec et une cheminée
en état de marche. Il descend du camion un matelas de laine et un duvet, quelques
victuailles et une casserole avant de s’installer dans la petite pièce aux murs de pierres.
D’abord il allume ce feu tant attendu. Pour se réchauffer il ôte sa veste mouillée et se colle
au plus près des flammes. Il reste là un moment puis lorsqu’il est sec, ou presque, il
prépare à manger. Oscar a eu droit au meilleur, il ne lui reste pour se caler ce soir qu’un
petit pâté de lapin et du pain complet accompagnés de noix, d’une poire et d’un œuf dur.
Alex mange en silence, assis en tailleur près du foyer il ressemble à un ermite qui
vivrait loin des humains pour mieux comprendre l’humanité. Puis une fois son repas
terminé, il sort une carte qu’il étudie avec beaucoup de minutie. Cela ne l’enthousiasme pas
d’aller en ville mais il a une livraison à faire et du matériel à récupérer ; alors pour éviter de
perdre du temps une fois sur place il se remet en tête le plan du centre urbain. Les yeux
fermés il se passe le film complet de son intrusion en milieu hostile, comme un pilote de
rallye ou une skieuse de slalom qui file et recommence gommant à mesure les zones
d’ombre sur le parcours. Après quoi il s’allonge et passe un bras sous sa tête en guise de
coussin. Fasciné par les ombres projetées par les flammes Alex se laisse aller à la rêverie
lorsque lui revient un poème que Jean citait parfois en de pareilles circonstances lorsque
toute la petite tribu installée au plus près du feu, se préparait à dormir.
En ballade à trois sauvages
au bout demain, la plaine et les tipis, l’amitié troc-machin
et les rapports de bains.
En route pour l’aventure nature, mère de tous les vices serre-joints,
servis sur plateaux d’argent gravés de tête et de diamants.
En malmenant les sons on oublie sa maison pour se retrouver en camion,
convoi particulier des déambulateurs hard-core.
Au café-punch ils proprient les lieux de fête,
malgré les têtes à képi qui craignent pour leur paroisse.
Pour expliquer il faut bouger la danse-transe aux allouettes
dans un matin tripé aux couleurs de Lune cassée.
Pas évident pour des gens bien rangés dans leur boîte à boulot,
ménagés par leur femme et raillés par leurs enfants rangs d’oignons.
Antoine
En arrivant ce vendredi matin à la cité administrative, Gabrielle est nerveuse. Elle
n’a pas fermé l’œil de la nuit. Sa chef de service l’a convoquée pour neuf heure ce qui n’est
pas bon signe, il est très peu probable qu’elle la félicite pour son travail ou qu’elle lui
annonce une quelconque amélioration. Lorsque cette entrevue arrive, c’est bien souvent la
dernière.
« Bonjour !
![]() Bonjour mademoiselle. Asseyez-vous. … Voilà, je voulais vous entretenir d’un sujet
Bonjour mademoiselle. Asseyez-vous. … Voilà, je voulais vous entretenir d’un sujet
délicat, qui peut-être ne vous fera pas plaisir mais il s’agit d’un remaniement global. Toutes
les équipes municipales sont touchées, vous n’êtes pas seule dans ce cas. …
![]() Oui ?
Oui ?
![]() Et bien, voilà ... le conseil municipal, alerté par une enquête récente, elle a paru dans les
Et bien, voilà ... le conseil municipal, alerté par une enquête récente, elle a paru dans les
journaux, cela vous dit peut-être quelque chose ? … Non ? Bon et bien … il est vrai que
certaines administrations comptent moins de quatre personnes par décamètre carré et cela
porte préjudice, d’une certaine façon, à l’ensemble de la fonction publique car, en
définitive, c’est beaucoup de place qui n’est pas, ou peu utilisée, alors que cela pourrait
servir.
![]() Ah !? .… Oui, et en quoi cela me concerne-t-il ?
Ah !? .… Oui, et en quoi cela me concerne-t-il ?
![]() Et bien il faut resserrer les rangs. Il faut faire de la place où on peut et tasser où c’est
Et bien il faut resserrer les rangs. Il faut faire de la place où on peut et tasser où c’est
possible. Le but est de gagner de l’espace …
![]() Pour quoi faire ? Comment ça pour quoi faire ? Et bien parce que l’espace manque pour
Pour quoi faire ? Comment ça pour quoi faire ? Et bien parce que l’espace manque pour
des tas de choses et surtout, il est anormal, un peu injuste que certains soient privilégiés.
Voyez-vous, à un guichet par exemple, l’employé occupe moins d’un mètre carré, eh bien il
peut générer énormément de profits sur cet espace réduit. Ailleurs, certains disposent de
plusieurs dizaines de mètres carrés et produisent moins.
![]() Ah. Où ça par exemple ?
Ah. Où ça par exemple ?
![]() Comment où ça ? Et bien, … je ne sais pas moi … voyons … dans un hôpital il y a des
Comment où ça ? Et bien, … je ne sais pas moi … voyons … dans un hôpital il y a des
dizaines et des dizaines de mètres carrés occupés par les lits des patients. Toute cette
surface est finalement inutilisable, improductive. Alors en serrant un peu les rangs on
gagne de la place pour faire autre chose d’un peu plus productif. Est-ce que vous me
comprenez mademoiselle ?
![]() A vrai dire plutôt mal ... je ne vois pas où vous voulez en venir.
A vrai dire plutôt mal ... je ne vois pas où vous voulez en venir.
![]() Et bien voilà, à partir de lundi vous partagerez votre bureau avec un documentaliste qui
Et bien voilà, à partir de lundi vous partagerez votre bureau avec un documentaliste qui
déménage pour laisser un peu de place à d’autres. Il faudra prendre vos dispositions et lui
préparer un espace de travail adapté à ses besoins.
![]() Attendez … Excusez moi ... mais est-ce qu’il vient avec son fauteuil et sa table ou devrons-
Attendez … Excusez moi ... mais est-ce qu’il vient avec son fauteuil et sa table ou devrons-
nous faire un roulement ?
![]() Ecoutez ne soyez pas insolente, vous verrez cela avec lui, en attendant rangez vos affaires
Ecoutez ne soyez pas insolente, vous verrez cela avec lui, en attendant rangez vos affaires
et accueïllez le avec le sourire, c’est maintenant votre collègue. »
Ah le mot honni ! Le couteau planté dans le dos de Gabrielle et la fin de sa
tranquillité : collègue. Devra-t-elle finalement elle aussi supporter la présence d’un
collègue ? Finies les observations depuis la fenêtre, finies les divagations, les égarements …
Elle est furieuse. On la met devant le fait accompli, on bouleverse sa vie d’un claquement
de doigts, tout cela pour céder aux sirènes de l’absurdité technocratique. Qui donc est à
l’origine d’une étude aussi stupide ? Qui donc veut s’accaparer l’espace public pour en faire
une vaste zone rentable ? Elle avait bien lu cet article mais sans imaginer un instant que
cela puisse la concerner. D’un geste rageur Gabrielle claque la porte et file ouvrir sa
fenêtre. Elle respire un bon coup et aussitôt tousse tant l’air du jour est vicié ; alors elle
ferme les battants avant d’arpenter la pièce de long en large. Ainsi, il faudrait qu’elle fasse
de la place ? Et pourquoi ne pas la faire carrément la place ?
Soudain, Gabrielle ressent le besoin urgent de partir loin d’ici, quitter la ville et sa
promiscuité ; elle se sent prête à donner sa démission pour recommencer quelque chose.
Après tout elle s’en fout de tout ça, ce qu’elle souhaite c’est juste vivre sa vie en évitant de
s’impliquer dans l’oeuvre de déshumanisation globale. Elle est intégrée de fait, de
naissance : jamais elle n’a fait allégeance au système ni signifié son intérêt pour lui, elle ne
se sent pas obligée de s’investir dans un projet de société illusoire et marchand. Elle
pourrait aussi bien tout plaquer, laisser tomber son boulot, son appart et aller vivre
ailleurs, quelque part où l’air est sain, où il n’y a pas de collègue ni d’enquête idiote ni de
chef stupide.
Rêveuse, Gabrielle se retrouve à nouveau devant la fenêtre. Dans la vitre, son reflet
est comme gommé, effacé par la poussière de ce bureau étriqué. D’abord elle fait
apparaître ses yeux en ôtant du bout des doigts deux touches de poussière. Son diplôme
n’est valable que dans la fonction publique pour exercer des activités liées à la
communication. À présent ses cheveux et son front sont visibles. Si elle quitte son poste
sans motif valable elle sera fichée pour refus de mission de service public : un abandon de
poste, un crime de lèse-société, plus jamais elle ne pourra retravailler pour la collectivité.
D’une virgule elle dégage le côté gauche de son visage. Quand à obtenir un travail
équivalent dans le privé ce n’est pas si simple … Et puis le côté droit.
Elle devra repasser des examens et se retrouvera tout au bas de l’échelle
hiérarchique. Maintenant elle peut observer d’elle un reflet net. La seule solution qui lui
reste pour partir c’est de demander sa mutation mais s’il est vrai que tous les services sont
touchés par cette lubie productiviste … cela reviendra au même ; pourtant elle pourrait
tenter quelque chose … qui atténuerait son sentiment d’impuissance. Se détournant,
Gabrielle décide finalement de ne pas travailler de la journée.
Elle emballe quelques affaires personnelles, entasse dans un coin du bureau les
dossiers en cours et range l’unique étagère. C’est bien suffisant pour accueillir le nouveau
venu et d’ici là, autant poursuivre ses réflexions. Que les services publics soient ainsi
malmenés l’agace. Ils sont déjà soumis à la loi du marché, on les a déjà réduits au strict
minimum et il faudrait encore que ce qui reste d’espace public soit sacrifié ? C’est tout de
même rageant. Déjà ont pratiquement disparus les bancs publics et sur ceux qui restent les
amoureux se trouvent maintenant séparés par un accoudoir central, conçu pour empêcher
que les non-intégrés s’allongent pour y dormir. Dans ce monde que Gabrielle observe
depuis son poste, les seuls lieux autorisés pour s’asseoir quelques instants au soleil sont les
terrasses de café. Là, on peut. Pour justifier sa présence on est obligé de consommer mais
ailleurs, posé sur des marches une bière à la main on n’est plus un intégré qui se rafraîchit
mais un marginal qui zone. Gabrielle en voit parfois sur la place. Ils se posent au pied de la
fontaine, qui pourtant déborde pour chasser ces intrus et leur manège anime la rue
quelques minutes, jusqu’à ce que les brigades municipales viennent les déloger. Sans doute
vont-ils ailleurs, trimballant leurs chiens et leur barda vers un coin plus tranquille, alors la
rue s’éteint de nouveau, le silence se fait.
Un jour si ça continue, la rue elle-même sera privatisée. Il sera défendu d’y
stationner sans raison valable et les non-intégrés seront chassés. Il n’y aura plus de place
pour ceux qui refusent de jouer le jeu, la ville sera vidée de sa vie, abandonnée au béton qui
condamne la végétation, aux tours qui masquent le ciel. Pourtant Gabrielle est prête à
croire en un grand changement, une révolution qui viendrait bouleverser les esprits. Mais
les esprits sont absents. Ils n’habitent plus ces corps sophistiqués, ils n’animent plus
aucune transe spontanée. Gabrielle plonge ses mains dans ses poches, elle reste plantée là,
éperdue devant sa fenêtre. Soudain elle entrevoit avec un peu d’effroi que sa vie jusque là
s’est limitée à une analyse continue du milieu extérieur, comme pour le saisir sans y
prendre part. Elle se contente du rôle de spectatrice, spectatrice du monde et de la vie des
autres, des vies qui passent sur son bureau ou par la fenêtre …
Quel rôle agréable ! Qu’il est aisé de commenter, de juger ce qui se fait tout autour,
critiquer, sen moquer ou se plaindre lorsque soi-même on ne fait rien. Quelle situation
confortable ! Et pour ne pas participer on est capable de tous les stratagèmes, on invente
toutes les ruses, on trouve tous les prétextes qui permettront d’échapper encore quelques
temps à l’action pour se contenter d’observer et commenter le monde, seul ou en clan.
Gabrielle est seule. Elle regarde seule, elle commente seule, elle analyse et cherche seule et
l’arrivée imminente de quelqu’un dans son microcosme précipite les choses car ce qu’elle
redoute le plus au monde est de devoir agir à découvert ; elle sait qu’alors elle risque de
livrer sur elle-même autant de détails révélateurs que pourraient interpréter un
observateur de son acabit.
Le lundi suivant daté du 9 juin, elle arrive en retard. Il ne lui tarde pas de rencontrer
ce collègue que déjà elle déteste. Il brise son habitacle, il vient bouleverser ses habitudes et
ses rêveries, cela suffit pour le rendre suspect à ses yeux. Gabrielle s’installe à son bureau,
elle place ses lunettes comme une protection devant ses yeux et attend l’entrée de celui qui
doit maintenant partager sa vie. Elle attend ainsi, stoïque sur son siège, raide et
déterminée à lui faire un accueil glacial mais la scène ne se déroule pas comme convenu,
les minutes s’égrainent sans que jamais l’acteur mentre. Au bout d’une demi-heure,
Gabrielle se lève et ouvre la fenêtre. Se pourrait-il qu’un brusque changement ait différé la
venue de l’importun ? L’administration soudain clairvoyante aurait-elle fini par admettre
que les causes de cette intrusion sont idiotes et déplacées ? Y aurait-il un changement de
dernière minute ? N’osant appeler sa chef de service pour en avoir le coeur net Gabrielle se
résoud à reprendre son travail.
Elle se réinstalle à son bureau, allume l’écran et tente de retrouver le fil de sa
rédaction. Mais le flou de la situation l’empêche de se concentrer : comment pourrait-elle
être sereine ? Alors à nouveau elle se lève et file vers la fenêtre. Pendant tout le week-end
elle s’est préparée à la confrontation, pendant deux jours elle a imaginé différentes
situations et envisagé les attitudes à adopter pour être sûre de rester calme et maîtresse
elle même, à présent elle s’énerve et bientôt si rien ne se passe elle pourrait bien décider
d’aller faire un tour. Il est près de onze heures. A midi moins le quart Gabrielle s’apprête à
sortir quand sa chef de service entre sans frapper.
« - Et bien, … vous êtes seule ? … Monsieur ….. n’est pas là ?
![]() Non, je wai vu personne. Je sors déjeuner, j’ai perdu la matinée et je crois que j’ai besoin
Non, je wai vu personne. Je sors déjeuner, j’ai perdu la matinée et je crois que j’ai besoin
de prendre l’air.
![]() Un instant, comment se fait-il que …
Un instant, comment se fait-il que …
![]() Vous permettez … » Gabrielle tente de partir mais sa supérieure est si dépitée qu’elle a
Vous permettez … » Gabrielle tente de partir mais sa supérieure est si dépitée qu’elle a
besoin de s’en prendre à quelqu’un.
« Non, non, non, il faut d’abord éclaircir cette histoire. Ce n’est pas normal et nous devons
faire un rapport. Une matinée de retard, ce n’est pas sérieux, nous devons faire quelque
chose ! » Un ange passe.
« Que comptez-vous faire ? demande Gabrielle.
![]() Nous devons en référer, je ne suis pas contente et cela ne se passera pas comme ça. A
Nous devons en référer, je ne suis pas contente et cela ne se passera pas comme ça. A
moins qu’il ait une bonne raison d’être en retard, nous verrons bien, mais en attendant
nous allons rédiger un rapport circonstancié. »
C’est alors qu’on frappe à la porte. Puis on louvre et un jeune homme apparaît, sûr de lui
et débraillé.
« - Bonjour, je suis Antoine ..., je cherche le bureau des biographies … … Est-ce que c’est
ici ? …
![]() Oui c’est ici, cela fait trois heures que nous vous attendons, avez-vous un motif valable
Oui c’est ici, cela fait trois heures que nous vous attendons, avez-vous un motif valable
pour expliquer votre retard ? Un premier jour en plus ! Et bien répondez !
![]() Vous êtes madame ?
Vous êtes madame ?
![]() Je suis madame Laplaie, votre chef de service ; et je vous prierais de répondre à ma
Je suis madame Laplaie, votre chef de service ; et je vous prierais de répondre à ma
question.
![]() Ah oui je vois, alors c’est avec vous que je vais travailler » dit-il en s’adressant à Gabrielle.
Ah oui je vois, alors c’est avec vous que je vais travailler » dit-il en s’adressant à Gabrielle.
« Je ne voulais pas vous mettre dans l’embarras, mais j’ai été retenu.
![]() Il n’y a pas de mal poursuit-il à l’attention de l’autre, je m’installerai cet après-midi et je
Il n’y a pas de mal poursuit-il à l’attention de l’autre, je m’installerai cet après-midi et je
resterai jusqu’à six heures au lieu de trois. Cela nous laissera le temps de faire
connaissance. »
Gabrielle ne répond pas, avant que la cheftaine ne reparte à l’assaut elle s’éclipse
pour déjeuner.
A son retour une heure plus tard, tout est calme. Antoine est seul, debout devant la
fenêtre, il semble l’attendre.
« - C’est vous, dit-il sans se retourner. La vieille peau est intraitable, jen suis quitte pour le
rapport. Mais je men fous » lâche-t-il en pivotant. Un instant ils s’observent puis il
reprend.
« - À vrai dire, j’ai bien failli ne pas venir du tout, j’avais autre chose à faire que de me
perdre dans les services pour trouver ce placard. Car ils me mettent au placard. Enfin, sans
vouloir vous vexer mais quand même, là j’ai bien la preuve que le boulot d’enquêteur
public ils s’en tapent. Tout comme des biographes. Ils finiront par nous supprimer, enfin
nos activités : cela n’intéresse plus personne, ça ne véhicule que des idées, ça ne rapporte
rien. C’est ridicule mais il faudra bien qu’on s’en accommode ; moi je m’en fous : je suis en
service minimum. Et vous ?
![]() Je fais quinze heures par semaine. Cela me suffit. Ainsi vous êtes documentaliste ?
Je fais quinze heures par semaine. Cela me suffit. Ainsi vous êtes documentaliste ?
demande Gabrielle.
![]() Oui, j’aime bien chercher les tenants et les aboutissants, les détails et les liens invisibles.
Oui, j’aime bien chercher les tenants et les aboutissants, les détails et les liens invisibles.
Je lis tout, je regarde tout, j’écoute et j’accumule : c’est mon boulot. Mais je ne fais pas que
cela dans la vie, les recherches historiques sur la reine Victoria ça m’amuse un moment :
combien de tasse de thé buvait-elle par jour, quelle marque de lingerie portait elle ? Ce
sont des sujets futiles, vulgaires me direz-vous mais qui m’ont pourtant été soumis.
L’analyse des conséquences et des répercussions des accords de Bretton Woods sur
l’économie mondiale au siècle dernier, c’est beaucoup plus pointu, plus rare aussi comme
demande. Je fais ce travail uniquement pour conserver mon statut d’une part, et peut-être
aussi pour la mention sur la carte d’autre part. Avec mon accréditation j’ai accès à une
foule de renseignements inédits, ça peut être intéressant. C’est mon petit privilège en
quelque sorte, mon arme secrète. Et vous, c’est quoi votre arme secrète … votre privilège ?
![]() Jusqu’à présent, c’était ce bureau et sa tranquillité. Il va falloir que je trouve autre chose.
Jusqu’à présent, c’était ce bureau et sa tranquillité. Il va falloir que je trouve autre chose.
![]() Je vois. Et d’ailleurs, comment nous organisons-nous ? Vous, vous avez des visites …
Je vois. Et d’ailleurs, comment nous organisons-nous ? Vous, vous avez des visites …
![]() Et vos horaires ? ... Je travaille le lundi de 9 heures à midi et puis dans la semaine en
Et vos horaires ? ... Je travaille le lundi de 9 heures à midi et puis dans la semaine en
fonction de mes rendez-vous. Il y a Iris : la pointeuse.
![]() Et bien …
Et bien …
![]() oui...
oui...
![]() Si vous prenez tous vos rendez-vous l’après-midi, nous ne nous gênerons pas.
Si vous prenez tous vos rendez-vous l’après-midi, nous ne nous gênerons pas.
![]() Ah, et bien oui, c’est une solution en effet mais …
Ah, et bien oui, c’est une solution en effet mais …
![]() En plus, vous pourrez dormir plus tard.
En plus, vous pourrez dormir plus tard.
![]() Oui mais madame …
Oui mais madame …
![]() Quoi madame … Qu’est-ce que vous croyez ? D’abord elle va monter sur ses grands
Quoi madame … Qu’est-ce que vous croyez ? D’abord elle va monter sur ses grands
chevaux, elle va s’énerver et nous humilier pendant une demi-heure et puis elle verra bien
qu’il n’y a pas d’autre solution alors elle fera semblant d’avoir eu l’idée. Nous on s’écrasera,
elle, repartira fière et arrogante et nous foutra la paix. Je mwen charge, ne vous en faîtes
pas. Regardons les choses en face : il n’y a qu’un bureau, qu’un poste de travail, s’il doit
être occupé par deux personnes ça ne peut pas être en même temps, convenez-en.
![]() Oh mais je ne me fais aucun souci ! Votre discours est déjà prêt. La vieille peau finira bien
Oh mais je ne me fais aucun souci ! Votre discours est déjà prêt. La vieille peau finira bien
par céder, vous l’aurez je n’en doute pas. » Gabrielle s’arrête, rougit, puis plonge dans ses
poches à la recherche d’un mouchoir. Antoine est toujours à la fenêtre, tourné vers
l’extérieur il semble pensif, absent. Puis très calme, comme de très loin il demande.
« - Vous croyez aux signes ?
![]() Pardon ?
Pardon ?
![]() Les signes, les coïncidences, les croisements, les trucs qui arrivent au même moment
Les signes, les coïncidences, les croisements, les trucs qui arrivent au même moment
alors qu’ils ne viennent pas du même côté. Les points de maillage : les signes quoi !
![]() Euh ... Non. Tout ça c’est du charabia pour moi ... Pourquoi, il y a quelque chose qui
Euh ... Non. Tout ça c’est du charabia pour moi ... Pourquoi, il y a quelque chose qui
cloche ?
![]() Oui, enfin non. Pas vraiment. C’est toute cette agitation dans les bureaux. Cela nous
Oui, enfin non. Pas vraiment. C’est toute cette agitation dans les bureaux. Cela nous
touche nous ... mais ça menace aussi les Tiers’At : les ateliers populaires du quartier des
Tiers ... vous connaissez ?
![]() J’en entends parler de temps en temps.
J’en entends parler de temps en temps.
![]() C’est là-bas que j’étais ce matin. Nous avons reçu une lettre étrange de la mairie qui
C’est là-bas que j’étais ce matin. Nous avons reçu une lettre étrange de la mairie qui
projette de nous déménager.
![]() Vous déménagez ?
Vous déménagez ?
![]() Oui, les Ateliers sont installés dans un bâtiment public qui appartient à la mairie. Elle
Oui, les Ateliers sont installés dans un bâtiment public qui appartient à la mairie. Elle
compte le récupérer soit disant pour construire « un axe dédié aux transports en
commun ». Or cela arrive en même temps que ce remaniement spatial. On me chasse de
mon bureau, on veut virer les ateliers, on dirait que la mairie fait le ménage dans ses
services et dans son parc immobilier.
![]() C’est peut-être à cause de cette enquête. L’article parlait d’un remaniement spatial et les
C’est peut-être à cause de cette enquête. L’article parlait d’un remaniement spatial et les
Ateliers Populaires sont concernés au même titre que tous les autres bâtiments publics.
![]() Quelle enquête ?
Quelle enquête ?
![]() Je ne sais pas qui l’a commandée, je l’ai lue dans la presse par hasard. C’est une étude sur
Je ne sais pas qui l’a commandée, je l’ai lue dans la presse par hasard. C’est une étude sur
le taux de rentabilité du mètre carré dans la capitale.
![]() Est-ce que vous l’avez conservée ?
Est-ce que vous l’avez conservée ?
![]() Je dois pouvoir la retrouver ... mais cela ne vous dit rien ? » souligne avec malice
Je dois pouvoir la retrouver ... mais cela ne vous dit rien ? » souligne avec malice
Gabrielle en allumant l’écran tactile. Antoine ne répond pas. Il s’installe à ses côtés, tout
près d’elle.
« C’était au début du mois de janvier, dans un quotidien … nous allons lancer la recherche
sur Télétop, c’est une banque de courtage, la palme d’or du palmarès. » Gabrielle navigue
jusqu’au site de la banque, puis elle clique sur communication et cherche à consulter la
revue de presse. Comme elle s’y attendait, l’article qu’ils cherchent y tient une place
d’honneur : la banque ainsi encensée ne pouvait faire l’économie d’un étalage narcissique.
« Voilà, je vous laisse le lire. » Gabrielle se lève et s’éclipse pour jeter un coup d’oeil dehors.
Antoine lit puis reprend.
« - Oui, ça explique tout ce mouvement, si une décision a été prise au conseil municipal
nous en voyons aujourd’hui les effets : resserrement dans les services comme pour nous
deux et déplacement voire suppression des Ateliers. C’est pas joli-joli. Mais une chose
m’étonne : que feront-ils de cette place ? L’espace qu’ils récupèrent, qu’en feront-ils ? C’est
un mystère … De toute façon, il y a là plusieurs choses à éclaircir. J’aimerais bien savoir ce
que le conseil municipal a voté il y a deux mois …
![]() Je peux regarder, répond Gabrielle, c’est accessible. »
Je peux regarder, répond Gabrielle, c’est accessible. »
Elle se réinstalle devant l’écran tandis qu’Antoine se lève :
« … il faudrait aussi consulter le truc des cadastres pour voir si le tracé de cet « axe dédié
aux transports en commun » existe réellement, si des plans sont déposés, si une offre
publique a été faite auparavant. Il est sensé relier l’esplanade des Regards à l’avenue du
Commerce …
![]() Voilà la mairie ... On cherche quoi ?
Voilà la mairie ... On cherche quoi ?
![]() Un compte rendu de conseil municipal dans lequel il est question de remaniement, de
Un compte rendu de conseil municipal dans lequel il est question de remaniement, de
réaménagement, de déplacement de personnel …
![]() Aux environ du mois de mars ...
Aux environ du mois de mars ...
![]() Oui. »
Oui. »
Gabrielle pilote son bolide à travers le réseau tel un ion en ballade dans des fibres
musculaires. En un rien de temps elle est devant le bon rayonnage et d’un geste élégant elle
tend à Antoine les compte-rendus citoyens des derniers conseils municipaux.
« - Mais ça remonte au mois dernier ! Il n’y a rien, il n’y a que le dernier, c’est stupéfiant !
![]() Effectivement, le reste n’est pas répertorié. Peut-être est-ce une question de place …
Effectivement, le reste n’est pas répertorié. Peut-être est-ce une question de place …
risque Gabrielle du bout des lèvres.
![]() De place ? Mais ’tain c’est une manie ! L’archivage prend de la place maintenant ? Alors
De place ? Mais ’tain c’est une manie ! L’archivage prend de la place maintenant ? Alors
qu’on a des cerveaux électroniques de giga-tonnes de mémoires, alors qu’on peut même
créer sur le net un circuit de sauvegarde illimité en conjuguant la mémoire de chaque
ordinateur connecté ; vous voulez me faire croire que c’est la place qui manque ? » Cette
explosion soudaine de saine colère avait dû résonner car on frappe la porte deux fois, avant
qu’une main brusque ne louvre d’un coup. Armée d’un stylo, madame … entre et
s’inquiète : « Quelque chose ne va pas ? Il y a quelque chose, j’ai entendu crier. Dites moi
ce que … »
Antoine la coiffe au poteau et se remet à hurler :
« - Et oui, c’est la place qui manque ! Comment voulez-vous qu’on s’en sorte ? Il n’y a qu’un
écran, qu’un siège derrière l’unique bureau et une seule étagère pour les archives ; tout ça
moi, ça me rend malade voilà, vous voulez mon rapport ?
![]() Votre rapport ? Comment, c’est moi qui fait les rapports, il ne …
Votre rapport ? Comment, c’est moi qui fait les rapports, il ne …
![]() Non, non, non je vais faire un rapport moi aussi.
Non, non, non je vais faire un rapport moi aussi.
![]() À qui ?
À qui ?
![]() Vos supérieurs.
Vos supérieurs.
![]() Et pourquoi ?
Et pourquoi ?
![]() Parce que rien n’est prévu pour que nous puissions poursuivre notre mission de service
Parce que rien n’est prévu pour que nous puissions poursuivre notre mission de service
public, ce qui nuit au public. Et comme il faut un responsable, ce doit être vous, si vous
n’êtes pas fichue de trouver une planche et deux tréteaux avec une chaise du passé en paille
tressée et un vieux moniteur à clavier, doit bien y avoir ça quelque part à la cave non ? »
Sonnée, choquée comme groggy, madame … sort en silence, referme la porte et
s’éloigne le dos voûté par le poids qui l’accable soudain.
« - Vous y êtes allé un peu fort non ?
![]() J’admets m’être emporté. Je ne voulais que l’amener à accepter notre petit arrangement
J’admets m’être emporté. Je ne voulais que l’amener à accepter notre petit arrangement
d’horaires. Elle ne wen a pas laissé le temps.
![]() Vous ne ferez pas long feu ici … » lâche Gabrielle.
Vous ne ferez pas long feu ici … » lâche Gabrielle.
« Vous semblez déçue mais ne vous en faites pas, ils ne peuvent pas me sacquer plus qu’en
me jetant dans ces buroubliettes. A propos de l’enquête, est-ce que nous continuons ?
![]() Je ne sais pas … Il est tard, je crois qu’il est l’heure de partir.
Je ne sais pas … Il est tard, je crois qu’il est l’heure de partir.
![]() Alors je n’insiste pas. Je reviens demain matin, vous m’avez pas de rendez-vous prévu ?
Alors je n’insiste pas. Je reviens demain matin, vous m’avez pas de rendez-vous prévu ?
![]() Et bien si je ….
Et bien si je ….
![]() Je vous laisse, … j’irai directement à la mairie me renseigner, ... merci pour le tuyau, …
Je vous laisse, … j’irai directement à la mairie me renseigner, ... merci pour le tuyau, …
l’article … ça peut nous être utile pour contre-attaquer ... » Tout en parlant Antoine s’est
habillé, sa serviette sous le bras il salue Gabrielle d’un dernier sourire avant de disparaître
en coup de vent.
l’indien
A son tour, Gabrielle quitte le bureau. Elle marche un peu dehors pour s’aérer avant
de monter dans la navette qui dessert les banlieues est. La journée qu’elle vient de passer
l’a épuisée, vidée, par chance elle trouve une place assise et se laisse d’abord aller, tanguant
au gré des tournants avant de s’abandonner tout à fait en position assise-avachie sur la
banquette en plasticomorphe. Devant ses yeux comme sur un écran, les stations défilent et
disparaissent. Porté par le mouvement son regard guette aux coins des virages, s’élance
vers la moindre ligne de fuite, la tête de Gabrielle ballotte comme une bouée, dérive jusqu’à
ce que son attention parvienne enfin à se fixer sur le chauffeur.
Elle s’étonne de voir son dos, sa casquette vissée sur son crâne lisse et sa nuque
maigre presque grise, car cela fait déjà bien longtemps que les cerveaux électroniques ont
remplacé les chauffeurs biologiques. Le paysage qui court par la vitre sur sa droite s’est
modifié, maintenant les immeubles sont plus clairsemés, le ciel surgit par endroit et puis
bientôt le tram quitte la ville à vive allure, il s’éloigne du sol et s’élève. Inquiète, Gabrielle
tourne la tête pour se rendre compte que le bus est vide : elle est seule avec ce chauffeur
gris, dans un vaisseau qui prend le large par les airs. D’abord sans bouger elle l’appelle, elle
crie pour lui demander où il va puis comme il ne répond pas elle se lève et remonte l’allée
centrale. L’espace se dilate et se tord, le bus ondule, la route serpente, dehors le décor
prend des allures de lacets de montagne dans lesquels le pilote peine et souffle à
manoeuvrer tant la vitesse qui les propulse vers les sommets froids et déserts est
prodigieuse. Avant de passer le col, il tourne la tête vers Gabrielle, lui sourit peut-être, en
tout cas se lève pour la rejoindre à mi- parcours. Le bus flotte à présent dans des nuages
blancs et fileux, sans bruit, sans à-coup.
Tout près l’un de l’autre, Gabrielle découvre un visage derrière la nuque : c’est le
visage ridé et taillé au couteau d’un homme marqué. Sa peau est cuivrée, son teint halé par
le soleil naturel. Ses yeux bleus semblent se moquer d’elle qui a du mal à rester debout
dans l’allée. Elle glisse vers la vitre puis tangue et chavire, elle est secouée comme un
bouchon sous la douche et finie par être tellement bousculée par le vigile qu’elle se réveille
en sursaut, au terminus du tram. Il parait qu’elle bloque le trafic par son flegme : elle doit
déguerpir au plus vite si elle ne veut pas de problème. Le vigile est sûr de lui car le
règlement permet de telles manières, c’est une question de sécurité du réseau : un seul
engin qui stagne dérègle tout le système.
A ce moment là il est presque dix-neuf heures. Le ciel est couvert de nuages mauves.
Antoine est aux Tiers’At au fond de la salle carte grise où a lieu une A.G. exceptionnelle
provoquée suite à la lettre de la mairie reçue le matin même. Il regarde par la fenêtre, la
hanche appuyée contre le radiateur et laisse son esprit suivre le vent qui souffle dehors,
lorsqu’un bras maladroit le bouscule.
« Hop pardon, …
![]() salut, Salut ! …
salut, Salut ! …
![]() Chuuut !!
Chuuut !!
![]() Donc, on a l’occasion de montrer notre détermination à défendre le droit à la création, on
Donc, on a l’occasion de montrer notre détermination à défendre le droit à la création, on
sait qu’ils veulent nous mettre de côté, on connaît leur position …
![]() Mais c’est pas vrai ça …
Mais c’est pas vrai ça …
![]() Une seconde, attention, chacun votre tour ...
Une seconde, attention, chacun votre tour ...
![]() Oui, je disais que …
Oui, je disais que …
![]() Non, non, non, on peut pas laisser dire que ils veulent nous virer, c’est qui ils ?
Non, non, non, on peut pas laisser dire que ils veulent nous virer, c’est qui ils ?
![]() Attendez, attendez les gars, .. à tour de rôle la parole, à tour de rôle ... Bon, Réno tu finis,
Attendez, attendez les gars, .. à tour de rôle la parole, à tour de rôle ... Bon, Réno tu finis,
puis Jeanne.
![]() En deux mots je dis juste qu’ici en centre ville on dérange, on est trop visible, trop
En deux mots je dis juste qu’ici en centre ville on dérange, on est trop visible, trop
accessible et cela peut contribuer à troubler l’ordre public, ça montre le mauvais exemple
aux têtards du quartier et certaines grenouilles sont affolées à l’idée qu’il en existe encore
des comme nous …
![]() Bouuh, Ah ah ah ah …
Bouuh, Ah ah ah ah …
![]() Pop pop pop … bon, Jeanne à toi :
Pop pop pop … bon, Jeanne à toi :
![]() Ouais, ben c’est vrai quoi, on dit toujours ils nous font ceci, ils nous font cela. Mais ils
Ouais, ben c’est vrai quoi, on dit toujours ils nous font ceci, ils nous font cela. Mais ils
c’est global, c’est de l’abstrait. A chaque situation son il ou son elle, plutôt qu’un éternel ils
qu’il faudrait combattre sans qu’on sache qui c’est.
![]() Bah, et c’est quoi les il ou elle ? …
Bah, et c’est quoi les il ou elle ? …
![]() Attends, laisse la terminer.
Attends, laisse la terminer.
![]() Chaque cas particulier met en situation des protagonistes précis, identifiables. A nous de
Chaque cas particulier met en situation des protagonistes précis, identifiables. A nous de
les trouver et de nous rappeler à leur bon souvenir. Après tout, ils, comme on dit, nous
filment dans les manifs, dans la rue et ailleurs, ils peuvent nous suivre à la trace si soudain
nous dévions du tapis roulant qui conduit le monde occidental vers un avenir toujours plus
rayonnant …
![]() Putain, tu t’embrouilles, je capte que dalle … Et tu proposes quoi ? De reformer Action
Putain, tu t’embrouilles, je capte que dalle … Et tu proposes quoi ? De reformer Action
Directe ? On enlève le conseiller en communication qui a pondu l’histoire … ou alors le dir.
de cab. du préfet, le patron de Béton+ parce qu’il a décroché le marché de reconstruction
ou peut-être le fabriquant du stylo qui a été utilisé pour signer les contrats ?
![]() Ah ! Ah ! Joli !
Ah ! Ah ! Joli !
![]() Ne perdons pas de vue que le délai court sur cinq mois et que nous devons visiter trois
Ne perdons pas de vue que le délai court sur cinq mois et que nous devons visiter trois
nouveaux lieux d’ici là.
![]() Et alors, tu crois peut-être qu’ils vont, pardon Jeanne, ... ouais … qu’ils vont nous filer un
Et alors, tu crois peut-être qu’ils vont, pardon Jeanne, ... ouais … qu’ils vont nous filer un
endroit mieux que celui-là ? Quatre mille mètres-carrés au centre ville … tu rêves … ils
veulent nous dégager !
![]() D’accord mais ailleurs on aurait peut-être un accès extérieur, quelques arbres, de l’herbe
D’accord mais ailleurs on aurait peut-être un accès extérieur, quelques arbres, de l’herbe
et le ciel à portée de vue.
![]() C’est très poétique, mais tout ça ne nous dit pas quelle attitude adopter ... quel est l’angle
C’est très poétique, mais tout ça ne nous dit pas quelle attitude adopter ... quel est l’angle
d’attaque, ou plutôt de contre-attaque ? »
A ces derniers mots, Antoine sort de sa rêverie pour prendre la parole.
« J’ai du neuf, un article qui a paru il y a quelques temps et qui nous a échappé. Il semble
que ça ait un rapport avec notre lettre … si vous voulez, je le lis. »
Il sort l’article et en entame la lecture. Pesant chaque mot, soignant ses effets il
plonge ses camarades dans un émoi tel qu’ils resteront là à discuter des subtilités de la
manoeuvre et des perspectives de représailles jusque tard dans la nuit. Antoine les écoute
un moment mais ses pensées dérivent vers un continent plus doux que celui de la lutte : il
songe à Gabrielle. Un instant il sourit sans objet et puis ses sourcils se froncent à nouveau
pour suivre le débat pourtant, malgré ses efforts, les voix de ses camarades mêlées au
brouhaha de la buvette le bercent alors il se lève, dit au revoir à Robert et retourne dans la
Tue.
A présent le ciel est chargé de nuages sombres, il n’y a plus un souffle d’air, pas une
brise. Il est plus de vingt heures trente et la fringale le prend, Antoine enfourche donc son
vélo, puis sans se presser pour autant il redescend le boulevard circulaire. Par précaution,
il a passé un masque de gaze stérile destiné à filtrer lair qu’il respire. Tous les jours il
entend que c’est ridicule, complètement superflu maintenant que les voitures sont propres
et les usines sécurisées, on lui répète que les indicateurs de qualité environnementaux sont
au vert, que la planète est officiellement sauvée grâce au système établi, que plus rien ne
justifie cette attitude rétrograde …
mais Antoine sait comme P.P.P.* sait, que si les nouvelles normes sont appliquées
aujourd’hui c’est parce que des centaines d’accidents industriels ont déjà provoqué de quoi
sérieusement vicier l’atmosphère terrestre. Cette précaution désuète préserve un peu ses
poumons qui s’agitent et réclament de l’oxygène pendant l’effort du pédalage. A hauteur de
Belleville il oblique sur sa gauche pour retrouver le canal latéral. La circulation y est moins
dense et quelques arbres synthétiques très réalistes donnent un vague caractère
impressionniste aux décors. Vu l’heure s’il veut manger, il est contraint de repasser par le
centre : c’est là qu’il trouvera un resto ouvert ou quelque rapides repas à emporter. Mais
s’installer dans un restaurant oblige à un rituel si téléphoné que cela lui donne la nausée
avant d’entrer, il sait davance qu’il ne supportera pas les murmures suintant de lieux
communs que l’on fait passer en avalant des mets surgelés … Quand à l’autre option elle est
pire car elle le condamne à une bouffe prémâchée. De plus, manger seul devient suspect
quand l’heure du théâtre permanent sonne le glas de la réalité individuelle. Dans cet état
de représentation continue il s’agit d’être au moins deux : il faut un public à l’acteur, au
comédien qui joue sa vie sur scène comme à table et il faut au consommateur un spectacle
qui stimule son jugement critique, faute d’appétit.
Bref, le dilemme surgit ainsi du quotidien alors pour ce soir, Antoine décide de
suivre une troisième voie : il connaît un chawarma tenu par un ancien des Ateliers, de
l’époque où c’était un squat dur. Azzedine acceptera peut-être de lui préparer un truc à
emporter, des bricks ou un tagine. Content de sa décision il pédale à donf et contourne
sans se méfier la fontaine Jacques Héllule pour déboucher à toute berzingue sur les allées.
C’est alors qu’arrive sur sa gauche, tous feux éteints, un camion qui roule prudemment
certes, mais cependant assez vite pour heurter Antoine si rien ne se passe. Les deux pilotes
pilent ensemble, Antoine saute par dessus bord, roule par terre vers des buissons de thyms
en entendant tout près de lui son vélo se faire écraser. Assez stimulé par l’adrénaline
dégagée il se relève d’une roulade et fonce sur le camion bien décidé à l’allumer s’il tente de
fuir. Mais celui-ci ne repart pas ; déjà le conducteur descend pour s’élancer au secours du
malheureux : finalement c’est en se cognant d’enthousiasme que les deux hommes font
connaissance.
« Bordel mais c’est quoi lààà .. Tu m’fais quoi lààà ?
![]() Ta gueule, fait pas chier ! T’as rien ? Alors tu dégages.
Ta gueule, fait pas chier ! T’as rien ? Alors tu dégages.
![]() Mais où tu vas toi, tu délires ou ... ?! » Puis Antoine se tait en découvrant la touche du
Mais où tu vas toi, tu délires ou ... ?! » Puis Antoine se tait en découvrant la touche du
chauffard. Il porte des jeans 105, des grosses grôles de bidasse, un pull tricoté à la main et
une veste de pompier récupérée dieu sait où. C’est sans aucun doute un hors-zone, un non-
intégré, pour lui Antoine est un putain d’intégré, un minable qui vit dans le système et plie
l’échine. S’il le prend en grippe il peut tout aussi bien le buter pour ne pas laisser de trace
de son passage en ville.
« Alors, tu dis ? T’as compris le topo, j’suis ici en loosdé tu captes ? Faut pas faire de vague
… Ton vélo, il est p’t’être pas foutu … Regarde, y a juste la roue qu’est voilée, tu peux la
remettre d’aplomb et puis tu retends les freins et c’est bon, allez, salut ... encore un truc …
t’inquiète pas, de toute façon tas rien vu … tu tes pris le trottoir, c’est trop con ça,
vraiment maladroit, allez, à plus … salut …
![]() Attends, c’est pas grave pour le vélo, jmen fous … … mais … ?
Attends, c’est pas grave pour le vélo, jmen fous … … mais … ?
![]() Mais …
Mais …
![]() Et ben c’est que j’allais manger un bout et c’est pas à côté. Si tu peux me rapprocher c’est
Et ben c’est que j’allais manger un bout et c’est pas à côté. Si tu peux me rapprocher c’est
pas de refus.
![]() T’es gonflé, j’ai pas que ça à foutre. C’est où ?
T’es gonflé, j’ai pas que ça à foutre. C’est où ?
![]() Arno Bern, derrière le port.
Arno Bern, derrière le port.
![]() OK monte, fout le vélo à l’arrière et magne toi. »
OK monte, fout le vélo à l’arrière et magne toi. »
Le camion redémarre et disparaît dans une ruelle qui descend vers le fleuve, un
moment les deux hommes se jaugent sans prononcer un mot. »
Arno Bern, c’est pas courant comme ballade pour un moutoneux. Alex émet un léger
sifflement puis reprend. T’es dans quel business ?
![]() Aucun business, je rends visite à un pote. Et toi reprend-il, tu viens de l’extérieur ? »
Aucun business, je rends visite à un pote. Et toi reprend-il, tu viens de l’extérieur ? »
Alex ne répond pas.
« OK, j’insiste pas. Mais tu sais y a pas que des moutons ici, on est quelques uns à se
bouger. On court pas tous après les YES, y en a qui prennent le temps de vivre. Si on est là
c’est parce qu’on y est né mais y en a pas mal qui seraient pas contre se barrer, se tirer loin
d’ici … C’est comment la campagne ?
![]() Laisse tomber. Voilà, t’es arrivé. Te prends pas trop le chou mon gars, par contre si tu
Laisse tomber. Voilà, t’es arrivé. Te prends pas trop le chou mon gars, par contre si tu
veux être utile j’ai un truc à te proposer.
![]() Dis toujours.
Dis toujours.
![]() Si je te confie quelque chose, est-ce que tes capable d’aller le placer à l’endroit que je
Si je te confie quelque chose, est-ce que tes capable d’aller le placer à l’endroit que je
t’indiquerai ?
![]() Ça a pas l’air sorcier. »
Ça a pas l’air sorcier. »
Alex sort alors de son sac une petite boîte en bois, sculptée et peinte à la main qu’il
tend à Antoine. Celui-ci la prend et du regard interroge Alex.
« OK. Tu vois le parc Aratta ?
![]() Oui. Y a un tunnel piéton qui passe dessous.
Oui. Y a un tunnel piéton qui passe dessous.
![]() Je connais.
Je connais.
![]() Tu le prends en direction du sud et tu continues jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’il rejoigne
Tu le prends en direction du sud et tu continues jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’il rejoigne
une piste cyclable. Tu suis cette piste sur trois cents mètre, là une passerelle enjambe
l’autoroute. Tu comptes 9 fenêtres rondes en plexi du côté gauche et tu mets la boîte dans
la dixième, dans le renfoncement, tu verras les hublots sont en hauteur.
![]() C’est tout ?
C’est tout ?
![]() Ce sera déjà énorme.
Ce sera déjà énorme.
![]() Et quand dois-je faire ça ?
Et quand dois-je faire ça ?
![]() Quand tu veux à partir de maintenant.
Quand tu veux à partir de maintenant.
![]() Ce sera fait, tu peux compter dessus.
Ce sera fait, tu peux compter dessus.
![]() Maintenant j me casse.
Maintenant j me casse.
![]() Ça va. A un de ces quatre peut-être. »
Ça va. A un de ces quatre peut-être. »
Alex redémarre aussitôt, laissant Antoine sur le trottoir un peu pantois avec son vélo
déglingué et sa boîte en bois. Il lui faut quelques secondes pour trouver le mécanisme, en
faire pivoter le socle et découvrir … qu’elle est vide. Quand l’instant de surprise, teinté de
dépit malgré lui est passé, il sourit : le message c’est la boîte. A lui de la déposer à l’endroit
défini, quelqu’un d’autre saura interpréter sa présence. Il la fourre donc dans une poche et
relève son vélo pour continuer son chemin à pied. Maintenant en résonnant sous son pull,
les gargouillis de son estomac tordent le cou aux bonnes manières, plus question de passer
prendre un taggine chez Azzedine il décide de rentrer directement chez lui, il se contentera
d’un bol de thé et de quelques fruits.
« Putain y a que moi pour tomber dans des plans pareils ! » Dans son bahut, Alex
n’en revient pas. Il a évité une embrouille à deux balles : c’est déjà pas mal. Mais il a encore
croiser le regard mi-inquiet mi-envieux de ces intégrés mal dans leur système qui
fantasment sur les non-intégrés. Pour certains, les hors zone ont quelque chose de
romantique, ils véhiculent et transmettent l’image du rebelle radical qui préfère mourir ou
vivre exclu plutôt que de jouer ce jeu que tout le monde supporte.
« Ils s’imaginent qu’on est des héros … Ça les fais rêver de se dire qu’eux aussi pourraient
basculer, prendre le large et devenir l’un de ces pirates libres et sauvages. Mais c’est du
flan, c’est des bouffons qui se font des délires en fumant un joint ou en buvant des bières et
puis le lendemain ils retournent bosser, fatigués et râleurs mais soulagés d’avoir pu donner
libre court à leurs illusions le temps d’une soirée au moins, faute de s’accorder la liberté
pour de vrai. »
Car la vie que mènent Alex et les siens n’est ni très sûre, ni très confortable.
L’attention permanente, la tension permanente qui en résulte obligent l’esprit à rester
constamment en éveil. Toujours en mouvement, devant apprendre de chaque situation et
anticiper mille détails, la mécanique interne d’une tête de non intégré est obligée de suivre
le rythme. Or notre société rationaliste se caractérise, entre autre, par une automatisation
des schémas de pensée. Si le fil de nos pensées se déroule comme un vaisseau subtil qui se
déplace à grande vitesse dans un réseau tressé de neurones interconnectés, notre manière
d’agir actuelle favorise la destruction de ce fouillis pour construire à la place de belles
autoroutes bien droites qui seront à même de transporter les désirs et les volontés vers ce
qui est utile, rationnel, prévisible, prévu et acceptable. L’heure est au défrichage par le feu :
si malgré le chamanisme, la magie, la foi et la psychanalyse l’esprit refuse de se livrer à
notre compréhension d’humains orgueilleux, nous le brûlerons pour construire sur ses
ruines un monde, un rêve, une réalité montée de toute pièce par la mise bout à bout
d’images stéréotypées, de situations préconçues, de dialogues entendus.
Peut-être alors qu’un non-intégré commence par accepter ce foutoir innommable
que constitue l’esprit. Le poète déjà a cette capacité de liberté temporaire qui lui permet
d’inventer des images par les mots, d’évoquer sans rien dire ou de plaire sans se faire
comprendre. Le fou la possède au plus haut point, lui qui se permet de vivre dans une
réalité qui nous échappe tant elle est éloignée de celle que nous nommons normale. Sans
être fous ni tous poètes, les non-intégrés sont obligés d’une manière ou d’une autre de faire
confiance à leur inconscient. Tant de choses échappent à l’entendement qu’il est bon de
vivre en paix avec cette part sombre qui fonctionne toute seule ; c’est une solution simple
pour vivre en rythme avec le monde, avant de le quitter sans gloire ni trésor, sans en retirer
d’autres avantages qu’une vie vraie et des sentiments sincères.
Tout en marchant, Antoine pousse le vélo d’une main et de l’autre dans sa poche il
se familiarise avec les creux et les bosses de la boîte. Parce qu’elle a été sculptée par
quelqu’un du dehors et par ce qu’elle représente, cette boîte est comme une relique pour
Antoine. Il imagine le type de tout à l’heure en train de travailler le morceau de buis
patiemment avec son canif, jusqu’à obtenir la forme souhaitée.
« Et puis il l’a peinte... c’est rare … et plutôt bien fait ... Jai plus eu à faire à un artiste qu’à
un dangereux déséquilibré comme on nous présente d’ordinaire les non-intégrés.
Remarque, je men doutais un peu ... Bon par contre lui, solliloque-t-il en montrant le vélo,
c’est pas le top. Je perds mon moyen de locomotion pour livrer une boîte vide, curieux troc
tout de même … Enfin, ça fait toujours une aventure. Putain ça y est, il est presque minuit,
ça craint. »
Sur un immeuble en face, l’heure en cristaux liquides annonce en effet en rouge
clignotant qu’il est près de minuit : l’heure du couvre-feu pour les intégrés actifs. Seuls les
passifs : les donneurs d’ordre et les décideurs sont autorisés à circuler non-stop de jour
comme de nuit. Accompagnés de leur coure personnelle de conseillés et d’experts, de
créatifs, de poules de luxe, d’acteurs et de lolitas, d’amis mesquins et d’ennemis hypocrites
ou l’inverse, dhommes de main et de journalistes, ils naviguent de bars en hôtels et
s’amusent parfois à taquiner les malheureux actifs qu’ils croisent lors de leurs virées
nocturnes. N’étant pas dans son droit, un actif en difficulté n’a rien à attendre des flics et il
arrive que de vrais barjots se payent une partie de chasse urbaïne pour tromper un chagrin
d’amour ou laver une défaite professionnelle.
A nouveau, Antoine pense à l’autre de tout à l’heure, bien à l’abri dans son camion
prêt à tout, à se battre et tuer s’il le faut. Il le voit maintenant comme un chevalier blanc,
discret, invisible, surgissant tout à coup de nulle part pour faire obstacle aux plans
machiavéliques du chevalier noir. Peut-être que la ville manque de tels héros mais la toute
puissance du mal ne semble-t-elle pas établie ? Ses yeux sont partout et ses oreilles
entendent tout, rien n’échappe à sa méfiance et une simple hésitation est lue comme une
insulte, une trahison à la confiance absolue que réclame le système pour perdurer …
Pour l’instant c’est Antoine qui est inquiet pour son avenir. Il longe les rues les plus
sombres, évite les grands axes, se perd et revient sur ses pas, bifurque, se cache avant de
repartir. Bientôt il envisage d’abandonner son vélo pour filer se mettre à l’abri au plus vite
mais déjà un véhicule blindé le double et ralentit. Une caméra le vise par un judas, sans
cesser d’avancer il montre son vélo en ruine, hausse un peu les épaules et indique d’un
geste sa direction. La voiture accélère et tourne plus loin. Antoine souffle et puis se crispe à
nouveau en la voyant revenir face à lui. Elle reprend de la vitesse, se met à hurler des
sirènes insensée, assourdissantes qui le tétanisent sur place. La voiture le frôle, l’oblige à
s’effacer pour éviter le choc. A l’intérieur il lui semble percevoir au passage des rires, des
rires insupportables typiques d’une inhalation de balloon. Les premiers détraqués de la
soirée sont déjà défoncés et prêts à jouer, heureusement pour Antoine leur programme les
appelle sans doute à quelque rendez-vous classés hip : ils disparaissent pour de bon.
Quelques détours encore et il aura pour sa part rejoint le périphérique, ceinture
urbaine qui délimite la ville et au-delà duquel les banlieues forment d’autres territoires.
D’autres fiefs asservis. De l’autre côté, les passifs hésitent à s’y aventurer car beaucoup
d’actifs restent dehors plus tard malgré les interdictions. Ils vaquent à de menues activités,
des commerces d’appoint et l’animation gêne les chasseurs de proie. C’est donc sous un
pont du tram qui sert de boîte à putes que se terminent enfin les sueurs froides d’Antoine.
Après un repas simple qu’elle prépare elle-même, Gabrielle baisse les lumières et
allume une cigarette. C’est rare, elle fume peu et seulement de l’herbe douce. Elle apprécie
la détente physique qui en découle et ce soir justement elle a du mal à s’apaiser. Le bain n’y
a rien fait, son esprit est confus, ses sentiments trop contradictoires et son analyse de la
situation reste embrouillée. La journée a été mauvaise parce que l’inconnu attendu a bien
débarqué dans son bureau, dans ses rêves et dans sa vie sans que cela se passe comme
prévu. Mais elle a aussi apprécié la tête dépitée de sa chef, d’un petit chef parmi d’autres
matée par cet olibrius qui a un toupet incroyable. Cela causera des problèmes elle en est
sûre ; et ça l’inquiète. Des représailles sont à prévoir, la pression va monter et ce genre de
climat l’empêchera de travailler à ses biographies. Elle ferait mieux d’éviter cet Antoine si
elle tient à sa tranquillité. Or l’éviter parait difficile. Et puis cette soudaine agitation lui
plaît peut-être. Elle voudrait bien savoir en quoi le sort des Ateliers est lié à celui d’Antoine
et si le sien a quelque chose à voir dans l’histoire. Allongée sur le dos, la tête calée par
l’oreiller Gabrielle fume dans le noir.
Pour se protéger elle adopte en journée un caractère plutôt naïf et détaché mais la
nuit ses doutes et ses angoisses réclament leur part d’attention. Chaque soir elle s’applique
à reconstruire avec les histoires de sa vie une trame globale acceptable par son
entendement pourtant, les fils et les bribes de ce tissu dense s’emmêlent et se tordent
souvent en insomnies récurrentes. Ce soir, pour ne pas enclencher les mécanismes d’auto-
analyse permanente Gabrielle se réfugie dans le songe qu’elle a fait dans le tram. Elle revoit
le visage ridé et bruni par le temps du mystérieux chauffeur, son sourire et ses beaux yeux
bleus blanchis par les embruns ou les glaces. Ensemble ils flottent dans l’ouate colorée du
lit des nuages, Gabrielle est légère et souple comme le vent puis le bus les rapproche et les
coupe de l’extérieur, le chauffeur est à sa place à lavant, Gabrielle est sur les sièges du
fond, elle regarde par la vitre arrière la ville qui s’éloigne d’elle, devient petite, petite,
minuscule comme une tâche instable sur le paysage qui s’ouvre et s’élargit peu à peu. Pour
connaître celui qui l’enlève et la sauve, elle entreprend de remonter le bus, comme on
remonte une rivière.
Elle lutte contre les flots mais ne parvient qu’à se maintenir à grande peine et d’un
instant à l’autre elle risque de flancher, de se laisser aller au gré du courant qui l’entraîne
déjà vers la fenêtre d’où elle tombe, et dans sa chute à travers champs, une image nette et
très précise de l’homme indien apparaît : il l’accompagne, la calme et la précède puis ils
glissent et il la dépose en ville, dans sa rue, juste devant sa porte. L’instant d’après ses
muscles tendus se sont dénoués, dégagé des contraintes, libéré du poids de la raison son
corps s’abandonne enfin, dans les bras de Morphée comme dans les bras d’aucun autre.
l’expulsion
Alex est pour sa part parfaitement éveillé et même aux aguets. Il est trois heures du
matin, son camion est à l’arrêt garé en marche arrière dans une ruelle des faubourgs sur le
trottoir de droite, très près du mur de l’immeuble. Après avoir attendu comme ça quelques
minutes il tire de l’intérieur la porte latérale du camion pendant que de l’autre côté c’est la
fenêtre du rez-de-chaussée qui s’entrebâille.
« - Sonnez les courants d’air.
![]() Faites donner l’exutoire »
Faites donner l’exutoire »
Après ce rapide échange verbal codé, les deux hommes font passer dans un sens
quatre caisses en bois de la taille d’un pneu et dans l’autre dix sept tubes emballés faisant
chacun dans les deux mètres. Puis ils se saluent et la fenêtre se referme. Alex prend le
volant, il tourne la clef de contact mais seul un clic-clic lui répond. Il réessaie. A nouveau
clic-clic. Le démarreur est collé ! Lorsque les charbons sont vieux et usés il arrive qu’ils se
collent au lieu de tourner pour lancer le moteur. Alex hésite un instant. Il peut taper sur le
démarreur, parfois cela libère les charbons mais il préfère ouvrir sa portière et mettre pied
à terre pour pousser le camion dans l’axe de la rue, un peu en pente. S’il arrive à rouler et
prendre de l’élan il pourra redémarrer en débrayant en deuxième.
Les bruits singuliers de sa mésaventure ne doivent en aucun cas attirer l’attention, il
risque gros s’il est intercepté de nuit dans ce véhicule saisi par la justice. Il a bien sûr pris
soin de remplacer les plaques et la puce interne de son camion par des éléments de
contrôle propres et équivalents, mais si jamais il est arrêté le subterfuge ne tiendrait pas
longtemps. Ce camion est pourtant crucial, il navigue dans ce vaisseau spécial, il y tient et
doit veiller à le conserver. Alex se plie et pousse de toutes ses forces sur le châssis de la
portière ouverte. Rien n’y fait, il ne pourra pas s’en sortir de cette manière. Il braque le
volant et va jusqu’à l’arrière du camion, du regard il cherche un appui et tombe sur un
bélier d’acier comme on en voit maintenant soudé à l’avant des nouveaux modèles de
voiture. S’il s’aide en s’appuyant là-dessus il y arrivera, tout à l’heure s’était presque ça, il
ne manquait pas grand chose. Il se place donc dos au camion, face au bélier et pose un pied
sur la bagnole qui se met aussitôt à hurler comme une vieille fille. Il force, il sent dans son
dos le camion qui s’agite, qui prend de la gîte et finit par partir doucement, le volant
toujours tourné.
Alex bondit dans le même mouvement, il court jusqu’à la portière, s’accroche, se
hisse à l’intérieur. En un éclair il a passé la seconde et lâché l’embrayage, le moteur rugit
pendant que la courroie de l’alternateur parle en sirène avec l’alarme de lauto ; sans
demander son reste Alex file, fonçant tous feux éteints dans ce quartier résidentiel.
Comme les intégrés actifs sont sensés dormir ou du moins ne pas se déplacer, les
rues sont désertes. Après un long parcours sur le boulevard circulaire il remonte sans
encombre les faubourgs en direction du nord puis il se dirige vers l’extérieur de la ville qu’il
n’atteindra qu’après avoir franchi le barrage des Récollets. Cette zone de contrôle est
comme la porte nord de la cité fortifiée et ceinturée qu’est devenue la ville. L’entonnoir est
encore à vingt minutes de trajet. Lancé vers le dehors comme s’il venait de débrancher les
fils de la machine Alex roule à fond les gamelles. Juste avant les portiques électroniques il
ne peut s’empêcher de faire un détour pour vérifier qu’aucun véhicule de police ne l’attend,
il oublie que la notion même de terrain est obsolète à l’heure des prothèses numériques.
Puis, étant au volant d’un véhicule du passé à contenance modulable il est prié par
de grands écrans colorés de suivre la voie n°35. Alex obtempère et les rails électros le
guident vers le portique U 415. Si l’engin reconnaît son véhicule comme suspect ou
impliqué dans un délit, il va vite le savoir. Les cylindres tournent tout autour du camion, en
quelques secondes ses plaques sont lues, la puce véhicule et son visage sont passés au
fichier, le verdict est immédiat : circulez. Sans sourire ni bouger un seul muscle apparent
Alex s’élance, accélère et prend de la distance, c’est seulement après avoir vérifié cent fois
les rétros et le radar qu’il sourit et se détend enfin. Il est alors près de six heures du matin.
L’aube est douce plus que fraîche, un vent léger et tiède souffle pour disperser des nuages
épars. La journée va être belle à l’ombre de la forêt tout à l’heure. D’ici là il lui reste un bon
bout de bornes à couvrir mais avant tout il doit manger ; et puis marcher un peu, se vider
la tête du boucan que fait le camion alors Alex tourne sur une route secondaire pour
trouver un coin peinard.
Gabrielle quand à elle se réveille. Il est encore tôt : l’appareil ne sonnera que dans
une heure. Elle le neutralise, se lève pour soulager sa vessie et retourne aussitôt sous la
couette. Un homme à ses côtés ne serait pas de trop dans ces moments là mais elle a
tellement peur de ne pas supporter tous les autres qu’elle s’abstient. Pour passer le temps
elle hésite entre la radio et un polar vite lu, finalement elle renonce à s’agiter pour rester
bien au chaud sous l’édredon moelleux.
« Fichue clim ! Peuvent pas nous foutre la paix non ! C’est pas difficile de couper la nuit.
L’hiver c’est le chauffage qui siffle et lété la clim qui glace les os. Ça manque un peu de
tenue. C’est pas si au point quand même leurs systèmes ! »
Gabrielle peste contre ce qui l’agace et souvent elle a raison de s’irriter. Mais il y a
aussi dans ses énervements une part qu’elle s’adresse à elle-même car ce bonheur qu’elle
attend tarde à venir et elle reprochera tout aux autres avant d’admettre du bout des lèvres
qu’elle ne fait rien pour le construire. Finalement elle bondit nue hors du lit, enfile une
tunique d’intérieur et prépare un thé. Elle sort un gâteau quelle a préparé : un simple
gâteau au yaourt bourré de morceaux de poires, de pommes et de noisettes puis elle
s’installe à la table, face à la baie vitrée par laquelle elle aperçoit entre les immeubles une
aube neuve et mauve qui s’étire, alors que le soleil naturel monte à vue d’œil, entamant
ainsi son ascension relative dans le ciel de la Terre. La journée s’annonce pleine et riche
d’enseignements.
S’étant levée tôt Gabrielle est dehors dès huit heures. Son premier rendez vous n’est
qu’à neuf heures trente, elle a donc le temps de se promener, de prendre l’air avant de
s’enfermer au bureau. Elle emprunte un circuit rôdé qui lui fait d’abord suivre une rue
fleurie jalonnée de beaux jardins, puis elle traverse un parc dans lequel un jet d’eau
puissant fonctionne même quand il pleut, ensuite, son parcours serpente dans les quartiers
historiques qu’elle visite en zig-zag pour s’y perdre, jusqu’à rejoindre une place peu
fréquentée qui donne sur un large boulevard difficile à franchir tant le trafic auto y est
épais. Au terme de ce périple Gabrielle est presqu’arrivée à la cité administrative ; comme
il lui reste encore un peu de temps elle choisit de bifurquer en direction du Musée des
Jardins, un lieu insolite où l’on peut déambuler sous serre dans quelques jardins
légendaires reconstitués à l’identique.
Et c’est en approchant de l’avenue du Commerce qu’elle tombe alors sur un
spectacle qui la sidère, qui la cloue sur place. Le quartier est bouclé par des CrS
rembourrés et casqués. L’un d’eux intime d’un geste du bras gauche les passants à passer
leur chemin, tandis que l’index droit de sa main droite est tendu sur la gâchette. Quelques
personnes ralentissent pour tenter de comprendre ce qui peut susciter un tel déploiement
de forces armées, malgré tout chacun poursuit sa route et retourne à ses histoires Gabrielle
elle aussi continue de marcher. Mais elle prend une rue qui remonte en parallèle, vers le
haut de l’avenue car quelque chose l’inquiète : les Tiers’At se trouvent juste là, à quelques
dizaines de mètres ; elle se faufile dans l’agitation matinale de cette rue étroite puis dés que
c’est possible Gabrielle tourne à droite pour retrouver l’avenue.
Au loin, face à elle, l’artère est bouchée par un car blindé posté en travers. Un simple
ruban rouge et blanc délimite une zone interdite au public, une zone militaire temporaire
dans laquelle nul droit n’a de prise réelle, malgré tout, sans hésiter, Gabrielle s’approche de
la frontière et s’adresse à l’homme robot qui garde le passage.
« J’habite ici, indique-t-elle en montrant les toits, est-ce que vous savez si cela va durer
longtemps ? »
La chose ne lui répond pas directement mais s’adresse au micro intégré dans son
casque. Un gradé se détache alors d’un contingent de réserve qui s’harnache derrière le
blindé et les rejoint. Il marche à pas lents, son bras gauche l’invite par ses mouvements à
poursuivre sa route, l’index droit de sa main droite est tendu sur la gâchette, prêt à
éliminer le risque si Gabrielle fait un mouvement suspect. Lorsqu’il arrive à leur hauteur
Gabrielle reprend :
« J’habite l’immeuble, je voudrais juste savoir combien de temps cela prendra. » D’abord
le masque noir percé de trois trous ne répond rien puis il lâche :
« - Disposez vous d’une preuve matérielle justifiant de votre domiciliation à cette adresse ?
![]() Oui bien sûr, là-haut. » Rétorque-t-elle.
Oui bien sûr, là-haut. » Rétorque-t-elle.
L’autre ne répond plus, il a déjà débranché le système d’Assistance Contact
Populations qui lui a soufflé la question d’usage, et reprend la mécanique parfaite des
gestes appris à l’école de la Muette : le bras gauche fait circuler, l’index droit de la main
droite est tendu sur la gâchette, peut-être un peu plus maintenant après cette expérience
en situation réelle.
Comprenant que la tension est montée d’un cran, Gabrielle s’éclipse. Néanmoins, il
lui reste une chance d’apercevoir l’ancien Grand Hôtel dans lequel sont installés les
Ateliers du quartier. Elle repart en direction du nord jusqu’au croisement de l’avenue du
Commerce et du boulevard des Indes. Le rond point qui marque le carrefour forme un
square dont l’une des entrées se trouve face aux Ateliers. Et alors qu’elle était près de
`
penser qu’elle était seule à s’inquiéter du sort fait à ce lieu populaire et public, elle
comprend vite que c’est l’endroit vers lequel ont tout naturellement convergé les artistes
utilisateurs et les sympathisants, alertés par pyramide téléphonique. Une petite
soixantaine de personnes est ainsi postée derrière les grilles du parc, sur la fontaine ou
dans les arbres. Les plus hauts racontent ce qu’ils voient à ceux qui sont au sol, les
discussions vont bon train mais Gabrielle ne saisi rien de ce qui se dit. Pour cela il faudrait
qu’elle se mêle à eux or elle hésite à traverser pour regagner le square car le contrat socio-
économique qu’elle a signé avec l’administration lui interdit de se permettre une telle folie.
Elle est tenue au devoir de réserve, elle ne peut ni militer ni manifester et même sa
`
présence ici à cette heure peut paraître suspecte. Elle tourne donc les talons pour
reprendre la direction de la cité administrative quand une main retient son bras.
« Gabrielle ? C’est bien vous ?
![]() Oui, Cest moi. Vous allez bien ? » Antoine reste un instant surpris de la trouver ici, cela
Oui, Cest moi. Vous allez bien ? » Antoine reste un instant surpris de la trouver ici, cela
lui fait plaisir car il s’imagine qu’elle est là pour les soutenir.
« C’est là-bas que ça chauffe, dit-il en indiquant le Grand-Hôtel.
![]() Que se passe-t-il ?
Que se passe-t-il ?
![]() Ils n’ont encore rien fait, pour l’instant ils empêchent toute entrée. Ils croyaient investir
Ils n’ont encore rien fait, pour l’instant ils empêchent toute entrée. Ils croyaient investir
un bâtiment vide mais il y a du monde. Ils sont nombreux à être resté après la réunion car
j’ai lu votre article hier soir, enfin celui que vous avez trouvé. Ça tombe plutôt bien, cela
pose un autre rapport de force et je pense que nous pourrons …
![]() Ah oui, l’article …
Ah oui, l’article …
![]() Oui ! Il est tombé pile poil !
Oui ! Il est tombé pile poil !
![]() Bon, et bien je vous laisse.
Bon, et bien je vous laisse.
![]() Comment ? Vous allez au bureau ?
Comment ? Vous allez au bureau ?
![]() Oui …
Oui …
![]() Pas aujourd’hui, pas un jour pareil ! Nous avons besoin de vous, il faut s’organiser pour …
Pas aujourd’hui, pas un jour pareil ! Nous avons besoin de vous, il faut s’organiser pour …
![]() Non, non. Je vous laisse à tout cela. » Répond Gabrielle en se dégageant du bras
Non, non. Je vous laisse à tout cela. » Répond Gabrielle en se dégageant du bras
d’Antoine.
« À bientôt ? Demande-t-il.
![]() Oui, oui, à bientôt ! »
Oui, oui, à bientôt ! »
Gabrielle file alors jusqu’à son poste où elle arrive juste à l’heure pour pointer. Elle
ôte sa veste de lin bleu et ouvre la fenêtre. Sa réaction l’agace. Que pensera Antoine ? Il va
la considérer comme une femme sèche et aride qui se désintéresse du sort des Ateliers ou
une soumise qui préfère aller travailler, craignant de perdre son job. Et peut-être n’a-t-il
pas tort. Son seul souhait est de passer inaperçue, rester à l’écart. Elle se dit depuis
toujours qu’elle n’a aucun talent pour participer aux soubresauts symptomatiques de
l’organisme social, les luttes sectorielles syndicales ou patronales sont pour elle des
complications supplémentaires dans un monde déjà bien complexe et difficile à apprécier.
Alors elle s’est inscrite dans le système et accepte son rôle. Parfois sa lâcheté l’accable, lui
donne l’impression d’étouffer et c’est lorsque cela devient insupportable, lorsqu’elle souffre
trop de cet abandon tacite de toute volonté individuelle qu’elle ouvre la fenêtre.
A midi lorsque son travail est terminé, c’est ce qu’elle fait en premier. Elle respire
profondément, se laisse saisir par la fraîcheur du vent du nord qui contraste avec la chaleur
de cet été naissant. En bas sur la chaussée peu de véhicules circulent. Les trottoirs en
revanche sont bondés d’employés pressés de profiter de leur pause, ils vont tous dans le
même sens, en un flot placide et bien élevé qui prend ses sources sur le pas de porte des
immeubles administratifs pour s’écouler sans heurts ni chahut vers les différentes
cantines, selfs et restaurants rapides et économiques, installés tout autour dans les rues
avoisinantes.
Seul un homme remonte le courant. Il fend l’onde d’un sillage net, avance vers
l’entrée de l’immeuble duquel Gabrielle se penche un peu pour confirmer ce que la
démarche et l’allure de cet original lui font pressentir : ça ne peut être qu’Antoine. Il la
salue au passage avant de s’engouffrer dans le hall.
« Mais qu’est-ce qu’il trafique ? »
Gabrielle range ses documents, referme la fenêtre et passe sa veste pour partir. Et
puis elle se reprend et fait l’opération inverse si bien qu’Antoine la trouve à son bureau
occupée à disperser quelques feuilles.
« Salut ! lance-t-il en entrant.
![]() Bonjour, bafouille-t-elle comme s’ils ne s’étaient pas encore vus.
Bonjour, bafouille-t-elle comme s’ils ne s’étaient pas encore vus.
![]() Vous revenez déjà ?
Vous revenez déjà ?
![]() Rien ne se passe, il faut bien que je bosse un peu !
Rien ne se passe, il faut bien que je bosse un peu !
![]() Ils négocient ?
Ils négocient ?
![]() Oui ça bataille ferme là-dedans. Avec en plus la pression de la rue et les médias qui seront
Oui ça bataille ferme là-dedans. Avec en plus la pression de la rue et les médias qui seront
bien obligés d’en parler, ils ne peuvent plus faire ce qu’ils veulent. Ah sinon, c’était cuit !
Les salauds investissaient le bâtiment et puis ils nous imposaient un administrateur le
temps qu’on plie bagages. Alors là ce n’est pas à un déménagement qu’on aurait eu droit,
c’est à une mise sous tutelle !
![]() Vous y allez peut-être un peu fort …
Vous y allez peut-être un peu fort …
![]() Non, non, c’est bien comme ça que les choses devaient se passer. Car la lettre qu’on a
Non, non, c’est bien comme ça que les choses devaient se passer. Car la lettre qu’on a
reçue hier, …
![]() Oui ?
Oui ?
![]() C’est un faux.
C’est un faux.
![]() Comment ça un faux ?
Comment ça un faux ?
![]() C’est bien quelqu’un de la mairie qui l’a écrite, en utilisant un vrai papier en-tête et de
C’est bien quelqu’un de la mairie qui l’a écrite, en utilisant un vrai papier en-tête et de
vrais codes barres municipaux, il l’a rédigé pendant son service de nuit parce que c’était le
dernier, lâche Antoine d’un ton grave.
![]() Pardon ?...
Pardon ?...
![]() Son service, reprend-il aussitôt. Il a été viré de son boulot de veilleur de nuit. Après Huit
Son service, reprend-il aussitôt. Il a été viré de son boulot de veilleur de nuit. Après Huit
ans. Au beau milieu de toutes ses traites et crédits dont il était si content paraît-il. Il a
déchanté. Il a dégoupillé oui. Il risque gros.
![]() Et pourquoi vous a-t-il écrit spécialement à vous ?
Et pourquoi vous a-t-il écrit spécialement à vous ?
![]() Pas qu’à nous, il a fait un lot !
Pas qu’à nous, il a fait un lot !
![]() Un lot ?
Un lot ?
![]() Et bien il a voulu se venger de la façon dont la mairie le remerciait alors il a rédigé trois
Et bien il a voulu se venger de la façon dont la mairie le remerciait alors il a rédigé trois
lettres bidons pour prévenir de certaines histoires qui circulent dans les couloirs. Un
instant il a hésité à utiliser les fichiers contacts de la mairie pour envoyer sa prose à toute la
ville et puis il s’en est tenu aux seuls intéressés.
![]() Dont les Ateliers.
Dont les Ateliers.
![]() Oui.
Oui.
![]() Et vous savez ce que contiennent les deux autres lettres ?
Et vous savez ce que contiennent les deux autres lettres ?
![]() Non, je ne sais que ce qui filtre par-ci par-là. Ce sont les journalistes venus pour couvrir
Non, je ne sais que ce qui filtre par-ci par-là. Ce sont les journalistes venus pour couvrir
notre expulsion qui ont donné ces quelques détails ; c’est Jo qui les a reçu. Il paraît que le
gars a été arrêté et qu’il a avoué être l’auteur des lettres. C’est sympa de sa part de nous
avoir prévenu, d’ailleurs on a vraiment cru à un courrier officiel, mais le pauvre homme
risque le séminaire de reclassement : il va finir en légume.
![]() Et que va-t-il se passer pour les Ateliers ?
Et que va-t-il se passer pour les Ateliers ?
![]() On ne le sait pas encore. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle car c’est grâce
On ne le sait pas encore. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle car c’est grâce
à vous et à l’article que tant de monde est resté après la réunion. Surpris par la nuit et le
couvre-feu, ils ont préféré rester sur place. Ça leur a donné l’occasion de discuter. Bruno
m’’expliquait tout à l’heure qu’il fut longuement question de ces espaces de liberté qui sont
rognés de tous côtés par une lente progression de l’artificiel sur le naturel, et du
remodelage du monde alentour qui accompagne ce mouvement. Et puis la réflexion glissa
de la question de l’espace à celle du temps, car on occupe le temps autant qu’on occupe
l’espace. Et si nous n’avons guère de prise sur ce dernier, au moins le temps que nous
avons à vivre nous appartient de fait.
Sur cette terre je ne vois d’ailleurs que deux choses sur lesquels nous ayons quelques
droits : notre corps et notre temps. Sil semble acquis que la liberté réserve à chacun le
loisir de faire ce que bon lui semble de son corps, il ne manque plus qu’à considérer la
liberté de temps aussi primordiale que la liberté de mouvement. De ce point de vu, les
intégrés qui choisissent le service minimum sont en avance pour initier une nouvelle
société, enfin débarrassée du totalitarisme temporel car la plus grande partie de notre
temps depuis l’école jusqu’à la retraite est subtilisé, absorbé, détourné. On se laisse
dépouillé de nos instants pour conserver au moins la vie sauve et jouir des interstices que
laisse le système après avoir exigé sa part.
On prétend que c’est pour le bien de la collectivité que chaque individu doit ainsi
renoncer à sa liberté de temps. Or la collectivité dans son accélération incessante, dans sa
croissance éperdue vers le mieux ne facilite les choses à personne. Elle déplace des
montagnes, détourne les océans et refaçonne l’atmosphère terrestre sans que cela
n’améliore d’une quelconque façon notre manière d’être humains sur Terre, ensemble et
variés, libres et responsables. Alors à quoi bon continuer à alimenter une machine qui
détruit notre planète, qui la transformera en poubelle invivable et qui, pour atteindre son
but, se nourrit en parasite sur cette dîme que chacun est contraint de lui verser en temps et
en heures ?
![]() Ne vous énervez pas Antoine, Madame ... va débarquer.
Ne vous énervez pas Antoine, Madame ... va débarquer.
![]() Je m’en fous de Madame … ! Réplique-t-il. Mais vous avez raison, inutile de s’énerver,
Je m’en fous de Madame … ! Réplique-t-il. Mais vous avez raison, inutile de s’énerver,
tout cela n’est pas si grave bien sûr ... Vous faites combien vous déjà ?
![]() Quinze heures. Avec ça je vis correctement.
Quinze heures. Avec ça je vis correctement.
![]() Et que faites vous du reste ?
Et que faites vous du reste ?
![]() De mon temps libre ?
De mon temps libre ?
![]() Oui.
Oui.
![]() Et bien je me promène, je lis, je fais la cuisine …
Et bien je me promène, je lis, je fais la cuisine …
![]() Vous n’êtes pas dans un club ? Vous n’avez pas une passion ? Ou du sport ? Vous suivez
Vous n’êtes pas dans un club ? Vous n’avez pas une passion ? Ou du sport ? Vous suivez
bien un cours de yoga ou de chant ? Du dessin peut-être ?
![]() Non, non, non. Rien de tout cela. Enfin pas en ce moment. Mais pourquoi toutes ces
Non, non, non. Rien de tout cela. Enfin pas en ce moment. Mais pourquoi toutes ces
questions ?
![]() Vous êtes une drôle de fille Gabrielle. On dirait que vous vivez dans un autre monde.
Vous êtes une drôle de fille Gabrielle. On dirait que vous vivez dans un autre monde.
![]() Ah oui ? Et bien d’ailleurs je redécolle ! Vous restez pour travailler un peu ?
Ah oui ? Et bien d’ailleurs je redécolle ! Vous restez pour travailler un peu ?
![]() J’ai un truc à finir, oui. On se verra plus tard ...
J’ai un truc à finir, oui. On se verra plus tard ...
— C’est ça, à plus tard. »
l’echappée
Une fois Gabrielle sortie, Antoine rallume l’écran tactile pour se brancher sur le
système. Il n’a rien de spécial à terminer. Son travail peut bien attendre. Par contre la
situation des Ateliers est critique et tout doit être mis en œuvre pour renverser la tendance.
Que l’ordre d’expulsion vienne de la mairie ou qu’il ait été conçu ailleurs pour entrer dans
un plan plus global de pillage de l’espace public par les intérêts privés, cela revient au
même : le collectif risque d’être jeté à la rue dans une quasi indifférence, vu que bien peu
d’individus sont prêts à risquer leur réputation, ou à perdre leur temps, pour sauver un lieu
de création fréquenté surtout par la basse caste des minima. Alors une seule chose reste à
faire : préparer la prochaine occupation. C’est dans ce but qu’Antoine a été chargé par le
bureau élargi de l’asso de reprendre contact avec quelques vieux de la vieille, des anciens
des Ateliers qui ont l’habitude de ce genre d’exercice. Déjà ils ont une cible : un collège vide
dans lequel s’installer vite fait, une équipe doit en prendre possession avant que le reste de
la troupe ne débarque en fanfare. Pour éviter que quoi que ce soit ne transpire aux Ateliers,
Antoine préfère agir seul dans la plus grande discrétion et pour cela il commence par
rédiger un message qu’il envoie par le net aux anciens dont il a l’adresse :
« La société Comme à l’atelier vous annonce avec joie que vous avez gagné une boite
à outils multi-fonctions. Serrurerie, plomberie, électricité, tout vos travaux d’aménagement
seront simplifiés grâce à cette mallette d’une valeur de 42 YES. Venez la retirer dès
aujourd’hui et découvrez notre nouveau magasin situé dans la zone industrielle du Pigeon.
Pour tout renseignement une opératrice est à votre disposition, n’hésitez pas à nous
contacter au 876654 — service sans taxe. »
La société Comme à l’atelier est une blague qui date de l’époque de St-Cyp. Ils
avaient imaginé un soir d’agapes pittoresques de lancer une boîte d’entertenment à la con
dont le concept génial était de transférer sur demande et à tout endroit dans le monde leur
atelier collectif. Ainsi ils élevaient leur réalité quotidienne au rang d’œuvre d’art et par
certains côtés le spectacle brut et sans fard de leurs existences mêlées aurait bien pu
produire chez certains spectateurs un effet des plus inattendus. Pourtant, on ne peut pas
provoquer sur commande une énergie collective créatrice et la magie des aventures
communes n’a de réel charme que lorsqu’elle est spontanée, alors plutôt que d’attendre ici
que sa messagerie l’avertisse d’un éventuel contact, plutôt que de se perdre dans les marais
nostalgiques de sa mémoire en rêvant d’une nouvelle épopée, Antoine décide de sortir.
En bas dans la rue, il retrouve les administratifs qui rentrent ruminer leurs
paperasses sans fin ; Antoine a l’humeur joyeuse des enfants qui faisaient l’école
buissonnière, à l’époque où demeuraient encore quelques buissons sur le chemin de l’école,
il sourit donc à tout va et puis devant la réaction outrée des passants qu’il croise il retend
aussitôt le masque crispé, arrogant et soumis qui a court de nos jours dans les milieux les
plus divers. En réalité Antoine se dit aussi que s’il ne maîtrise pas mieux son
comportement il risque d’attirer l’attention, alors pour passer plus inaperçu il adopte la
démarche commune : le pas appuyé, un port un peu courbé il avance en lustrant le sol du
regard.
Cependant, ne se fixant nulle part en particulier son regard enregistre plus ou moins
consciemment mille petites scènes enchaînées qui lui donnent ensemble une intuition
globale de l’ambiance de la rue. Tout à l’air calme et détendu autour de lui. Sur les trottoirs,
on livre encore quelques marchandises qui seront écoulées avant la fermeture ainsi le
lendemain matin tout pourra recommencer. Le système est si bien conditionné qu’aucun
retard ni dommage n’est jamais signalé, tous les produits sont fabriqués à temps, chaque
consommateur remplit son devoir, tout ça sans histoire, sans réclamation. Antoine décide
d’aller marcher une heure ou deux dans la ceinture végétale naturelle qui donne à la ville
verte son épithète.
Pensant aller plus vite il saute dans un bus qui se présente bondé et si étouffant qu’il
retourne dehors dès que la lente digestion du véhicule lui permet d’atteindre la porte de
sortie. Sans se précipiter il reprend d’abord son souffle puis sa place dans le trafic, sans
geste déplacé. Car à de menus détails dans l’attitude d’un individu certains décrypteurs
doués du CIU : centre d’imagerie urbaine sont capables de suivre quelqu’un à travers la
ville. Les carrefours forment des points clés où le moindre geste anormal est analysé et
recoupé ; Antoine le sait alors il freine l’enthousiasme idiot qui le pousse vers le pauvre
lambeau de nature préservée qui reste dans les parages. Quand il ne supporte plus la ville
c’est là qu’il vient.
Ici la forêt n’est pas artificielle, les arbres sont de vrais arbres réels qui diffusent
leurs essences et s’agitent dans le vent. Une averse récente a laissé sur les feuilles et les
arbustes une fine pellicule argentée que le soleil par ses rayons fait miroiter. C’est comme
si Gaïa telle qu’elle est se présentait à lui : nue et fraîche sur le sol gai, le corps et les
cheveux défaits, ruisselants d’une brume légère. En respirant sur un rythme de plus en
plus ample Antoine avance sur le sentier, il plonge sous les branches dans un ravissement
de lumière pour disparaître au yeux du monde le temps d’une promenade, alors, il peut se
laisser aller à être tel qu’il est. Les plantes ne le jugent ni ne le remarquent, les oiseaux
s’accommodent de sa présence et tant qu’il ne croise personne il parvient à se sentir bien.
Au bout d’une heure il s’arrête pour consulter un plan de la zone verte et se situer.
De nombreux chemins sillonnent la forêt, qui permettent à Alex de jouer à s’y perdre. Au
bout d’une heure il voit où il est puis il rentre, toujours à contrecoeur tant l’intégration lui
est pénible, mais aujourd’hui il sait très bien où il est et il ne fait que vérifier qu’en
continuant sur le tracé bleu il rejoindra bientôt la piste cyclable signalée par Alex. Trois
cent mètres plus loin sans hésiter il s’y engage à pied, même si ces pistes sécurisées ont été
conçues pour maintenir la circulation des vélos, planches et chaussures à roulettes,
landeaux, poussettes, tricycles et tandems bien éloignés des rues laissées au totalitarisme
automodébile* ; une certaine tolérance est cependant admise lorsque de courageux piétons
s’y aventurent. Comme il arrive de l’extérieur et non du centre, les indications d’Alex ne
sont plus aussi pertinentes. Les murs de béton qui protègent la piste lui masquent la vue si
bien qu’au bout d’un moment Antoine ne sait plus très bien s’il se trouve avant ou après la
passerelle.
Doit-il continuer en direction du parc Aratta ou doit-il faire demi-tour ? Pour en
avoir le cœur net il décide de jeter un coup d’œil par l’un des hublots de plexi qui se
succèdent tout les dix mètres, espérant relever dans la rue en contre-bas un détail qui lui
permettra de se repérer. Il s’assure que personne n’est avec lui dans le tunnel puis il
s’accroche et se hisse le long de la paroi. C’est à grand peine, les coudes meurtris et les
muscles vacillants qu’il parvient à se hisser jusqu’à la vitre sale, opaque comme une vue de
jeune myope. La rue est toute proche mais il ne parvient pas à reconnaître l’immeuble qui
s’élève en face.
« Bordel ! C’est pas vrai ! » Antoine reste un instant ainsi suspendu, lorsqu’il
aperçoit au loin une femme qui vient vers lui. Sans trop y penser il se laisse retomber et
reprend sa route en direction du centre, ce n’est qu’après coup qu’il s’inquiète de
l’interprétation possible de ce geste maladroit : la femme risque de flipper et s’imaginer
qu’il prépare un coup tordu. Il accélère un peu le pas, après quelques dizaines de mètres
Antoine ne peut s’empêcher de se retourner pour observer la réaction de la jeune femme.
Celle-ci ne semble pas inquiète, elle effectue un jogging dynamique dont la vive allure la
porte bientôt jusqu’à sa hauteur. Il s’arrête alors et s’efface pour la laisser passer.
Or la sportive est maintenant surprise par ce nouveau revirement, dans un geste de
repli brusque et défensif elle se heurte en pleine course à la paroi de crépi. Un instant
Antoine s’apprête à la retenir d’une chute quand la jeune femme lévite, tente de se dégager
et finit par tomber. D’un regard noir elle fusille sans procès celui qui l’a effrayé et
lorsqu’Antoine avance encore pour l’aider, devant ce type louche qui semble à ses trousses,
la femme se met à hurler, elle panique et puis d’un bond se relève en une position figée
néanmoins caractéristique dans laquelle Antoine reconnaît jigotaï : posture défensive
propre au judo. Avec la plus grande prudence il continue néanmoins à marcher vers elle.
« Je m’excuse de vous avoir fait peur, commence-t-il.
![]() Avance connard, va-z-y avance si t’oses ! »
Avance connard, va-z-y avance si t’oses ! »
Antoine reste stupéfait. Il voudrait bien laisser cette folle à ses lubies, continuer son
chemin sans y prêter attention mais elle encombre la largeur du tunnel et semble bien
prête à en découdre. Alors pour éviter d’aggraver la situation il recule doucement de
quelques pas.
« Je vous répète que je ne vous veux aucun mal. Mon comportement est sans doute un peu
incompréhensible, mais je n’en ai pas après vous. »
Sans savoir quelle attitude adopter à présent, la joggeuse finit par baisser la garde,
elle recule elle aussi autant qu’elle peut tout en gardant un œil sur ce cinglé et puis elle sort
de sa banane un micro-téléphone. Cela suffit à faire réagir Antoine : il la bouscule pour
prendre le large et au passage tente en vain d’attraper le portable ; maintenant il n’a pas
autre choix que de courir vite pour sortir de ce fichu tunnel s’il ne veut pas bientôt se
retrouver pris au piège.
Gabrielle raccroche le combiné avant de retourner se caler dans son fauteuil favori.
Entre six heures et huit heures du soir il n’est pas rare qu’elle soit dérangée pour répondre
par téléphone à des enquêtes bidons. Cette fois-ci, l’étude portait sur le temps libre et la
manière dont elle l’occuperait si elle en avait plus. En ne travaillant que quinze heures par
semaine, Gabrielle a déjà fait le choix de conserver pour son propre usage la majeure partie
de son temps capital ; elle s’amuse tout de même à écouter la lithanie des passe-temps
possibles énoncés par une opératrice vive et appliquée. Au fur et à mesure elle n’en retient
qu’une poignée : se promener ; cuisiner ; lire ; voyager ; visiter des musées, des expos ou
des galeries ; aller au ciné ; pratiquer l’écriture, la peinture ou un instrument de musique ;
faire du théâtre, de la danse ou du sport ; apprendre une langue étrangère, régionale ou
même morte ; jardiner ; passer du temps en famille, avec ses enfants, ses amis.
Voilà à quoi Gabrielle peut occuper son temps libre, dans le désordre et sans calcul,
au gré de ses inspirations quotidiennes. Si elle n’était pas obligé de céder sa dîme
temporelle au système elle laisserait bien toutes ses journées s’écouler sans contrainte, au
jour le jour elle organiseraïit sa vie elle-même car elle considère qu’elle est la mieux placée
pour choisir de faire ce qui est bon pour son évolution. Pour se protéger elle fuit déjà
autant que possible toute activité de groupe, dans lesquels la pression et l’acceptation
tacite de règles et de codes préconçus enferment l’individualité dans une norme acceptable.
Même les groupes les plus hors normes, les plus en marge ou les plus avant-gardistes
construisent autour d’eux une membrane qui les isole du milieu ambiant.
Ce procédé ressemble à celui qui, il y a bien longtemps, fit peut-être naître les
premières cellules organiques au fond des océans tout près de chaudes fumerolles de
soufre ou de méthane dont s’échappaient des bulles. Ces petites bulles en se formant
piégeaient quelques éléments avant de remonter vers la surface, et au cours de ce voyage
les molécules, les atomes et les ions retenus dans la sphère formaient ensemble un groupe
particulier, isolé du milieu aqueux ambiant par la bulle de gaz qui les enveloppait. Sans le
savoir ces bulles créaient un intérieur et un extérieur, un dedans et un dehors, un englobé
et un englobant et dans chacune d’elles les éléments contenus subissaient alors des
contraintes nouvelles, des variations de pression, de température et de gravité qui ont
peut-être eu pour effet de modifier du même coup les échanges et les combinaisons
possibles entre particules et énergies embarquées.
Chacune de ces bulles devenait comme un monde dans lequel pouvaient se déployer
le temps de l’ascension une évolution un tout petit peu différente de celle qui avait lieu
autour, dans le milieu marin. Et peut-être est-ce ainsi, à force d’élévations successives que
des atomes ont fini par épouser la forme de la sphère pour construire cette paroi
perméable qui délimite et rend possible la première cellule vivante. Une fois le cadre
défini, en son sein les éléments chimiques ont pu prendre leur autonomie vis à vis de
l’extérieur, puis cette cellule s’est spécialisée, ses fonctions se sont diversifiées pour ensuite
s’associer jusqu’à former des organismes multicellulaires se complexifiant peu à peu.
Pour que des humains vivent ou travaillent ensemble il semble qu’eux aussi soient
obligés de fabriquer un cadre dans lequel ils établissent un ordre et des règles spécifiques.
Or Gabrielle fuit comme elle le peut les groupes et les clans, les nationalismes et les
communautarismes qui sont comme autant d’écrans posés là pour masquer notre
appartenance commune au genre humain, à la Vie, qui reste le seul principe englobant
capable de réunir en son sein les formes les plus diverses, les plus variées, les plus
multiples, les plus contraires, les plus complémentaires. A heure de l’organisme global, à
l’heure où la planète Terre devrait être enfin reconnue et respectée comme un être vivant,
peut-être est-il temps pour chaque petit groupe humain de renoncer à une suprématie
unique et autoritaire afin que la communauté de toutes les individualités singulières qui
existent encore, vive en paix. Pendant des lustres, des générations se sont succédées,
essayant d’innombrables systèmes de vie collective.
N’y a-t-il pas dans toutes ces expériences, toutes ces aventures, ces mythes, assez
d’éléments pour tenter d’imaginer un système cohérent capable de redéfinir un projet
humain inscrit dans le déroulement de la vie de la Terre ? Est-ce par paresse ou par orgueil
que l’on se contente de pilonner l’inconscient collectif d’images fausses, de rapports
humains biaisés, d’émotions feintes plutôt que de donner à tous la possibilité de réfléchir
aux améliorations possibles à apporter au fonctionnement de l’ensemble ? Sans s’en rendre
compte, ou par goût de la perversion, les fabricants de fantasmes modernes remodèlent à
coup de pubs et de fictions la part de notre cerveau dont le fonctionnement nous échappe.
Depuis la multiplication exponentielle des mondes virtuels et des réalités possibles un
glissement s’opère de l’état de nature vers un état d’artifice ; beaucoup d’individus sont en
passe de basculer hors du monde réel et rien ne semble contenir ni même accompagner ces
changements profonds. C’est à tout cela que pense Gabrielle quand elle a le temps. C’est
pour ne pas perdre de vue qu’elle participe à un processus global qui peut être nommé Vie
ou Univers, qu’elle évite de limiter son évolution à un cadre politique, religieux ou autre
dans lequel elle serait obligée d’accepter une hiérarchie formelle et encouragée à adopter la
ligne de conduite qui sied au groupe, édifiée par une communauté dont elle dépendrait.
Au bord de l’apoplexie, Antoine tousse et peine à retrouver son souffle. Il est
parvenu à regagner l’extérieur sans encombre mais sans non plus avoir déposé la boîte à
l’endroit prévu. Cette seconde mésaventure en deux jours vient semer le trouble dans son
esprit déjà bien barbouillé. Il glisse sa main dans la poche de sa veste et sent sous ses
doigts la petite boîte sculptée. En une semaine ce présent singulier est la seule chose
positive qui lui ait été accordée par le destin : il a d’abord perdu son bureau et peut-être
bientôt son boulot, les Ateliers sont menacés de fermeture ou de récupération, son vélo est
une épave et si la joggeuse va se plaindre chez les flics il risque d’être recherché. C’est
comme si tout se liguait contre lui, comme si le sort l’avait pris en grippe. Que peut-il
espérer maintenant ? Quel avenir a-t-il si tout s’effrite sous ses pas ?
Il va devoir se tenir à carreau, ne plus se faire remarquer s’il veut au moins
conserver son statut d’intégré. Or plus ça va, moins il est capable de supporter l’hypocrisie
et les contraintes du jeu social. Après tout, peut-être que sa place n’est plus ici, en ville.
Peut-être que ces incidents successifs sont des invitations à partir, à s’éloigner pour de bon
de ce système qui l’étouffe. Il a tant rêver de vivre autre chose, de s’élever pour ne plus être
prisonnier du mécanisme aliénant de la machine productiviste que la vie lui donne peut-
être aujourd’hui l’occasion, les raisons de tout quitter.
A bien y réfléchir il se peut que s’offre à lui maintenant une nouvelle vie, un
changement radical qui le pousse à agir pour dépasser les propos de la critique sociale et
s’aventurer plus loin, vers la construction d’une réalité enfin acceptable. Antoine avance et
plus il approche des Ateliers plus il sent que le moment est venu, pour lui, de prendre le
large. Lorsqu’il se mêle aux manifestants qui campent encore dans le square il est plus seul
que jamais, il est plus distant et plus détaché que jamais. D’un signe il invite discrètement
Robert à le rejoindre sous un arbre, où ils seront plus tranquilles pour discuter.
« Salut Antoine, qu’est-ce que tu fous là ? Les anciens ont déjà répondu ?
![]() J’ai fait passer le message, ils ne tarderont pas à se manifester.
J’ai fait passer le message, ils ne tarderont pas à se manifester.
![]() Qu’est-ce qui cloche ? »
Qu’est-ce qui cloche ? »
Antoine reste peu loquace et Robert qui connaît sa verve et son emphase comprend
que quelque chose le préoccupe.
« Ecoute Robert, j’ai eu une embrouille. Une bonne femme qui m’a pris pour un barjot ...
Elle allait appeler les flics, alors j’ai dû …
![]() Qu’est-ce que t’as fait comme connerie ?
Qu’est-ce que t’as fait comme connerie ?
![]() Rien, je l’ai bousculé avant qu’elle téléphone et puis je me suis barré.
Rien, je l’ai bousculé avant qu’elle téléphone et puis je me suis barré.
![]() ’tain et tu crois qu’elle va cafter ?
’tain et tu crois qu’elle va cafter ?
![]() J’en sais rien, je crois qu’il vaudrait mieux que je me mette au vert quelques temps.
J’en sais rien, je crois qu’il vaudrait mieux que je me mette au vert quelques temps.
![]() Attends on a besoin de tout le monde, c’est pas le moment de prendre des vacances !
Attends on a besoin de tout le monde, c’est pas le moment de prendre des vacances !
![]() Ş’agit pas de vacances, je crois que je suis grillé. Depuis une semaine rien ne tourne rond,
Ş’agit pas de vacances, je crois que je suis grillé. Depuis une semaine rien ne tourne rond,
j’accumule les gaffes et les bévues.
![]() Tu déconnes Antoine. Ca c’est passé où ton histoire, qu’est que tu lui as fait ?
Tu déconnes Antoine. Ca c’est passé où ton histoire, qu’est que tu lui as fait ?
![]() J’lui ai rien fait. Cette nana m’a surpris,
J’lui ai rien fait. Cette nana m’a surpris,
![]() T’a surpris ?
T’a surpris ?
![]() Ouais … elle a cru je sais pas quoi et maintenant je suis sûr qu’elle va me coller les flics
Ouais … elle a cru je sais pas quoi et maintenant je suis sûr qu’elle va me coller les flics
sur le dos.
![]() C’est nimporte quoi. Qu’est-ce que tu foutais pour qu’elle te surprenne ?
C’est nimporte quoi. Qu’est-ce que tu foutais pour qu’elle te surprenne ?
![]() Bon d’accord, faut que je te replace dans le contexte. J’ai rencontré un type hier, un non-
Bon d’accord, faut que je te replace dans le contexte. J’ai rencontré un type hier, un non-
intégré.
![]() Ouais !?
Ouais !?
![]() On a discuté deux minutes et il m’a confié une teboî — Antoine sort la boîte de sa poche —
On a discuté deux minutes et il m’a confié une teboî — Antoine sort la boîte de sa poche —
à poser dans un coin le long d’une piste cyclable. »
Robert ausculte la cause de tant d’histoires, au bout de quelques secondes il détaille
Antoine du même regard perçant.
« Bon. S’il faut que tu disparaisses quelques jours, vois ça avec Johanne. Je sais pas ce que
tu délires … Tout ce que j’sais c’est qu’on est déjà pas beaucoup à se bouger le cul ici, et
maintenant il faut que tu nous laisses tomber pour des histoires à la con. Ça fait chier ! »
La colère de Robert est justifiée. Cela ne l’amuse pas de voir partir Antoine, il sait
bien que ce dernier ne remettra plus les pieds en ville et qu’ils ne se reverront que lorsque
lui-même sera contraint d’échapper au système. Il le rejoindra alors, lui et d’autres qui ont
déjà opté pour la rupture. Dans un sens il est content pour lui, Antoine va pouvoir
s’épanouir un peu et mener la vie qu’il souhaite mais la chose est si soudaine que cela
ressemble à un abandon, une fuite vers l’extérieur alors que les choses tournent mal pour
les Ateliers. Sans effusions superflues les deux hommes se saluent et se souhaitent bonne
chance, puis Antoine s’éloigne du groupe des manifestants pour regagner son domicile. Là
il téléphone à Johanne qui lui donne rendez-vous pour le lendemain à seize heure, devant
chez elle. Elle lui recommande de ne prendre avec lui que le strict minimum et surtout de
ne pas faire de vagues dci là.
le départ
Ne pas faire de vagues ? Antoine n’a nullement l’intention de gâcher cette chance
qui se présente à lui. Si c’était possible il partirait direct, là maintenant. Sa marche de
l’après-midi lui fait l’effet d’un avant goût, de cette liberté qu’il gagne en devant fuir. Car
c’est bien dans la nature qu’il trouve ses marques et son rythme à lui, ne serait-ce que
lorsqu’il marche, au bout de quelques kilomètres son diaphragme s’ouvre et son corps tout
entier s’anime et se déploie. Ensuite son regard change, délaissant le sol et ses pieds il se
projette au loin pour embrasser le paysage, enfin son esprit se libère, chasse toute pensée
mesquine, toute crainte de paraître pour être enfin, tranquille et attentif.
A peine a-t-il refermé la porte derrière lui qu’Antoine suffoque. Il sent sur ses
tempes perler par gouttes cette saine énergie que la promenade a libéré. Il va partir, il ne
doit pas faire de vagues. Mais ses mains sont moites, un frisson lui balaie la colonne
vertébrale puis un autre, ses mâchoires ce crispent. Alors pour calmer l’impatience
fiévreuse qui lui monte dans les veines Antoine se lance avec fébrilité dans un tri sommaire
de ses affaires. Un instant il contemple d’un œil amusé tout le foutoir qu’il a pu accumuler
dans un si petit espace : les livres lus et relus, les disques usés jusqu’au fond du sillon,
quelques frusques, la vaisselle ; et puis les bibelots, bidouilles et vieilleries qu’il récupère
par terre, dans la rue depuis des lustres, et les innombrables cailloux et morceaux de bois
qu’il récolte et conserve malgré les interdictions, sous prétexte que quelque chose dans leur
forme ou leur aspect lui font voir un visage, une silhouette ou quelques traces secrètes que
la nature place sous nos pas.
Soudain heureux de comprendre que pour lui c’est terminé, Antoine est pris d’une
joie ravageuse qui le pousse à régler au plus vite les questions pratiques. Une pensée vient
de lui traverser l’esprit. Il a quelque chose à faire avant de partir alors pour expédier les
affaires courantes il trie tout ce bordel vite fait en deux tas dépareillés : un pour la vaisselle,
les tissus, la literie, les fringues et les chaussures ; un second de livres, revues, flys, disques,
journaux et vidéos : documents multiples tous nourris de critique sociale ; enfin un sac de
marin et une valise de fer blanc renferment l’essentiel, qu’il emportera avec lui. Délaissant
l’écran intégré au mur qui sert de mémo, télé, lecteur multiple et aussi de concierge,
Antoine attrape un bloc note en papier sur lequel il rédige à l’attention de Johannes un mot
d’explication :
« Salut Johannes, Voici tout mon petit bordel. Les fringues, la literie et la vaisselle
peuvent servir à aménager une nouvelle piaule, la documentation est à faire passer au
CRAS*, Je compte sur toi, merci. Antoine. »
Alors, ayant fait le deuil de son intérieur confortable et normé, Antoine se retrouve
debout une valise à la main, un sac à ses pieds et au fond de l’âme des pensées nauséeuses
venues d’une répulsion physique et immédiate qui lui font prendre en effroi son habitacle.
Il ne pourra pas rester là très longtemps, il sent ses forces qui s’agitent et son énergie qui
déborde. Il ne pourra pas supporter d’attendre des heures, il doit sortir.
Peut-être à cause de la pleine Lune, à moins que ce ne soit la sauce épicée ou encore
ces bruits de télé qui résonnent dans l’immeuble, une fois de plus Gabrielle se tourne dans
son lit à la recherche du sommeil. Le cadran moulé dans la table de chevet marque deux
heures cinquante et une : une bonne heure pour les insomniaques : l’heure où ils peuvent
goûter à la joie de se sentir seuls en ville. Gabrielle préfère se moquer d’elle même plutôt
que de s’énerver. Voyant que son esprit s’obstine à rester sur ses gardes elle décide de
l’aider un peu à lâcher prise en opérant sur les muscles de son corps et particulièrement
ceux du dos et de la nuque. A cet effet elle roule une cigarette d’herbe douce qu’elle allume
dans le noir, la tête calée par deux gros oreillers verts.
Pourquoi Gabrielle s’en veut elle d’avoir quitter Antoine cet après midi sur un
sentiment amère ? Lorsqu’ils se sont croisés près des Ateliers elle a préféré fuir au plus vite
pour rentrer sagement au bureau, ensuite lorsqu’il est revenu elle n’a su que se braquer.
Pourquoi ne parvient-elle pas à être plus douce et accessible ? Pourquoi son comportement
va-t-il à l’inverse de ce que son cœur ressent ? Peu à peu, l’effet de détente attendu se fait
sentir : après quelques lattes sa main peine à se porter jusqu’à ses lèvres, alors Gabrielle
éteint la cigarette et ferme les yeux. Déjà son paysage intérieur s’est éclairé, en arrivant elle
y décèle une présence amicale, quelqu’un près d’elle qui attend. Pour ne pas gêner
l’inconnu elle fait d’abord semblant de regarder ailleurs, ainsi elle adopte une vision
particulière et décalée, la même qui nous permet de voir certaines étoiles en ne les fixant
pas mais en regardant à côté, juste à côté.
Elle sourit de constater que ce point de vue fonctionne aussi dans le monde du rêve
car peu à peu sur sa gauche Gabrielle découvre un homme assis dans un fauteuil, un
homme torse nu, aux cheveux longs et lissés, au teint métis et aux traits tirés ; le chauffeur
du bus fantôme est posé là, impassible, regardant au loin. Il semble ne pas être sensible à
la présence de Gabrielle qui ne peut s’empêcher de le fixer. Aussitôt il disparaît et juste
avant sa dissolution complète il lui sourit comme une moquerie, l’enveloppe de son regard
bleu. Cette rencontre fugace avec l’indien trouble encore son assoupissement. Gabrielle se
demande qui peut bien se cacher derrière l’image qui vient la visiter ; un homme détourne
un bus pour l’enlever, il se moque d’elle mais n’est pas une menace. Comme s’il l’invitait …
enfin ses forces faiblissent, la tension cède et fond dans le sommeil qu’elle atteindrait
maintenant si un bruit strident ne venait pas grincer jusque dans ses oreilles, un bruit de
sonnerie qu’elle croit téléphonique avant de comprendre qu’il s’agit de l’inter qui vibre au-
dessus de la porte.
Gabrielle ne réagit pas. Son esprit tente d’intégrer le bruit parasite à son rêve mais
elle finit pas s’arracher du sommeil puis de son lit pour aller à tâtons jusqu’à l’entrée. Toute
ébouriffée elle répond dans le lointain à une voix désormais familière qui se fait entendre
quoique chuchotée dans le combiné.
« Gabrielle, c’est moi. Antoine.
![]() Antoine ?!
Antoine ?!
![]() Ouvrez moi s’il vous plaît je dois vous parler.
Ouvrez moi s’il vous plaît je dois vous parler.
![]() Mais enfin ? Qu’elle heure est-il ? Murmure-t-elle.
Mais enfin ? Qu’elle heure est-il ? Murmure-t-elle.
Antoine monte par l’ascenseur. Sur le palier il trouve une porte entre-baillée qu’il
referme derrière lui. L’appartement est plongé dans le noir.
« Gabrielle ? … Où êtes vous … ? »
N’obtenant pas de réponse Antoine jette un coup d’œil à la cuisine, dans le salon,
avant de marcher à pas de loup vers la chambre dans laquelle il trouve enfin Gabrielle
allongée, toute étourdie, emmêlée dans les draps verts. Il approche doucement,
s’agenouille près du lit et murmure à nouveau.
« Gabrielle … douce et belle Gabrielle … je dois vous parler. Il faudrait je sois sûr que vous
ne dormez pas ... m’entendez-vous … Gabrielle … ? »
Sans répondre, celle-ci s’étend de tout son long ce qui froisse la couette et révèle son
ventre ; elle lève un bras mal assuré et d’une main passée sur le visage d’Antoine, si proche,
elle l’invite jusqu’à ses lèvres.
Entrepris dans l’excitation maladroite de deux corps qui se découvrent et se
cherchent, leurs ébats s’achèvent dans l’apaisement du désir assouvi. Les deux amants se
trouvent à la fin épuisés et muets, Antoine somnole alors que Gabrielle demeure ainsi, sans
oser bouger pour ne pas rompre ce charme qui lui laisse aux lèvres un vague sourire. A sept
heure trente le réveil sonne et Gabrielle se lève ; comme d’habitude elle file prendre une
douche écossaise dont la tiédeur du début assure une transition entre le lit et le monde
avant que l’eau ne devienne si froide au rinçage qu’elle la propulse dans le quotidien.
Sortant de la douche elle passe une tunique pour couvrir ses formes puis prépare du thé.
Pendant que l’eau bout elle sort un plateau, deux tasses et deux cuillères, découpe le reste
du gâteau et presse quatre hybrides orange-pamplemousse qu’elle verse dans deux verres ;
en amenant le tout elle tombe sur Antoine qui disparaît sans un mot dans la salle de bain,
Gabrielle continue jusqu’au lit où elle finit de s’installer pour déjeuner lorsqu’Antoine
revient nu, le sexe pendant, sans complexe devant la femme fière qu’il vient de prendre.
« Qu’elle heure il est ? demande-t-il. Presque huit heures. Tu vas au bureau ? Non,
mais je dois passer voir ma grand-mère. Ah … Ecoute Gabrielle, si je suis venu c’est parce
que j’ai quelque chose d’important à te dire. » Antoine est toujours à poil, au milieu de la
pièce.
« Oui ? demande-t-elle avec malice. Je quitte la ville. Prépare un sac et viens avec moi. On
se casse d’ici c’est trop triste. »
Elle rit et lorsqu’Antoine s’approche pour s’expliquer elle ne peut s’empêcher de le
flatter d’un air goguenard :
« Vous êtes mon prince charmant Antoine. Vous m’avez révélée et je suis votre épouse …
emmenez moi, enlevez moi et …
![]() Gabrielle ! l’interrompt-il. Je suis sérieux. J’ai rencard tout à l’heure : à seize heures.
Gabrielle ! l’interrompt-il. Je suis sérieux. J’ai rencard tout à l’heure : à seize heures.
![]() Et alors ?
Et alors ?
![]() Je prends le maquis.
Je prends le maquis.
![]() Pour aller où ?
Pour aller où ?
![]() J’en sais rien, je quitte ce monde de ouf, je suis une filière qui me conduira deho …
J’en sais rien, je quitte ce monde de ouf, je suis une filière qui me conduira deho …
![]() Et tu étais venu .. me dire au revoir ?
Et tu étais venu .. me dire au revoir ?
![]() Oui … enfin non, je … Viens avec moi Gabrielle !
Oui … enfin non, je … Viens avec moi Gabrielle !
![]() Mais tu délires ! Antoine, ce n’est pas sérieux. Tu as du charme et de l’audace … mais
Mais tu délires ! Antoine, ce n’est pas sérieux. Tu as du charme et de l’audace … mais
partir pour aller où, à part au devant de graves ennuis ?
![]() Ou au contraire de graves révélations, de dramatiques découvertes qui risqueraient sans
Ou au contraire de graves révélations, de dramatiques découvertes qui risqueraient sans
doute de troubler la si stable réalité que tu subis jour après jour, entretenue par cette
passivité assumée par tout le monde pourvu que tout aille bien, pourvu que chacun reste
bien superficiel de peur de faire craquer le vernis.
![]() Bon écoute, tes jugements à deux balles tu te les gardes !
Bon écoute, tes jugements à deux balles tu te les gardes !
![]() Je devrais peut-être t’enlever en effet, pour te prouver que j’ai raison. »
Je devrais peut-être t’enlever en effet, pour te prouver que j’ai raison. »
Antoine s’est habillé. Ces yeux sont cernés et brûlants de fièvre. Il se penche vers
elle, toujours assise dans son lit, ils se respirent, s’enlacent et s’embrassent Antoine à
nouveau s’attache et repart en exploration sous la tunique de Gabrielle qui se relève d’un
bond.
« Suffit Antoine ! Tu viens là et tu crois quoi ? C’est quoi ce plan ? On ne se connaît pas, tu
débarques en pleine nuit . ça rime à quoi … ?
![]() Ecoute. Si je suis en service minimum c’est parce que je ne supporte pas de bosser pour ce
Ecoute. Si je suis en service minimum c’est parce que je ne supporte pas de bosser pour ce
système qui asservit humain et la nature au nom d’un progrès mégalo. Mon temps, je le
passe aux Tiers’At et ce boulot de documentaliste est plus une couverture, une couverture
de survie, une concession minimale qui me permet de vivre décemment. Qui me
permettait. C’est clair qu’au taf je suis grillé après le savon que j’ai passé à notre chef de
sévices... Et hier, Jai en plus commis une maladresse, une erreur, une gaffe, qui va me
valoir une convocation chez les flics, c’est presque sûr. Or par l’intermédiaire d’un réseau
ami, une sorte d’entre-aide réciproque entre minima et non-intégrés, je peux partir, quitter
la ville avant que les embrouilles ne me piègent ici. C’est pour ça que j’ai rendez-vous tout à
l’heure. J’avoue ne pas connaître la destination : à la campagne dans une PAZ* ou à l’autre
bout du globe, et pour tout te dire je m’en tamponne le coquillard. Je fais confiance à
Johanne pour passer les contrôles et basta ! Si je suis là, c’est pour te proposer de me
suivre. Une sorte de cadeau, de libération, non ?
![]() Pourquoi moi ? Pourquoi si …
Pourquoi moi ? Pourquoi si …
![]() Chut ! Je vois bien que tu n’es pas plus heureuse que la plupart des intégrés. Tu es là,
Chut ! Je vois bien que tu n’es pas plus heureuse que la plupart des intégrés. Tu es là,
solitaire, repliée sur tes rêves et les histoires que tu te racontes pour tenir le coup … je me
trompe ?
![]() Et bien …
Et bien …
![]() Alors ? Pourquoi ne pas tout lâcher pour tenter l’aventure ? Qwest ce que tu risques ?
Alors ? Pourquoi ne pas tout lâcher pour tenter l’aventure ? Qwest ce que tu risques ?
![]() Antoine, je ne suis pas faites pour l’aventure ; pour moi les dés sont jetés. Je suis née là et
Antoine, je ne suis pas faites pour l’aventure ; pour moi les dés sont jetés. Je suis née là et
je suis bien loin de cette nature fière et sauvage qui te fascine.
![]() Pourtant …
Pourtant …
![]() Je ne suis qu’un rouage de cette mécanique que je déteste, c’est vrai. Jen suis consciente
Je ne suis qu’un rouage de cette mécanique que je déteste, c’est vrai. Jen suis consciente
mais je n’ai sûrement pas la force nécessaire pour m’en libérer.
![]() C’est faux. Tout le monde est fait pour vivre libre. Le blème c’est qu’à force de
C’est faux. Tout le monde est fait pour vivre libre. Le blème c’est qu’à force de
sophistication, de domestication, les gestes simples et les attitudes vraies ont finies par
s’estomper, vivre au naturel nous fait peur tant nous sommes habitués à la liqueur
douceureuse du confort matériel et des mono-discours de surface …
![]() Ça suffit Antoine. Je sais déjà tout ça. Moi aussi je cherche et c’est peut-être ce qui nous
Ça suffit Antoine. Je sais déjà tout ça. Moi aussi je cherche et c’est peut-être ce qui nous
rapproche, nous rend complices et pourrait, pourquoi pas, faire de nous deux
compagnons ; deux amis-amants qui avancent dans la vie, main dans la main sans
mennottes.
![]() Mais oui ! Voilà ! s’exclame Antoine.
Mais oui ! Voilà ! s’exclame Antoine.
![]() Pourtant je ne pourrai plus retrouver cette nature. Mes attitudes et mes pensées sont
Pourtant je ne pourrai plus retrouver cette nature. Mes attitudes et mes pensées sont
conditionnées, mes mots ne sortent plus d’eux-mêmes. Ce naturel qui te va si bien et que
tu as su préserver … n’est pour moi qu’un vague souvenir d’enfance. Ma façon d’être, mes
attitudes, mes regards : tout est le fruit de cette culture et de cette éducation forcées qui
font de nous tous des clones mimétiques. La pression qui s’exerce sur nos corps et nos
esprits est telle qu’elle a finit par nous dénaturer. La spontanéité, le naturel sont
aujourd’hui des qualités suspectes. La simplicité, la gentillesse sont considérées comme
des faiblesses, regarde : celle qui reste elle-même, sans fard ni cosmétiques ajoutés est
jugée négligée et cet enfant, qui chante ou pleure dans le tram est grondé car cela agace,
cela choque de voir la nature s’exprimer chez l’humain, cet humain qui n’a de cesse de la
masquer, la refouler, la réduire cette nature au prétexte qu’elle est un résidu de cet animal
que nous restons pourtant.
En croyant changer la barbarie en culture, l’occident détruit la nature des êtres et
leur fait prendre des poses. Sous prétexte d’évolution, ce même occident rationnel
dénature et aliène l’espèce humaine pour en faire une cohorte domestique sans conscience,
un troupeau, un cheptel et moi-même je n’échappe pas à la règle. Jen souffre sans très
bien savoir d’où viens cette souffrance car comme tous les autres, du fond de mon âme non
encore tout à fait éteinte, monte et pousse ce souvenir commun, cette réminiscence ténue
qui me rappelle que je viens de l’amibe ; qu’en moi se conserve inconsciente l’évolution de
notre espèce : la vie préhistorique, le cousin pythécantrope et bien avant lui les premiers
mammifères ovipares du Trias, les amphibiens et puis encore bien avant … quand
n’existaient que les algues et les bactéries qui émergèrent d’une soupe de protéines.
En nous résonne cette vie qui se déploie depuis lors. Et si notre société renie tous
ces ancêtres, sans doute est-ce car ces cycles lointaines et successifs impliquent une chose
évidente mais difficile à admettre pour un humain trop orgueilleux : nous ne sommes
qu’une étape d’un processus appelé Vie, un processus qui semble transformer l’énergie en
matière puis la matière en conscience et nous n’avons pas été créés par un dieu pour
profiter de cette planète Terre qui vit elle aussi, nous ne sommes au sommet d’aucune
pyramide car la vie est un ensemble interdépendant, nous ne sommes ni supérieurs aux
règnes végétal et animal, ni autorisés à les placer sous tutelle, notre particularité d’êtres
vivants conscients nous donne des responsabilités plutôt que des privilèges, nous sommes
responsables de la Terre et de la vie qu’elle porte, notre rôle est d’aider à faire émerger en
chacun de nous la conscience et non de jouir sans retenue pour satisfaire nos égos.
Comme tu vois Antoine, je ne suis pas dupe. Mais si je parviens à expliquer par des
mots ce qui fait notre humanité, la pratique de cette humanité en toute simplicité est autre
chose. Je suis trop conditionnée pour vivre dehors. Mon corps ne supporterait plus l’eau de
source jaillie des montagnes, il ne pourrait plus digérer les légumes sains, mes poumons
eux-mêmes ont dû s’adapter aux toxiques et c’est maintenant l’air pur qui risquerait de les
brûler. Je suis née dans ce monde reconstruit de toute pièce, je baigne depuis toujours
dans le bain amniotique de cette société visqueuse de faux-semblants. Jamais je ne pourrai
m’en défaire.
![]() Une fois de plus, Gabrielle tu te trompes, tu restes bien trop prudente et manichéenne. La
Une fois de plus, Gabrielle tu te trompes, tu restes bien trop prudente et manichéenne. La
pensée occidentale rationnelle s’appuie sur une siscion en couples opposés : le bien / le
mal, le blanc / le noir, l’homme / la femme, l’utile / l’inutile, mais à y regarder de plus près,
on constate vite que ce n’est pas si simple : l’homme n’est pas un bloc de masculinité, en lui
réside une part de féminité et en chaque femme existe des caractères masculins plus ou
moins prononcés. De même, lorsque tout va mal : lorsque nous sommes dans les ténèbres,
au plus mal, dans le cirage le plus complet, nous laissons quand même une place, même
petite, à une lueur d’espoir.
Si dans le noir complet nous acceptons qu’il reste un brin de lumière, il faut aussi
bien admettre en symétrique que dans la clarté absolue : le bonheur, la perfection, doit
subsister une part d’ombre, une tâche, un nuage. Si nous admettons l’un sans admettre
l’autre nous tordons la logique, nous nions une part du monde, de la réalité. Et si nous
parvenons à admettre l’un et l’autre alors il apparaît que le monde et ses phénomènes ne se
présentent plus à nous sous deux formes contraires et opposées mais bien sous quatre
formes combinées : du noir et du blanc certes, et aussi cette part de blanc au sein du noir et
cette part de noir au sein du blanc. Cette idée simple est figurée par l’enlacement du yin et
du yang de la pensée orientale ... et sa compréhension ouvre des perspectives car ces
quatre combinaisons logiques permettent de relativiser bien des situations. En ce qui
concerne tes craintes de ne pas être capable une fois sortie du système, de renouer avec ta
nature, on peut considérer que si aujourd’hui tu es artificielle avec une part de naturel qui
demeure, demain dehors tu pourras être naturelle avec une part d’artificielle qui demeure
… qu’en dis tu ?
![]() Antoine tu m’étourdis. Tu as « l’art de manier l’abstrait à propos du concret » comme
Antoine tu m’étourdis. Tu as « l’art de manier l’abstrait à propos du concret » comme
disait Claparède. Sans doute as-tu raison. Mais je ne te suivrai pas. Disons que je ne suis
pas prête. Je mai jamais songé à m’évader, à fuir. Au milieu de ce monde si critiquable il est
vrai, il reste tout de même une place pour l’humanité et si tout ceux qui en sont porteurs le
quitte, rien ne changera jamais. Tu dois partir, c’est très bien. Si tu es en danger je préfère
te savoir loin d’ici. Mais ne pense pas que je puisse quitter mes repères si vite, pour un
ailleurs bien incertain avec un homme éveillé peut-être, mais que je connais moins bien
que les travers de cette vie là que je vis depuis toujours et qui te semble médiocre ou
absurde.
![]() Gabrielle, ce n’est pas après toi que j’en ai …
Gabrielle, ce n’est pas après toi que j’en ai …
![]() Je ne ten veux, moi non plus, pour rien au monde. Mais je ne peux pas tout plaquer sur
Je ne ten veux, moi non plus, pour rien au monde. Mais je ne peux pas tout plaquer sur
un coup de tête, c’est une folie dont je suis bien incapable. Si par hasard tu reviens, si tu
peux m’écrire ou me contacter, je te recevrai avec joie. Et il n’est pas impossible qu’un jour
ou l’autre je décide de partir moi aussi. Alors nous nous reverrons peut-être … mektoub …
![]() D’accord, je n’insiste pas. En venant je pensais ouvrir cette fenêtre par laquelle tu rêves
D’accord, je n’insiste pas. En venant je pensais ouvrir cette fenêtre par laquelle tu rêves
de t’’envoler. Je me suis trompé. Je m’arrangerai pour te dire où je suis dès que possible.
Sache que je …
![]() Ne dis rien Antoine, ne dis rien qui te lierait à moi. Même si notre histoire s’arrête là il n’y
Ne dis rien Antoine, ne dis rien qui te lierait à moi. Même si notre histoire s’arrête là il n’y
aura aucun regret, aucune amertume. »
la révolution
Dans la soirée, Gabrielle reçoit un message : c’est madame..., sa chef de service qui
veut connaître la raison de son absence aujourd’hui. Pour une fois, tout l’immeuble semble
retenir son souffle. Aucun cri intempestif, aucune télé assourdissante. Qu’a-t-elle fait ? Elle
est restée là : chez elle, paisible. D’abord allongée sur le lit puis assise dans un fauteuil elle
n’a cessé de penser. A l’indien. A Antoine bien sûr. Gabrielle est heureuse d’être elle-même,
même si les paradoxes soulevés par la nuit lont un peu secouée. Ce dont elle a besoin
maintenant c’est de temps pour éclaircir sa situation avant d’envisager une suite. Elle a
besoin de réfléchir, de faire le tour d’elle même : sa propre révolution.
Cela prend du temps, du moins cela prendra le temps qu’il faudra, alors en guise de
réponse à cet ultime contrôle hiérarchique, Gabrielle se connecte au réseau, après quelques
clics elle obtient un formulaire en douze feuillets qu’elle remplit avec application. Puis elle
fait enregistrer toutes ces modifications, relatives à son statut temporel : dès ce soir à
minuit elle basculera, pour passer de quinze à neuf heures de travail par semaine. En
rejoignant ainsi la troupe des minima, Gabrielle fait un pas vers la liberté, en décidant de
ne plus participer au système qu’en service minimum elle s’engage sur le chemin de la
révolte, sans heurt ni violence, pour accomplir son propre destin, s’éveiller à la vie : cette
vie qu’elle cherche sous les masques, sans contrainte ni hiérarchie, elle trouvera des
compagnons et agira à présent consciente, libre et responsable pour retrouver en elle et
autour d’elle ce rythme enfoui, lent et progressif qui nous accorde avec le monde.
Fin
STOP CONSOMMATION
récit de David Vial
écrit en 2000 paru une première fois en 2001 aux éd. Key Largo
isbn 2-9517237-5-X
chapitre 1
Le type a l’air jeune, la trentaine, grand, les cheveux châtains presque roux, en bataille sur
le crâne. Il descend d’une voiture du passé, prend l’angle de la rue et remonte vers l’est. La
patrouille continue sa route, laissant à une autre le soin de poursuivre la filature. Alex, le
type, pousse la porte d’un drugstore. Il demande si son tampon est prêt. Commandé la
veille par téléphone, l’objet a bien été livré, avec un box d’encre offert. Pour vérifier le
motif, il réclame une feuille au commerçant, qui lui en sert une à l’effigie de coca. Alex
presse le caoutchouc contre le box et vise le logo rouge. STOP apparaît en majuscules,
police : charter one. Content du résultat, il froisse la feuille et la balance dans le poêle, qui
brûle au milieu de la boutique. « Pas chaud hein !? » lâche-t-il en sortant.
Direction nord-est — secteur fluvial.
Se laissant porter par le trafic, Alex se roule une cigarette. Il sourit mais son visage est
quand même grave, décidé. Quelques instants plus tard, il se gare devant un nouveau
drugstore.
47 ème rue droite — n° 356
Alors qu’il entre là, un flic en civil entre dans le précédent. S’approchant du comptoir, il
montre sa carte et pose des questions sur le type, qui vient de sortir. Le commerçant livre
aussitôt le bon de commande, et révèle empreinte demandée par le client : STOP en
majuscules, police : charter one. De son côté, Alex fait quelques pas vers un présentoir
rouillé. Il interrompt un employé occupé à le garnir de chargeurs de tous modèles, qui finit
par poser son portable, pour consulter l’écran tactile. « Oui, c’est fait. » Il fouille alors, et
sort une caisse en bois de sous le comptoir. Dedans, il trouve le paquet. Là, Alex se sert : il
prend un prospectus sur une pile et essaye le tampon. S’inscrit en majuscules :
CONSOMMATION. Satisfait, il laisse le prospectus. En ressortant il inspire à fond avant de
s’engouffrer dans une voiture. Puis il repart tranquille, se fondant dans le flot, respectant
les limites. Toutes les voitures du passé, comme celle que conduit Alex, sont tenues de
circuler sur un axe parallèle, non équipé de rails électros. Les routes d’asphalte ne sont
d’ailleurs plus entretenues depuis plusieurs années. Il arrive qu’un véhicule abandonné
reste là des mois avant d’être enlevé par les services de voirie, mais cela ne gêne que les
utilisateurs de ces routes, ceux qui vivent encore dans le passé, ceux qui conduisent des
vieilles bagnoles. Sur le périphérique, Alex songe à semer la patrouille. Il sait qu’il est filé
chaque fois qu’il vient en ville, et il s’en fout. Les flics se contentent de le suivre, après
l’avoir repéré sur un écran. C’est une sorte de contrat tacite entre ceux du dehors et les
Brigades Municipales : si tu te tiens à carreaux, ils ferment les yeux. Ce qu’ils détestent,
c’est la nouveauté, l’inconnu. Il vaut donc mieux utiliser le même véhicule auquel ils
s’habituent, et qu’ils surveillent de loin, pour s’occuper. Alex file vers le sud. Il lui reste une
dizaine de bornes à parcourir, avant de franchir la porte de la ville. Sur sa droite, les
vaisseaux électriques glissent à vive allure, sans bruit, sans heurt, car le flux automobile est
dense mais cependant régulé. Chaque véhicule, privé ou public, est en effet équipé d’une
borne, le reliant au réseau. Cette borne multifonctions donne la position géographique, et
reçoit des instructions qui font varier la vitesse, en fonction du trafic. Le conducteur ne
s’occupe plus que du guidage. C’est un fameux progrès ! Une avancée technologique qui
conduirait à grands pas les intégrés vers un futur toujours plus pratique, toujours plus
efficace. Toutefois, l’attribution des bornes reste à ce jour soumise à certaines conditions :
toute demande doit s’accompagner d’un justificatif de domicile en ville, la voiture à équiper
doit avoir moins de cinq ans et surtout, il faut une carte créditée. Or Alex n’a pas de carte.
Pour l’adresse en ville, il pourrait s’arranger. Mais pour la voiture, une carte est nécessaire.
Pas de carte, pas de crédit ; pas de crédit, pas de voiture. Et pour avoir une carte, il faut
d’abord vendre son temps. C’est cela qu’ils appellent être intégré : disposé à vendre son
temps en échange d’une carte, qui permet d’accéder à tout ce que le progrès produit
comme confort, comme distractions. Cela fait maintenant sept ou huit ans qu’on est passé
à cette carte unique. L’objet devait être le nouveau symbole de la liberté individuelle.
Personnelle, elle contient les renseignements suivants, saisis sur le plastique :
[L’état civil — nom — prénom — date et lieu de naissance
[| adresse — téléphone — e-mail
|| formations — compétences — savoir-faire — emplois exercés
[| permis de conduire — laisser-passer
| données bancaires — judiciaires — notariales
(| bilan de santé — groupe sanguin — compatibilités tissulaires
Viennent s’y ajouter les contrats ď’assurances et de location, les crédits en cours, la
fonction de clef universelle et bien sûr de carte de paiement. Toute la lourdeur
administrative levée d’un coup, par la mise en cohérence de données fragmentées ; la
liberté retrouvée pour des millions de citoyens perdus dans cette société libérale post-
Kafkaïenne du début du siècle ; une révolution, censée reconstituer le tissu social en
gommant les apparences de l’inégalité. On avait voté le passage à la carte par référendum.
L’état devait ensuite les fabriquer : une par individu, une par citoyen légal du pays. Mais
les banques bloquèrent le processus. Elles refusèrent de cautionner les endettés et ceux qui
avaient eu un accident bancaire récent. Selon elles, ces personnes n’ont pas conscience de
la valeur de l’argent et cette forme de déficience met en danger la société. On ne peut faire
confiance à ceux qui prennent à la légère les fluctuations de leur compte, et même, dans la
mesure où lon mettait en commun l’ensemble des réserves ď’argent, il leur paraissait
acquis qu’un seul faux mouvement pourrait mettre en péril tout l’édifice. Les banquiers
étaient tombés d’accord pour gérer les comptes de tous les habitants du pays, mais il fallait
auparavant exclure ceux qui risquaient de déclencher une catastrophe, en déséquilibrant
les flux par leurs frasques. L’état avait cédé, malgré les soulèvements populaires. C’est
comme ça que les interdits bancaires, les faillitaires, les sur-endettés furent sacrifiés sur
l’autel de réformes fatales, menant à une mondialisation globale pilotée par les tenants des
bons modèles économiques. Ils furent de facto exclus des villes et vinrent grossir les rangs
de ceux qui n’avaient plus ni carte ni chéquier, depuis déjà longtemps ; Alex avait fait
partie de la charrette. Environ deux kilomètres avant le check-point se trouve une aire de
repos accessible uniquement par la vieille route. La station a brûlé lors des événements et
la végétation reprend le dessus, soulevant le bitume et brisant le béton. L’endroit est
désert. Alex ralentit un peu et laisse passer la patrouille, sur l’autre axe. Elle l’attendrait
plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence mais il ne réapparaîtrait pas, et finalement, ils
n’auraient qu’à mettre dans leur rapport : trace perdue à hauteur de l’aire du Volvestre à
dix-sept heures vingt-quatre. Cela justifierait leur incompétence. Cette aire était vite
devenue un passage privilégié, pour entrer en ville ou en sortir discrètement. Derrière le
rideau de végétation part une route secondaire, un ancien accès de service qui permet de
rejoindre les routes départementales. Cela mène bien loin du périmètre d’intervention des
Brigades Municipales qui doivent, pour continuer à suivre une voiture sans borne, utiliser
un hélico ou une visée satellite : très coûteux, très peu utilisé. De toute façon, les flics se
fichent pas mal de savoir où il va. Il peut bien aller au diable pourvu qu’il dégage le secteur
sans faire de vague. Leur seule préoccupation est que les non-intégrés ne fassent pas
d’histoire le temps de leur présence en ville, et qu’ils y restent le moins longtemps possible.
Ils ont comme consigne de signaler les déplacements et les endroits fréquentés par tout
individu venu de l’extérieur, ensuite d’autres se chargent d’analyser et de recouper ces
informations. Jugeant s’être assez éloigné du fracas de la ville, Alex se gare le long de la
route déserte. Il s’étire, fait quelques pas sur la chaussée et remarque en contrebas, un
verger. Dun bond il saute le fossé et se retrouve alors dans une allée de pommiers.
Redevenus eux-mêmes, les arbres avaient donné des fruits bosselés et rabougris, des
pommes petites comme des poings de bébé, à la peau rouge et fripée. Alex en cueille une et
la croque, curieux. La saveur acidulée lui laisse un arrière goût sucré et délicat, un goût du
passé, inconnu des jeunes intégrés. Tout en mangeant, il continue de marcher dans l’herbe
haute, en exploration. L’allée d’arbres s’enfonce loin devant lui vers une rivière, et de
chaque côté se trouvent d’autres allées parallèles, séparées par des peupliers. Sans doute
devait-on jadis cultiver là toutes sortes de fruits. Etonnant que personne n’ait encore pillé
l’endroit, déserté et abandonné depuis les événements. En retournant vers la route Alex se
charge d’une petite provision de pommes rouges, puis il note avec précision sur une carte
routière la position du verger. Car ce genre de renseignement est rare, pour lui et les siens
cela peut être quelque chose de très précieux.
Chapitre 2
A hauteur de Sainte-Croix, Alex allume une radio de campagne, un ancien modèle de
l’armée espagnole. Elle crache un son tordu, rapide, électronique. Il reconnaît le style de
Pierre et sourit. Il l’imagine, perché sur ses machines, le corps battant le rythme, les mains
mêlant les sons, malmenant les boutons. Dans une heure environ, il l’aura rejoint, lui et les
autres membres de la tribu qu’ils forment tous non-intégrés associés pour occuper une
baraque isolée juchée sur un sommet. Ils avaient tout de suite installé une radio pirate
dont le rayon démission délimitait leur champ d’influence. Alex savait donc en entendant
ce son qu’il arrivait, qu’il était en territoire ami.
« Alors, comment ça c’est passé ?
L] Bien, j’ai les tampons. En rentrant, j’ai découvert des fruitiers. ça vaudrait le coup de faire
un stock de pommes ou de poires, à mettre en compote. » Valérie éclate de rire. « Méfie-
toi, on risque de te prendre au mot. »
Ils sont assis à table, dans une cuisine ouverte sur l’extérieur. Au sol, des carreaux
multicolores composent des motifs réguliers, hypnotiques. Jean entre, au moment où Alex
déballe son butin de pommes. Il s’exclame ravi, et d’une bouchée en avale une entière, tout
heureux de la surprise. En mâchant il farfouille dans les boîtes pour sortir et essayer les
tampons. STOP CONSOMMATION.
« — Parfait, dit-il, ça va faire un malheur ! On s’y met ? »
L’idée d’Alex est simple : il s’agit de découper des milliers de rectangles de papier, d’y
apposer le slogan puis, quand il y en a assez, d’aller les tracter en ville. Pour cela, ils avaient
mis au point un ingénieux système d’aile volante, qui permettait de hisser les tracts au
dessus de la ville. Il suffisait de tirer un loquet pour qu’ils s’échappent, et tombent en pluie
à des dizaines de mètres à la ronde. C’est comme ça qu’ils faisaient leur propagande
révolutionnaire. L’astuce est d’ailleurs très efficace et peu dangereuse, car quand une
patrouille repère un cerf-volant en l’air, c’est trop tard : déjà les tracts dégringolent et les
types ont disparu, abandonnant l’engin au vent. Jean et Alex s’installent dans l’atelier,
pour massicoter des bandes de papier.
« Comment c’était en ville ?
:| Comme d’hab, les intégrés ont toujours le regard aussi vide, ils ne voient rien ni
personne ; ça me fout le cafard. Je me demande si ce que nous faisons en touche un sur
mille, en tout cas, ceux qui nous soutiennent ne se montrent pas trop.
[Ils aimeraient être à notre place. Loin de tout, tranquilles et autonomes...
[| Ouais
C Ils n’ont qu’à se bouger le cul. »
Après quelques minutes, Alex reprend.
« Et ici, quoi de neuf ?
[lUn convoi est passée, ils viennent de Prague et descendent au Portugal.
C Ils voulaient se poser là ?
(| Oui, c’est Valérie qui les a eus. Elle les a guidés par radio jusqu’au plateau du Plantaurel.
Pour quelques jours, ça ira.
(Tu sais ce qu’ils ont ?
: Ils ont des champis et les troquent contre de la viande ou des épices. Mais je crois qu’on
est à sec — ou limite.
(Et contre des fruits ? Des pommes ?
CA voir, j’en sais rien. »
Ils mettent trois bonnes heures à découper méticuleusement des carrés de dix sur dix puis
quand c’est fait, ils retournent dans la maison où Pierre et Valérie cuisinent en chantant
Boris Vian. A leur arrivée, dans la cuisinière de fonte, le feu soudain siffle si fort qu’il finit
par l’emporter. Tous les quatre éclatent de rire et le bois crépite, pour conclure.
« Vous en êtes où, demande Pierre ?
|| On a le papier, on a les tampons. On mange et on s’y remet. C’est quoi ? réclame Jean en
soulevant un couvercle.
(| Pas touche ! dit Valérie. Mettez donc la table, je vous sers. C’est du sanglier aux cèpes,
une recette de sa grand-mère.
[De ma grand-tante, rectifie Pierre. Elle s’appelait Nina, une vraie sorcière dans l’âme.
CO Une sorcière ?
‘Oui. En fait, on la surnommait ainsi car c’était la seule à la ronde qui savait encore
utiliser les plantes, les champignons. Quand elle mangeait des truffes ou qu’elle dépeçait
un de ses lapins, on la traitait de sauvage, de barbare. N’empêche, le jour où c’est parti en
live, ils étaient tous comme des gamins perdus. Plus d’électricité, plus de plats surgelés,
plus de coupe-faim ni de quick-eat. Fallait les voir se lamenter ! Y en a pas mal dans le
village qui sont morts de faim : trop fiers pour venir voir Nina. Les autres lui valent une
fière chandelle, remarque. C’est elle qui ma transmis tous ces petits secrets qui font de moi
un être si exceptionnel !
[Tu parles ! T’as surtout eu du bol de connaître des paysans. Bon, on mange, propose
Valérie. »
Chacun avait loué Nina et ses formules magiques, puis ils avaient mangé avec plaisir, dans
la bonne humeur et l’odeur de festin. Cela ressemblait à une vieille carte ou une photo, sur
laquelle on voit encore des gens assis ensemble à une table, pour partager un repas. Ici, les
convives sont jeunes, débraillés et tatoués mais comme sur les images d’antan, on sait à
leurs yeux qu’ils sont vivants et heureux de vivre. Une joie non feinte, sans sourire de
convenance ni rire forcé. Seul Alex semble plus taciturne, moins enclin à s’amuser. C’est
parce qu’il ne peut s’empêcher de penser à ce que vivent les intégrés. Au moment des
événements, il avait un peu plus de vingt ans, comme Valérie et Pierre, mais lui habitait en
ville. Et il y retourne trop souvent pour oublier la vie qu’ils mènent là-bas. Cela le rend
triste de savoir. Pierre et Valérie ont été élevés ensemble par toute une troupe de théâtre de
rue. Leurs parents sentirent le battement d’aile du papillon, et en prévision de la tempête à
venir ils avaient opté pour une occupation sensée de leur temps : ils crachaïent du feu,
jonglaient et déambulaient à dix mètres du sol, au lieu de fabriquer des conneries. A
l’époque les autres, ceux qui croyaient dur comme fer à la réalité des marchés et de la télé
se foutaient de leur gueule. C’étaient des saltimbanques modernes, les amuseurs d’un
public exigeant et souvent ignorant. Mais ce choix de vivre délibérément en marge s’avéra
salvateur, car quand ça a commencé à déconner, les liens solides qu’ils avaient tissés dans
toute l’Europe servirent de base au premier réseau d’organisation parallèle. Valérie et
Pierre ont toujours connu la liberté. Ils sont conscients de ce que cela signifie et savent
d’ailleurs à merveille disperser alentour la force et l’amour qui les animent. Alex les
admire. Près d’eux, il sait que l’humanité persiste, et résiste à l’assaut des ego. Mais il peut
aussi estimer la marge qui les isole des intégrés, et cette marge est telle que cela provoque
en lui une tension parfois insoutenable. Il a du mal à croire que son action, que leurs
actions, aient quelques chances d’amener une intégrée à être, après tant d’années passées à
paraître. Il désespérait devant la lutte à mener, il savait qu’il n’en récolterait pas les fruits,
et cela le minaït. Pour Jean, c’était encore différent. Plus âgé qu’eux, il vivait son sort
comme la grande aventure de sa vie. Lui, se foutait des intégrés et de leur vie merdique. Un
beau jour, il avait tout balancé d’un coup pour repartir à zéro, et après huit ans de galères,
il était enfin tombé sur les bonnes personnes. C’est pour ça que lorsqu’Alex se morfond sur
le devenir de ses contemporains, ça l’agace. C’est ce qu’il appelle le syndrome de
l’intégration, comme un mal du pays. Selon lui, si Alex refuse de vivre sa liberté, c’est parce
qu’il n’a pas bien tranché ses anciens liens. Il considère, pour l’avoir fait lui-même, que si
réellement les intégrés le veulent, ils peuvent tout changer. Mais il est aussi conscient que
tout le monde n’est pas prêt en même temps, pour vivre libre. Il sait bien que de nombreux
humains ont encore besoin de se référer à une autorité qui les dépasse. Qu’elle soit
religieuse, politique ou économique. Cela les rassure de savoir que quelqu’un sait ce que
eux ne savent pas. Ils délèguent leur responsabilité et se contentent de consommer. Sous
prétexte de payer, ils exigent que l’on s’occupe d’eux, qu’on les conseille, qu’on les soigne,
qu’on les nourrisse, qu’on les distrait, qu’on les flatte, qu’on leur raconte des histoires le
soir, avant d’aller au lit. Pour Jean, Alex est un romantique, un solaire attiré par la Lune
qui souffre de la dualité du monde. Mais au fond il l’aimait bien, et parfois, il racontait au
micro ses souvenirs d’intégré. C’est le moyen qu’Alex avait trouvé pour donner du sens à
leur passé : archiver, fixer leur mémoire, et témoigner devant les générations à venir de ce
qu’ils avaient vu, et vécu.
chapitre 3
La fabrication des cerfs-volants est le domaine réservé de Jean. C’est le plus habile de ses
mains, le plus habitué à manier la scie et la clef de dix. Par souci de légèreté il utilise de fins
roseaux liés ensemble pour former l’armature. Il tend dessus la toile, découpée dans un
parachute ensuite il fixe la boîte à chaussures qui contient les tracts. Une trappe fermée par
du velcro permet l’ouverture à distance grâce à un filin indépendant. Il suffit d’attendre
que le vent porte l’engin à une dizaine de mètres du sol pour déclencher le mécanisme. La
pluie de papier inonde alors la zone, en quelques secondes. Quand tout est prêt, ils
chargent la voiture. Alex s’installe au volant, seuls Pierre et Valérie l’accompagnent. Pour
Jean, il est hors de question de retourner en ville pour le moment, il s’y sent trop mal et de
toute façon a autre chose à faire. Au passage, Alex signale le verger à Valérie et promet de
s’arrêter au retour. Le brouillard qui monte du ruisseau camoufle encore les arbres. Pierre
reste silencieux, se concentrant sur ce qu’il allait faire. Car c’est peut-être leur vingtième
tractage et ils s’en sortent toujours, mais en réalité, tout dépend de lui. Sil estime mal la
vitesse du vent ou sa direction, le cerf-volant peut s’écraser en une seconde sur les
passants, ruinant l’opération et les forçant à un départ précipité. Alors pour se concentrer,
il respire doucement, sentant son diaphragme se soulever, tendant son corps et son esprit
pour préparer l’action tout à l’heure. Ils rejoignent le réseau par l’aire du Volvestre, et
s’engagent sur l’antique autoroute. L’asphalte est déserte. Le soleil réchauffe le sol humide
et l’on entend en dessous les flaques, affolées, effrayées par l’effet des roues. Sous le
premier pont Alex remarque les caméras, braquées sur la circulation. A l’arrière, Pierre
déplie la capote. Dans le ciel soudain dégagé ils voient alors courrir à vive allure de beaux
nuages blancs, signe d’une éclaircie durable. Valérie ne peut s’empêcher de rire à leur
barbe pour les saluer. Contrôle 212 à centrale. Contrôle 212 à centrale. Véhicule non borné
repéré. Type : Peugeot 404. Couleur : beige. Direction nord. Je répète : direction nord.
L’air leur frictionne les oreilles. Pierre vérifie la boîte, sa fixation sur l’armature et enfin
l’attache velcro. Tout est en place. Prêt à l’emploi. Ils approchent. Alex choisit de
contourner le centre ville pour remonter vers le lieu de tractage derrière une zone
pavillonnaire. Il roule lentement, pour éviter les ornières. Des grillages isolent la vieille
route d’un environnement hostile. Vue d’en haut, elle fait comme un trait de verdure,
taillant de travers un puzzle géométrique. Dans ce quartier, toutes les maisons
préfabriquées sont disposées en lignes régulières délimitant pour chacun un carré de
pelouse en rouleau. Certains ont creusé un trou d’eau : signe de prospérité, d’autres ont
construit des garages pour protéger leur véhicule. L’ensemble est desservi par de larges
allées de goudron rouge, sur lequel il est plus aisé de s’exercer à la trottinette. Les arbres
sont absents, remplacés par des réverbères et les enfants jouent sagement, presque sans
bouger, sans crier, sans gesticuler ni rire, ni même pleurer.
Centrale à toutes les voitures. Centrale à toutes les voitures. Véhicule non borné identifié.
Type : Peugeot404. Couleur : beige. Immatriculation : 3486 ATJ 09. Ordre de filature
secteur nord-est. Je répète ordre de filature secteur nord-est.
Ils arrivent en vue du pont. L’ouvrage, long de près d’une centaine de mètres constitue la
meilleure piste d’envol qu’ils aient trouvée pour le moment. De là, le vent pousse toujours
les tracts vers les rues commerçantes des quais, parfois certains glissent même jusqu’à la
gare. Cette fois-ci, le message est clair. Le slogan est destiné à montrer aux spéculateurs
que le marché reste dépendant des consommateurs. C’est aussi une injonction mesurée, un
conseil promulgué, une règle révélée, censée faire cesser les attaques insensées menées par
lego contre une Terre, fatiguée de supporter les caprices d’un genre humain. STOP
CONSOMMATION.
Voiture 62 à centrale. Voiture 62 à centrale. Patrouillons dans le secteur. Ordre bien reçu.
Je répète ordre bien reçu.
Pierre évalue le vent, le hume, le caresse pour s’en faire l’ami. Puis il rabat complètement la
capote et libère le cerf-volant. Valérie l’aide en soulageant lavant de l’appareil pendant
qu’il s’installe assis, le dos calé par la banquette. Ils posent l’engin sur l’air et Pierre
s’habitue à le maintenir, à un ou deux mètres de la voiture. Quand il le sent bien gonflé,
pressé de s’élever, il lâche un peu de mou. L’aile blanche part en flèche. En un instant, elle
est à dix mètres du sol. Des rafales brèves et fortes la poussent alors hors de l’axe de la
route, Pierre tente de l’accompagner en pivotant pour ne pas croiser les commandes, mais
le vent, trop irrégulier malmène l’engin. C’est en accélérant un peu qu’Alex le replace au
dessus d’eux, parallèle au pont. Valérie comprend qu’ils ne pourront l’amener plus haut
sans risquer de le perdre elle tire d’un coup le fil déclencheur. Voiture 62 à centrale.
Voiture 62 à centrale. Repérons cerf-volant, je répète : cerf-volant repéré. Secteur fluvial.
Point d’attache au sol évalué à moins d’un kilomètre. Nous dirigeons sur zone. Je répète :
nous dirigeons sur zone. Au même instant, les tracts inondent le ciel. L’essaim de papier
fond sur les passants à la fois surpris et ébahis que quelque chose vienne du ciel. Eux qui
d’ordinaire marchent en lustrant le sol du regard, les voilà qui présentent soudain au soleil
un visage radieux et enfantin. Cela ne dure pas. Après s’être échangé quelques regards
incrédules, ils baissent à nouveau la tête pour lire :
STOP CONSOMMATION
Peu osent cueillir un bout de papier, mais tous ont l’inconscient impressionné comme un
négatif, par le slogan salvateur. Et dans la journée la plupart se vanteront d’avoir vécu
quelque chose d’extraordinaire. C’est sans doute ainsi que les messages circulent le mieux :
inconsciemment d’esprit à esprit.
« Opération réussie, je répète opération réussie » Pierre avait failli lâcher prise au moment
du largage : moins lourd, le cerf-volant prenait le large ; mais il mettait un point d’honneur
à le maintenir en prise jusqu’à la libération du dernier tract. Alors seulement il pouvait
laisser les commandes et sa joie s’échapper, relâchant enfin la tension accumulée. Arrivés
en bout de pont, ils s’engagent dans une rue fréquentée pour s’éclipser. Le toit est en place,
rien ne les signale, si ce n’est leur mine réjouie. Voiture 62 à centrale. Voiture 62 à
centrale. Véhicule repéré, je répète : véhicule repéré. Trois individus à bord. Rien
d’anormal à signaler, je répète : rien d’anormal à signaler. Demande d’interception ?
Valérie repère la patrouille sur la droite, débouchant à vive allure. Elle se met à leur
hauteur, sur le réseau parallèle. Aucun des trois ne regarde dans sa direction, pour éviter
de croiser l’oeil de la caméra. « Centrale à voiture 62. Centrale à voiture 62. Négatif, je
répète négatif. Ordre de filature. A vous.
L] Voiture 62 à centrale, message bien reçu. Début de filature : treize heures quarante-neuf.
Direction sud-est. »
Sans les lâcher, la patrouille ralentit un peu pour se placer derrière, à quelques dizaines de
mètres. Alex sait qu’ils n’ont plus rien à craindre jusqu’à l’aire de sortie. Il reprend le
périphérique, et roule à vitesse autorisée vers le sud. Valérie passe alors à l’arrière, où
Pierre roule une cigarette en commentant son exploit. Ils se chamaillent pour l’allumer,
gigotant d’un bord à l’autre de la banquette. Cela pourrait passer pour un enfantillage de
plus, mais Alex leur rappelle que la patrouille les filme en permanence. En réaction, ils se
baissent complètement, disparaissant derrière les sièges. Cela ne les empêche pas de rire à
l’étouffée, alternant baisers et longues inspirations. Ils n’acceptent de remonter qu’une fois
sortis de la ville, quand Alex se gare enfin, dans l’herbe.
« Voilà donc ton verger ? Tu sais que je suis venue pour ça. J’espère que les oiseaux n’ont
pas tout bouffé. »
Valérie plonge vers les fruitiers, débarrassés de l’ouate du matin. Elle court dans l’allée par
sauts de biais, comme le font les enfants heureux. Puis elle s’arrête, les laissant la
rejoindre. Elle cueille une pomme jaune. Un instant, elle hésite à rejouer la scène du péché,
puis se ravisant préfère citer Twain avec style, pour les accueillir dans ce nouveau monde,
ce paradis :
« Tout parait mieux que ça ne l’était hier. Dans la précipitation de l’achèvement, on avait
laissé les montagnes déchiquetées et quelques plaines si encombrées d’ordures et de débris
que leur aspect était fort inquiétant. La hâte ne va pas aux belles et nobles oeuvres d’art ; or
ce monde neuf et majestueux est assurément un ouvrage très noble et beau. Et il est
sûrement très proche de le perfection, malgré la rapidité de sa réalisation. On compte trop
d’étoiles à certains endroits et pas assez à d’autres, mais on va sans doute y remédier un de
ces jours. La Lune s’est détachée hier soir, elle a glissé, est sortie du cadre — c’est une très
grave perte ; j’en ai le coeur brisé rien que d’y penser. Il n’y a pas d’autres ornements ni de
décoration qui lui soient comparables pour la beauté et le lustre. On aurait dû mieux
l’accrocher. Si seulement on pouvait la récupérer … »*
* : Mark Twain. Le journal d’ève. éd. mille et une nuits n°56.
stop consommation range ta planète
stop consommation range ta tête
stop consommation range ta planète
stop consommation range ta tête
stop consommation range ta planète
stop consommation range ta tête
stop consommation range ta planète
stop consommation range ta tête
stop consommation range ta planète
stop consommation range ta tête
stop consommation range ta planète
stop consommation range ta tête
stop consommation range ta planète
stop consommation range ta tête
fin
i.mage
Récit de David Vial écrit en 2000
paru une première fois aux éd. Key Largo
isbn 2-9517237-5-X
Antoine quitte l’appartement sans bruit, referme derrière lui la porte à clef avant de
s’engager dans l’escalier de bois. Arrivé au premier étage il remet ses chaussures pour
retrouver un peu de cette noble attitude qui le distingue, puis il tire sur ses vêtements
défaits et marche vers le parc. Là, il choisit un banc ensoleillé et s’assied pour réfléchir. Ce
n’est sans doute pas très grave mais de toute évidence quelque chose cloche chez lui. Déjà
ce matin en se levant il a eu l’impression que quelque chose ne tournait pas rond. Autour
de lui tout semble normal : les oiseaux volent et conversent avec joie, dans les allées
circulent coureurs de fond et grands-mères en nourrices, cependant un peu à l’écart sous
les arbres, des jeunes l’observent, impassibles. Comme s’ils guettaient ses moindres gestes
ou sa réaction. Antoine a une nouvelle bouffée d’angoisse. Y a-t-il quelque chose sur lui,
qui trahit son état ? Est-il tâché ou mal mis pour qu’ainsi on le décrypte de la tête aux
pieds ? Un simple reflet de vitrine suffirait à effacer cette peur superficielle : rien dans son
apparence ne le distingue pourtant, la gêne demeure et les gosses gardent les yeux braqués
sur lui. Pour se soustraire à cette pression il se lève et repart, quitte le parc et plonge dans
la ville. A neuf heures du matin les boutiques du centre piéton lèvent tout juste leur rideau,
sur les trottoirs on s’occupe à décharger, trimballer les livraisons : la marchandise prévue
pour la journée sera écoulée avant ce soir et demain tout pourra recommencer. Le système
est si bien conditionné qu’aucun retard ni dommage n’est jamais signalé. Tous les produits
sont fabriqués à temps, chaque consommateur remplit son devoir, tout ça sans histoire,
sans réclamation. Antoine sort sa carte pour l’insérer dans une borne-réseau. La machine
demande un code que l’initié lui sert, puis après quelques crépitements, ses comptes
s’affichent :
compte énergie : 2500 ¥€$ compte temps : en attente
Pour le moment, Antoine ne travaille pas. Mais vu l’état de ses finances, cela
devient urgent. Aujourd’hui, son crédit s’élève à 18,75 ¥€$. C’est la somme qu’il est tenu de
dépenser dans la journée pour conserver son statut d’intégré. Il peut l’utiliser à sa guise
mais rien ne doit rester à l’heure du couvre-feu. En réalité, il en dépensera déjà huit ou
neuf pour manger et trois pour la cotisation locative. Avec le reste il peut voir un film dans
un multiplex urbain, prendre le métro ou passer un coup de fil... De toute façon, il a le
temps. Beaucoup de temps. Il n’aime pas travailler. Il juge que le temps qui lui est accordé
sur cette Terre n’est pas à prendre à la légère. L’occuper à produire des objets laids et sales
lui semble absurde. Du coup, il se contente de peu pour vivre et passe son temps à flâner, à
penser.
Il ne cherche du travail que lorsque cela s’avère nécessaire pour alimenter son
compte énergie. Il choisit alors un emploi temporaire qui lui prend quelques dizaines
d’heures ; en échange, il reçoit des dols et son crédit quotidien augmente. En général, il ne
va pas au-delà de quarante à cinquante heures de travail par mois. Cela lui assure un
revenu modeste mais suffisant, de toute façon il n’a pas d’autre choix pour rester intégré.
Sa formation scolaire initiale lavait destiné aux travaux de maintenance. Pendant dix ans il
a été tour à tour jardinier, laveur de carreaux, débroussailleur sur autoroute ; depuis peu
seulement un stage qualifiant lui permet de travailler dans les centres vitaux. Il est devenu
technicien, spécialiste des climatisations et opérateur dans la chaîne du froid. S’il le veut il
peut trouver un emploi dans la journée : il lui suffit pour cela de se relier au réseau et de
cliquer sur l’A.N.O.T. : l’Agence Nationale d’Organisation du Temps.
Mis en place en même temps que la Carte Universelle, cet organisme est chargé de
recenser à l’instant t tous les emplois à pourvoir sur le territoire et tous les intégrés
cherchant à occuper leur temps au même moment. Un terminal combine les données et
propose une série d’offres correspondant aux qualifications du demandeur. Tant qu’il était
connecté, Antoine aurait pu consulter les offres du jour. Mais il est préoccupé et n’a pas
envie de penser à cela. Il remonte la Spuistraat et s’installe pour un café en terrasse à un
carrefour double où le canal et la rue qui le longe rencontrent un pont. C’est alors qu’une
grappe de bicyclettes passent. Le tintamarre qui en résulte vient lui presser l’oreille
interne, un instant déséquilibré, il rate son geste : la tasse qu’il destinait à ses lèvres se vide
sur la table et son pantalon.
La brûlure lui arrache un cri, d’un geste rageur il balance la tasse loin de lui. Si loin
qu’elle atterrit au beau milieu d’un bateau-mouche. Dans l’élan, la tasse a traversé la rue, le
tiers du canal, la vitre et les premiers convives pour terminer en torpille dans un fracas de
vaisselle. Diantre quel exploit ! Quelle élégance ! Quel geste ! Une clameur jaillit du bateau.
Les matelots cherchent en vain l’origine de ce tumulte tandis que stewards et hôtesses
s’efforcent de calmer et panser les passagers. Mais le capitaine, happé par les flots du trafic
ne peut stopper l’engin. Antoine reste un instant stupéfait. Personne alentour n’a fait le
rapprochement entre son geste et le remue-ménage. Il éponge son pantalon avec la
serviette, se lève et va payer sa consommation. En ressortant, il tient son pull à la main de
manière à dissimuler la trace de café. La trace, la tâche, la tasse. La tasse n’y serait pas.
Etant déjà éloigné il accélère et tourne dès qu’il peut au coin de la rue. Il continue à
marcher ainsi, un peu au hasard et finit par se convaincre que cela n’est pas très grave. On
ne peut lui reprocher aucune mauvaise intention, aucune préméditation.
Un peu plus tard dans la journée il songe pourtant à savoir ce que sont devenus le
bateau et ses passagers. Il espère n’avoir blessé personne. Il y avait eu des cris et une vitre
brisée, comment être sûr que tout le monde est sain et sauf ? Il décide donc d’aller jusqu’au
quai d’embarquement. Toutes les sociétés de loisirs ont une flottille de bateaux-mouches et
toutes sont situées près de la gare. Le seul détail qu’il a remarqué ce matin est une sorte
d’aileron bleu et jaune fiché à l’arrière du navire comme une nageoire caudale. Il a de la
chance : deux seulement ont osé pareille allusion. L’une en rouge et jaune, l’autre est la
bonne. Il dévale l’escalier et se présente au guichet comme journaliste indépendant, venu
faire un article sur l’incident du matin. La jeune femme le prend très au sérieux et le
conduit dans un petit bureau préfabriqué. Puis elle repart sans un mot, revient avec un
homme rond et les laisse seuls.
« Vous êtes journaliste ?
![]() Et bien oui, indépendant ; je wai pas encore de …
Et bien oui, indépendant ; je wai pas encore de …
![]() de carte ?
de carte ?
![]() de carte oui ; mais c’est que j’ai vu la scène de loin et …
de carte oui ; mais c’est que j’ai vu la scène de loin et …
![]() Vous avez assisté à la scène ?
Vous avez assisté à la scène ?
![]() Indirectement, enfin, c’est … je …
Indirectement, enfin, c’est … je …
![]() Ecoutez, la police recherche des témoins de l’attentat. Si vous y étiez, vous pourrez
Ecoutez, la police recherche des témoins de l’attentat. Si vous y étiez, vous pourrez
sûrement les aider. Comment vous appelez-vous ? Je peux vous donner le numéro de
l’inspecteur chargé de enquête, tenez, c’est le 020-6188553. Appelez-le de ma part, je suis
monsieur Athard : communication. Il faut absolument que vous nous aidiez, c’est un acte
insensé.
![]() Insensé ?
Insensé ?
![]() Oui. Un type a balancé une tasse pendant la réunion des syndicats mixtes. Une fenêtre a
Oui. Un type a balancé une tasse pendant la réunion des syndicats mixtes. Une fenêtre a
explosé, tout a volé en éclats.
![]() Ah ! … Des blessés ?
Ah ! … Des blessés ?
![]() Oui, San Domines, le représentant des Primaires. Il a chopé une petite vérole, le visage en
Oui, San Domines, le représentant des Primaires. Il a chopé une petite vérole, le visage en
sang, plein de petits bouts de verre. Très impressionnant. Il est choqué. On parle d’une
vengeance personnelle ou d’un attentat politique. Enfin, je compte sur vous. La police
tirera ça au clair, il faut lui faire confiance. Vous êtes … monsieur ?
![]() Dépand. Moussa Dépand.
Dépand. Moussa Dépand.
![]() Drôle de nom. Enfin, n’oubliez pas hein : le coup de fil. »
Drôle de nom. Enfin, n’oubliez pas hein : le coup de fil. »
Antoine gravit l’escalier blanc en se tirant discrètement par la rampe. Cela ne va pas
très bien. Il retrouve la rue comme on retrouve la terre ferme après un long périple en mer,
tanguant peu sûr de ses pas, presque nauséeux. Si vraiment tout cela est vrai — et comment
nier que ce le soit — il est mal. Et comme il réfléchit debout, un peu hagard et les bras
ballants, quelques passants le décryptent de haut en bas. Ce coup-ci, c’est à cause de la
tâche : sur son pantalon. Il regrette pour San Domines. C’est un brave type avec du coeur,
un des derniers sans doute à parler d’Internationale. Il fait du bon boulot pour défendre le
droit au travail et protège son électorat. Il s’occupe des primaires : ceux qui assurent les
tâches de production. C’est le niveau de travail le plus pénible des pays développés. Ailleurs
dans le monde, il reste encore des humains chargés d’extraire les matières premières mais
c’est en voie de disparition. D’abord parce que les ressources manquent et ensuite parce
que les robots s’occupent de ce qui reste. On y avait mis des robots ! des robots sans visage,
sans voix, sans syndicat ! San Domines lutte contre cela et le fait bien. Il serait dommage
que sa carrière pâtisse d’une atteinte sérieuse à son image. Ne devrait-il pas se retirer des
affaires ?
Antoine marche. La nuit tombe comme un voile et son angoisse se dissipe un peu. Il
aime la nuit pour son calme. Il pense beaucoup mieux la nuit que le jour, quand cessent
enfin les multiples bruits qui viennent troubler la conscience : vibrations parasites issues
de moteurs en tous genres, sons aigus et irréguliers, interférences magnétiques,
crissements, grincements stridents, tout cela lui fige les nerfs en pelote. Pour l’heure il fait
nuit et il doit penser, penser vite et bien pour réagir au bon moment, en faisant le geste
juste. Antoine doit être intelligent, sa vie en dépend. « La tasse, même en miettes est
récupérable. S’ils ont la tasse, alors ils ont son numéro de lot. Donc ils savent où elle a été
livrée, quand, et même par qui ... De la tasse, ils peuvent remonter au café. Or ce matin, le
café était vide. Et j’ai payé avec ma carte. Donc ils savent qui je suis. Ils savent d’où vient la
tasse et qui l’a utilisée en dernier ... » Antoine marche toujours, préférant ne pas rentrer
chez lui. Il est persuadé que son appartement a déjà été fouillé et que des flics l’attendent
en bas de l’immeuble, fumant des clopes en série cachés derrière les boîtes aux lettres. Un
instant il pense à se rendre... »
Gabrielle sursaute et interrompt son récit. C’est de toute façon la même chose
chaque fois qu’elle se met à sa table de travail. Aujourd’hui elle pensait avoir la paix, mais
voilà qu’on sonne à la porte. Elle se lève, quitte son bureau, soupire et traverse le vestibule
à pied pour ouvrir au préposé des postes, qui se tient devant sa porte en costume jaune
réglementaire. Il fait le tour du quartier pour remettre sous enveloppe transparente le
bottin des nouveaux produits. Gabrielle signe le registre et remercie le fonctionnaire. De
nouveau seule elle hésite à se remettre au travail. Bien vite elle opte pour une pause et une
tasse de thé. En attendant que l’eau chauffe elle déchire l’emballage de cellophane. Les
produits de consommation courante changent tous les mois. Et tous les mois, chaque
intégré reçoit cette bible de la consommation, sous pli. On connaît ainsi les articles
tendances et on peut rester dans le coup. Gabrielle feuillette le catalogue d’un oeil lointain
en sirotant son thé de chine. Cela ne l’intéresse guère d’apprendre par coeur la liste des
produits phares. Elle s’en fout. Mais elle s’impose d’en connaître le minimum pour ne pas
commettre d’impairs dans les conversations. Elle laisse donc défiler les yaourts et les
soupes, reconnaît des boîtes de thon et s’arrête sur un service de table. Elle examine
l’image et pousse un cri de surprise. Sans aucun doute possible elle a sous les yeux la tasse
d’Antoine. Le même objet, le même modèle qu’elle a imaginé. Elle sourit de la coïncidence
et l’interprète comme un heureux présage pour Antoine. Elle ne sait pas encore comment
mais elle est convaincue qu’il s’en sortira. Elle croit beaucoup en lui. Elle n’aime guère la
réalité ambiante et compte un peu sur lui pour changer les choses. Il en a les qualités. Il en
est capable. Elle met en lui tous ses espoirs et toute sa révolte. C’est pour elle la seule façon
de supporter le travail et la vie monotone qu’elle mène de front. Antoine est libre et elle
l’admire.
« Les flics sont sans doute à sa recherche et cela le trouble. Un instant, il songe à se
présenter spontanément pour s’expliquer. Il ne peut pas croire qu’on le prenne pour un
terroriste. C’est vrai qu’il s’est toujours tenu un peu en marge de cette société mais il n’a
jamais eu l’intention de prendre les armes. Antoine est un chercheur, un poète porté par
quelques rêves, mais sûrement pas un fou, prêt à balancer une tasse pour troubler une
réunion parodique. En plus, il aime bien San Domines. Pour en avoir le coeur net, il insère
sa carte dans une borne, compose le code et attend. Après quelques secondes ses comptes
s’affichent normalement. Il en profite pour consulter quelques dossiers et s’éloigne de la
borne. Rien ne s’est produit mais cela ne signifie rien. Un peu plus loin, un immeuble à
escaliers lui offre un poste d’observation idéal. Il monte jusqu’au quatrième sans croiser
personne et s’installe sur le balcon, en surplomb de la rue. Là, il roule une cigarette et
l’allume. Comme il s’y attendait, une patrouille ne tarde pas à apparaître en haut de
l’artère. Au niveau de la borne elle ralentit d’abord puis stoppe un peu plus loin. Deux
agents descendent. Antoine se baisse un peu pour éviter que sa silhouette ne se découpe
sur le ciel. Il observe avec attention l’un des flics qui sort de sa mallette un pinceau et un
tube. Avec application ce dernier badigeonne le clavier de la borne, sans doute une fine
couche de plastique souple, utilisé pour piéger les empreintes digitales. Le fonctionnaire
décolle la feuille séchée d’un geste professionnel et la range avec soin dans une enveloppe
transparente.
« Deuxième pièce à conviction versée au dossier après la tasse, ou ce qu’il en reste. »
Antoine commente cela sans émotion, remarquant seulement que l’enquête avance à
grands pas : après avoir repéré le principal suspect ils ont maintenant une preuve
matérielle reliant la tasse — arme du crime — et son auteur. S’ils parviennent à isoler son
empreinte sur la borne et sur la tasse c’est suffisant pour le mettre en examen. Antoine
regagne la rue. Au moins, il sait à quoi s’en tenir. Il ne lui reste plus qu’à quitter la ville, se
mettre au vert quelques temps. Plus question de chercher du travail, pas question de rester
plus longtemps. Mais pour cela, il lui faut d’abord rejoindre sa voiture garée derrière le
parc. En approchant de chez lui il sent les flics, quelque part dans l’ombre. Il coupe donc
par l’avenue, évitant le faisceau des caméras et retrouve son véhicule sans encombre. Il
monte et démarre doucement.
Au cas où il leurs serait venu à l’esprit de placer un mouchard il décide de passer par
la place d’Aubert. Peu de gens savent que cette place est traversée par un réseau très dense
de supraconducteurs. Les interférences magnétiques déboussolent régulièrement les gps
embarqués et les radios. Il faut les rerégler. Cela provoque quelques mécontents parmi les
chauffeurs-taxis et c’est d’ailleurs l’un d’eux qui un jour l’avait renseigné. Il avait lâché en
rigolant que c’est tout aussi ennuyeux pour les flics qui appellent cette place le triangle des
Bermudes. Après quelques tours en rond Antoine disparaît en vitesse par une ruelle
étroite. Si le taxi a dit vrai, il est maintenant hors contrôle. Hors de tout réseau régulier.
Cela l’amuse. Il a toujours veillé à rester discret, anonyme comme un agent dormant.
Aujourd’hui, un stupide incident le jette dans la clandestinité et il s’en réjouit. Peut-être au
fond, est-ce une chance offerte de disparaître complètement, de s’effacer pour de bon. »
Estimant avoir assez avancé Gabrielle clique sur ‘quitter’. Elle attend un instant
l’écran adéquat puis elle éteint son ordinateur. Sans ôter ses lunettes elle allume une
cigarette et finalement se lève pour faire quelques pas. Le lendemain elle a rendez-vous à
huit heures pour vendre un concept publicitaire. Elle n’a pas besoin de peaufiner son
dossier : l’obtention du marché est tacite car son patron a déjà rendu service au cadre
marketing, il s’agit dun simple renvoi d’ascenseur. En d’autre circonstance elle l’aurait au
moins relu, là, elle se contente de se brosser les dents avant de se coucher.
Dès que le réveil sonne, elle note les impressions de ses rêves. Encore chiffonnée par
la nuit elle griffonne sur un carnet les scènes vécues et les personnages rencontrés, puis
elle use de différents rituels pour prendre pied dans le réel : exercices de respiration
naturelle, douche, thé et tartines de confitures. Malgré cela, en quittant l’appartement ce
matin-là elle parait plus fragile que d’habitude. Son pas léger la décolle du sol comme un
fantôme flottant. Sa robe bleu nuit fait delle une ombre délicate et son visage blanc par
contraste, éclaire l’escalier de bois. Une fois dans la rue elle arrête un taxi. Elle s’assoit à
l’arrière et en arrangeant sa robe découvre une tâche à hauteur de sa cuisse droite. Une
tâche de café, pas trop visible sur le fond bleu. Elle tente de l’effacer mais finit par
s’énerver. D’où peut bien venir cette fichue tâche qui risque de ruiner son rendez-vous ?
Elle se fige, stupéfaite. Elle boit du thé, c’est Antoine qui boit du café. Antoine et sa
tâche, la tasse, le pantalon. Mais cela n’a aucun sens. Cela ne peut qu’être du thé. Du thé de
chine qu’elle absorbe en grande quantité, plusieurs tasses par jour, normal que ce genre
d’incident arrive. Et puis ce n’est pas très grave, le contrat ne peut pas dépendre d’une
tâche sur sa robe ; l’affaire est déjà conclue. Gabrielle se reprend pour assumer son rôle
social. Elle chasse la tâche d’un pli de robe et s’efforce de répondre au chauffeur. Quelques
minutes plus tard, arrivée à destination elle est si saoulée par l’enthousiasme feint qu’elle
n’y pense déjà plus. Elle a de toute façon besoin de toutes ses facultés pour naviguer dans
les couloirs et les salles surpeuplées. Cette foule l’oppresse. Elle est obligée d’en pousser
certains qui continuent de parler et gesticuler sans la voir. Un instant, elle se trouve même
bloquée dans un sas qui protège l’accès aux salles de conférences. Sans se soucier des
regards elle sort un tube et gobe deux pastilles rondes. Des calmants pour supporter. Enfin
elle trouve la pièce n° 3206 où doit avoir lieu la réunion.
Tout le monde est déjà présent. Elle s’excuse de ce retard habituel et propose de
commencer son exposé qui dure exactement dix sept minutes : temps nécessaire et
suffisant pour choisir un concept initial qui sera ensuite décliné suivant le budget. Ici :
trois millions de Ye$. En dix-sept minutes, sans écouter mais en répondant à trois appels
téléphoniques un décideur gras et bronzé dispose et manipule l’équivalent de trente mille
heures de travail pour les changer en habillage publicitaire. Gabrielle écoeurée lutte contre
la nausée. Elle se retient, estimant que cette somatisation de son inconscient frustré de ne
pouvoir exprimer à la face de cet empañffé ce qu’elle pense de lui serait un peu déplacée.
Elle s’excuse néanmoins et prétextant un autre rendez-vous parodique quitte la pièce en
coup de vent.
Enfin seule, dehors, dans le calme d’un jardin frais elle renoue un peu avec la vie. Le
vent l’enveloppe comme un châle, elle hume l’air en saccades, des piaillements faibles
frappent ses oreilles. peut-etre … elle s’évanouit. Dans son sommeil, les pépiements
d’oiseaux se changent en mélodie, puis en une mélopée monotone qui l’intrigue. Elle n’en
saisit pas le sens mais dans son rêve un homme d’une voix grave tient des propos
solennels. Sa conscience étant curieuse elle s’éveille et se retrouve alors étendue sur le
banc. Son malaise a disparu. En se redressant elle aperçoit dans une allée un petit groupe
rassemblé : c’est de là que vient la voix. Elle se lève et découvre un homme assis par terre,
qui parle au ciel et aux graviers. Autour de lui des gens se tiennent debout.
« Il faut tout arrêter. Cesser le travail. Refuser de consommer. Il faut tout arrêter
pour discuter. Invitez vos amis, écoutez-les et confiez-vous. Vous avez des choses à dire, il
faut tout arrêter. Vous détruisez tout pour jouir plus. Vous construisez des immeubles
vides et des familles sont dehors. Vous ne savez plus lire ni voir le monde. Vous n’entendez
plus rien dans le fracas que vous produisez. Si tout cela ne s’arrête pas, vous serez bientôt
seuls. » Certains l’écoutent. « Il faut tout arrêter pour dialoguer. Chacun est différent d’un
autre, il faut s’entendre et s’accorder. Vous passez votre temps à construire des morceaux
d’une réalité qui vous échappe, vous consommez pour exister, pour donner un sens à tout
cela. Mais cela est absurde. Il y a autre chose à faire. Créez. Créez ce que vous pourrez.
Même modeste une oeuvre créée a plus de sens qu’un objet acquis. Il faut tout arrêter pour
créer. Vous devez inventer. Ce monde est laid et triste. Vous devez décider ensemble de le
changer. Vous devez l’imaginer, l’inventer. Il faut inventer. »
Quelques-uns réagissent par des applaudissements. C’est leur façon à eux,
conditionnée et festive, de montrer leur joie car il n’y a là que quelques jeunes, habitués à
fréquenter le jardin pour se protéger des yeux du monde. Certains y trouvent l’espace
nécessaire à la divagation, la reverie ou l’expérience portée par l’aventure que peut susciter
un bosquet. Aujourd’hui, le jardin s’anime de conscience révolutionnaire, ces jeunes gens
entendent ce qu’ils ne pouvaient même plus formuler faute de connaître les mots. La petite
troupe s’affirme vite et un audacieux exhorte l’homme à poursuivre son discours. Mais une
femme plus âgée intervient. « Qui est ce fou ? C’est un inconscient ! Ne l’écoutez pas vous
autres, c’est interdit de dire des choses pareilles. Vous allez avoir des problèmes, je vous
préviens. » Il continue. « Il faut tout arrêter. Arrêtez le travail, organisez-vous. Il est
possible de vivre sans télé, sans portable, sans prothèse. Libérez votre temps. Il faut
inventer une nouvelle école et diffuser les connaissances. Que les musiciens jouent tout
leur saoul, que les peintres peignent, que les comédiens miment, que les enfants chantent,
que les vieux racontent, que les grands aident. Il faut tout arrêter pour réapprendre
l’humanité. »
Tiré par la vieille, l’homme se laisse conduire au dehors. Elle comptait le mener sur
la place publique sans doute pour qu’il y soit pendu ou bastonné. Mais les enfants
l’entourent et forcent la femme à lâcher prise. Elle continue néanmoins à brailler, pour
parasiter le discours et alerter les siens. Car aussitôt dans la rue la troupe enfle et roule,
soudain grossie par les effectifs d’un lycée voisin, qui largue ses élèves sur la chaussée.
L’homme parle toujours. Sa voix grave ne se mêle pas au vacarme de la circulation. C’est
comme si elle touchait l’âme sans passer par les oreilles. « Sans doute est-ce dû à sa
fréquence » s’explique Gabrielle étonnée de percevoir de si loin des mots si nets. Un
instant elle croit qu’elle est seule à entendre, que cela vient d’elle. Mais la liesse ambiante
la contredit. Elle suit, un peu à l’écart, pour apprécier la situation dans son ensemble. « Il
faut tout arrêter. Votre temps est votre seule richesse. Vous êtes loin de tout. L’essentiel
disparaît sous les fantasmes que vous tissez. Revenez au rêve et transformez-le en réalité. Il
faut inventer. Vous devez créer. Réfléchissez ensemble. Vous devez envisager un monde
nouveau. Vous êtes responsables de la suite. Vous êtes les maîtres de la Terre. Arrêtez de
consommer. Arrêtez de produire. Arrêtez de détruire. Arrêtez de polluer. Arrêtez de
profiter de la Terre. Vous en êtes responsables. »
Le rassemblement glisse et gonfle prenant toujours plus d’ampleur. Certains
improvisent des rythmes sur des poubelles, d’autres répondent par des danses tribales. Sur
les côtés, ceux qui passent s’arrêtent saisis puis encouragés par le nombre toujours
croissant ils plongent dans l’allégresse. Prévenues par sms, en moins d’une heure plusieurs
milliers de personnes déambulent librement dans les rues, formant sans s’en apercevoir
une troupe joyeuse, un assemblage spontané d’humains rieurs et décontractés qui
marchent ensemble sans mot d’ordre ni revendication. Gabrielle n’en revient pas. Jamais
elle avait pensé que cela fut possible. Elle ne soupçonnait pas que tant de gens puissent
ainsi se livrer, si facilement. Car même si tout à l’heure le mouvement réunissait les jeunes
et ce que la rue compte comme sages, c’est maintenant un ensemble hétéroclite qui s’agite
devant elle. Elle est soudain heureuse, troublée et un peu inquiète, comme à son habitude.
Du regard, elle cherche l’homme. Elle ne l’entend plus. Elle se fraie un chemin vers
le centre de gravité de cette révolution naissante et aboutit à un cercle, formé par les
percussions. Dans ce cercle des danseurs se mettent en transe. Mais elle ne voit pas
l’homme ; du reste, d’autres semblent le chercher. Le mot passe qu’il a disparu. Il s’est
éclipsé mais reviendra sûrement plus tard. Son absence ne rompt pas le charme et la fête
se poursuit. Dans le cercle de danse, les possédés révèlent des vérités oubliées de tous
tandis qu’à leurs côtés, des personnages sortis de la foule, réunis en paix, bavardent. Ils
s’interrogent sur la suite à donner au mouvement, conscients de leur rôle et de
l’importance du moment. Gabrielle laisse cela et navigue dans les rues adjacentes. Elle veut
retrouver l’homme, elle veut lui parler. Mais le jour est tombé et ses forces faiblissent. Elle
se sent confuse, partagée entre la joie de sentir l’humanité s’animer et l’angoisse de ne pas
comprendre ce qui s’est vraiment passé. Elle remarque à nouveau la tâche, sur sa robe.
Peut-il y avoir un lien entre l’homme et Antoine ? Comment situez-vous le champ du
possible, celui de l’impensable ? Une fois chez elle, elle fait du thé et allume la télé. Sur
chaque chaîne on retransmet les faits du jour sous tous les angles possibles. Le
commentaire est concis, professionnel, nulle mention n’est faite d’un homme particulier.
Sur les images elle ne le voit pas une seule fois. Sans doute a-t-il quitté le cortège avant
l’arrivée des journalistes. Ces derniers font de l’ensemble un tableau déjà déformé. Ils se
laissent envahir par l’émotion que les témoins directs leur livrent puis ils jouent pour
l’auditoire une parodie savamment bricolée qu’ils signent de leur nom. On apprend
cependant qu’un collectif prend la responsabilité de l’action. Il annoncera bientôt par voix
de presse un message, destiné à l’ensemble de la population. En attendant, les autorités se
contentent d’encadrer la manifestation. Aucun dommage n’est signalé, aucun incident,
aucune violence.
Au cours de la nuit, le mouvement fait tâche d’huile. Dans tous les centres vitaux du
pays des gens s’assemblent pour se reconnaître et se parler. C’est comme si tout à coup
ceux qui subissaient en silence un système absurde osaient s’élever pour dire halte, halte à
ľamuse mensonge ! Sans violence ni ressentiment, ils refusent tous de travailler et de
consommer quotidiennement la somme imposée. Ils réclament du temps pour eux et leur
famille, pour s’ouvrir au monde et s’exprimer. Gabrielle coupe le son. Elle est allongée sur
un fauteuil, il est près de six heures du matin. Tout à l’heure, elle n’ira pas à son bureau,
elle préfère rester ici près d’Antoine.
« Antoine réapparaît bientôt. Il est resté quelques jours chez un ami à la campagne
dans une maison du passé coupée du monde. Il savait que les flics ne viendraient jamais le
chercher là mais au bout d’une semaine, il a craqué. La situation est grotesque. Il ne peut
pas rester clandestin, vivre à l’écart jusqu’à la fin de ses jours. Il est prêt à se livrer et
décide donc de revenir en ville, où il tient à assumer son rôle même si l’histoire est
mauvaise et doit le conduire en cabane. Il préfère encore cela. S’ils lui accordent grâce, s’ils
se contentent de l’enfermer, il écrira pour raconter son histoire. Cela pourra peut-être plus
tard intéresser un étudiant à la recherche d’un sujet original ... pour sa thèse. Il avait pris
congé de son ami en promettant de le tenir au courant du jugement. Xavier avait souri, lui
assurant qu’il exagérait toujours ses craintes puis il avait serré avec force la main
qu’Antoine lui tendait pour retourner à sa femme, ses enfants, sa trompette et son potager.
Antoine entre en ville au pas, il se dirige droit vers la préfecture. Il est si soucieux
qu’il ne remarque rien de spécial, pourtant, sur les trottoirs les gens se parlent. Des
groupes se forment et naviguent en tout sens. Tout le monde semble très excité. Au feu
rouge, une jeune fille distribue des tracts. Il la regarde un instant médusé et prend quand
même la feuille qu’elle lui tend. La gamine, souriante, poursuit son oeuvre, le laissant à sa
stupide stupeur. Il n’en revient pas. Comment se fait-il que les flics ne l’aient pas encore
coffrée ? Il est interdit de faire de la propagande. Seuls les tracts publicitaires sont
autorisés. Sur la feuille blanche, il aperçoit un mot en gras qui se détache du texte :
révolution. Ensuite, il doit démarrer car l’ampoule verte s’est rallumée. C’est là qu’il voit
que tout est différent. La plupart des boutiques sont fermées ; les gens discutent avec
emphase, certains rient. Tous ont l’air heureux et insouciants. C’est comme si subitement
la ville entière était au repos et que la douceur de l’air invitait les hommes à se promener.
Antoine a du mal à comprendre. Il se gare et sans quitter la voiture, il lit le tract :
Hier après-midi, une liesse spontanée a déclenché un mouvement sans précédent. Il en
ressort que les habitants du pays décident ensemble qu’ A partir d’aujourd’hui
toute production non vitale est stoppée tout commerce artificiel est suspendu Ce temps
rendu disponible par l’arrêt temporaire de l’ensemble du système doit permettre à la
population de se concerter.
Chacun est donc invité à rejoindre la rue, pour manifester son soutien à la révolution.
Que ceux qui ont peur, qui ne sont pas rassurés par les caméras et les patrouilles, par les
cris et les grincements de métal, par les machines et les tôles, par l’autoroute et la nationale
qui passent sous leurs fenêtres, par la centrale et l’usine d’engrais qui viennent de
s’installer. Que ceux qui angoissent pour les fleuves et les forêts, ceux qui cherchent les
étoiles à travers la pollution, ceux qui n’aiment ni les grosses bagnoles, ni les armes, ni les
gros chiens, que tous ceux-là se fassent connaître.
Exprimons-nous, élevons nos voix. Prenons confiance car c’est sûrement cette voie qui
reste la plus sensée. Inutile d’utiliser la force. Il faut créer. Récupérons notre temps. C’est
notre unique richesse. Réaccaparons notre temps. Cessons de produire des biens, cessons
de vendre notre temps.
Gardons-le pour nous et occupons-le à dormir, à rêver, à discuter ensemble, à réfléchir ou
méditer seuls, à partager des repas, des moments, des aventures, consacrons du temps à
nos enfants, nos parents, nos amis, occupons-le à aimer, à apprendre, à comprendre, à
faire l’amour. Vivons la vie sans accumuler.
Avouons cette tendance que nous avons à la rêverie et à l’observation, à la matière
spirituelle plus qu’aux contingences de la matière.
Si nous osons cela, nous parviendrons à créer un monde dans lequel une grande majorité
de l’humanité se sent bien. Il n’y a qu’à se laisser porter, rythmer, emmener vers le doux, le
subtil, l’intelligent, le facétieux, le libertaire ou libertin, le créatif, l’harmonieux, le beau,
l’art et la musique, les sensations ténues et multiples, la variété, la tolérance, la recherche,
la curiosité, louverture, la mixité, la richesse, l’abondance, la paix.
Fin


